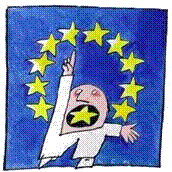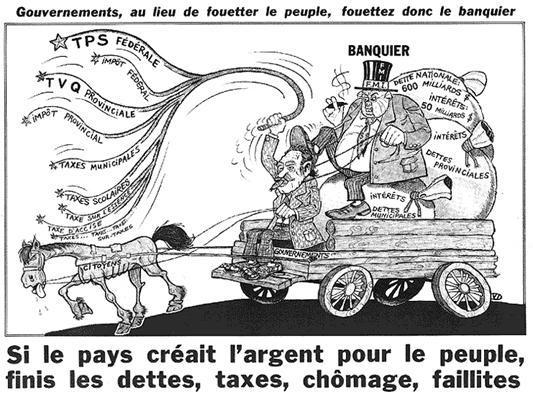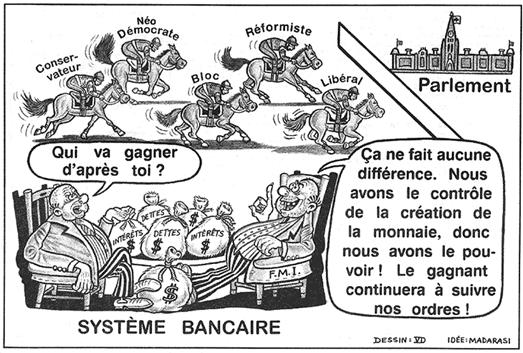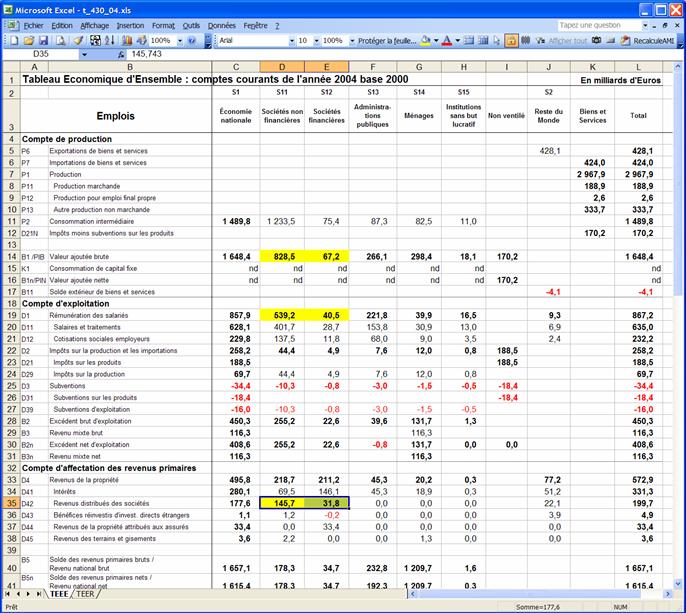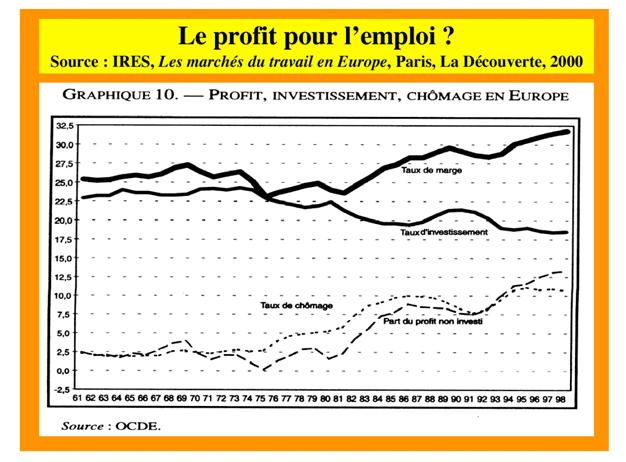BIEN FAIT POUR VOUS !
(18 novembre 2008) (Lien)
Chers amis, je suis malheureux.
Jai limpression de travailler pour rien. Mon idée centrale ne progresse pas.
Je dois mal mexprimer, ou me tromper.
La passivité des
gens qu'on viole chaque jour avec leur assentiment, dans l'indifférence
générale, leur servitude volontaire, me décourage chaque jour un peu plus.
Dautre part, et surtout,
l'incompréhension profonde des militants et des intellectuels que je respecte
pourtant plus que tout me désespère complètement : les dizaines d'heures que
j'ai passées avec Raoul Marc Jennar, Michel Onfray, Gérard Filoche, Jacques
Généreux, Frédéric Lordon, Annie Lacroix-Riz, Paul Ariès, Jean-Marie Harribey,
Bernard Manin, Jean Veronis, Daniel Schneidermann, Élisabeth Lévy et Philippe
Cohen, Jean Lebrun, François Ruffin, Mona Chollet, Sébastien Fontenelle, Agnès
Maillard, Stéphane Paoli, Serge Halimi, André Bellon, Maurice Allais, Paul
Alliès, Thierry Meyssan, Jean-François Kahn, Jacques Cheminade, Pierre
Rosanvallon, Daniel Mermet, et tant d'autres dont j'aime tant la pensée
généreuse, la culture infinie et/ou le courage politique, toutes ces heures
semblent n'avoir servi à rien :
Alors quils sont précisément,
selon moi, particulièrement sensibles, humanistes, agiles intellectuellement et
ouvert à des idées nouvelles, aucun de ces valeureux n'a compris (mais j'en
déduis que c'est probablement moi qui me trompe et qu'il faut peut-être tout
laisser tomber et retourner voler dans mes montagnes chéries, ne pensant plus
quà moi et mes proches, comme avant), aucun n'a compris l'importance première,
prioritaire, inédite (jamais testée ailleurs quà Athènes il y a 2 500 ans),
forcément fondatrice dun véritable pouvoir de résistance des hommes contre les
abus de pouvoirs, limportance décisive de la Constitution la seule
règle de droit qui soit, PAR DÉFINITION, au-dessus des pouvoirs et qui
s'impose donc à eux , et, par voie de conséquence logique, l'importante majeure et
évidente du DÉSINTÉRESSEMENT DES AUTEURS de ce texte supérieur.
Tous ces personnages passionnants m'écoutent
gentiment, amicalement, amusés de mon insistance quils qualifient parfois
dobsessionnelle, mais pas du tout convaincus que j'aie le moins du monde
raison et... ils
continuent TOUS à considérer comme une évidence que l'Assemblée Constituante doit
être... ÉLUE.
J'en ai donc
vraiment marre, en fait, et derrière mon front, commencent à s'afficher les
mots BIEN FAIT POUR VOUS : pendant que le monde s'écroule, pendant que ces
gredins de patrons continuent à se goinfrer après nous avoir tous ruinés,
pendant que les serpillères gouvernementales nous font les poches en beuglant
leur vertu et en couvrant de centaines de milliards les barons voleurs au lieu
de les jeter en prison, de confisquer leurs biens et de nationaliser la finance
tout entière, alors que ce désastre ne peut être freiné par aucune digue puisque
la Constitution (relisez-la si vous ne me croyez pas, celle de France et celle
de lUnion européenne) ne prévoit rigoureusement AUCUN moyen de résister même
aux pires abus de pouvoirs, pendant que les pires ravages sapprochent, pendant
que les journalistes salariés des (subordonnés aux) banques nous préparent déjà
à la nécessité de nouvelles guerres, vous êtes tous là à dire : « oui, cest
une bonne idée, la constitution, cest intéressant, mais ce nest pas réaliste,
il faut soccuper dabord de tous les problèmes des gens, les salaires,
lemploi, lenvironnement
» et gna gna gna
Mais bon sang,
tous ces problèmes sont IMPORTANTS MAIS SECONDAIRES : tant que vous avez LES
FERS AUX PIEDS, les fers constitutionnels, vous êtes tous, nous sommes tous,
condamnés aux plus stériles bavardages.
Bla bla bla
et
merde.
Les
multinationales et les banques, moins stupides que nous, elles, ont compris que
CE QUI COMPTE CEST DÉCRIRE SOI-MÊME LES INSTITUTIONS et de prendre ainsi le
contrôle réel des marionnettes gouvernementales : qui écrit le droit européen ?
Pourquoi est-ce un banquier (américain de cur) Jean Monnet qui a décidé de
construire de nouvelles institutions (prétendument « européennes ») de cette
façon (sans nous) ? Pourquoi tous ces banquiers poussent-ils ardemment le
processus constituant européen (les Pompidou et autres Pascal Lamy) ? À votre
avis ? Par philanthropie ?
Ils sont moins
bêtes que nous, ça cest sûr.
Ils doivent bien
se marrer à nous voir tous gesticuler en tapant les murs sans sortir de notre
prison, alors que la porte nest même pas fermée à clef !
LE POUVOIR VA JUSQU'À
CE QU'IL TROUVE UNE LIMITE.
Ce principe implacable, aussi fort
qu'un principe physique universel, formulé au cordeau par Montesquieu, a une
conséquence importante : de la même façon qu'on ne reproche pas à un malade
d'être malade, de la même façon qu'on ne reproche pas à un objet de tomber vers
la terre, il est inutile, il est presque stupide, d'en vouloir aux pouvoirs
d'abuser : ils sont programmés pour abuser, ils abuseront, c'est leur
nature.
Par contre, c'est à nous les
autres, ceux qui consentent à obéir aux pouvoirs , de fixer des limites.
Et la Constitution, le droit du
droit, la seule règle qui soit au-dessus des pouvoirs, sert précisément à cela.
Mais si vous laissez écrire ces
limites par les hommes au pouvoir eux-mêmes... c'est idiot : vous creusez
vous-même votre tombe politique, ils vont évidemment tricher.
Et il faut donc vous en prendre à
vous, et à vous seul. Ce n'est pas la faute "des autres", et
surtout pas des hommes au pouvoir dont il n'y a rien à attendre de ce point
de vue.
Or, tous LES HOMMES DE PARTIS
cherchent à accéder au pouvoir (et c'est légitime, ce n'est pas le problème) :
ils sont TOUS POTENTIELLEMENT DES HOMMES AU POUVOIR, eux-mêmes ou leurs
proches.
Donc, dans un processus
constituant, à ce moment précis (et pas ailleurs, je ne généralise pas), les
hommes de partis sont à la fois « juges et parties » , les hommes de
partis ont, dans cette circonstance précise, absolument stratégique, un intérêt
personnel contraire à l'intérêt général, ILS NE SONT PAS DÉSINTÉRESSÉS et
ILS SERONT DONC TOUJOURS FORCÉMENT MALHONNÊTES : ils programmeront forcément,
comme ils l'ont toujours fait, l'impuissance politique des citoyens entre deux
élections.
Donc, SI ON ÉLIT l'Assemblée
Constituante, LES PARTIS VONT NOUS IMPOSER LEURS CANDIDATS et, à nouveau, comme
toujours, ce sont les hommes au pouvoir qui vont écrire les règles du pouvoir, et on nen sortira pas, et
merde.
Alors, si vous ne faites pas du
TIRAGE AU SORT DE LASSEMBLÉE CONSTITUANTE une priorité absolue et immédiate,
décisive et indispensable, non négociable,
alors oui,
BIEN FAIT POUR VOUS.
Réponse à Jean Quatremer, qui
voudrait bien discréditer en bloc tous les « nonistes »
pour un "crime de la pensée" : le "conspirationnisme"
(28 septembre 2008) (Lien)
Le 24 septembre,
Jean
Quatremer, journaliste à Libération,
sur son blog Coulisses de Bruxelles,
a publié la note suivante :
Quand
l'euroscepticisme mène au conspirationnisme
|

|
Une partie des tenants du « non » à la
Constitution européenne a développé, durant la campagne référendaire, des
arguments de nature "conspirationnistes", Étienne Chouard en
premier lieu. Sur
son site , créé pour loccasion, le petit prof en informatique de
Marseille sest fait le héraut du « non » en clamant que le traité
constitutionnel européen visait à mettre en place une dictature, pas moins.
Une bonne partie de la gauche extrême (et de la droite extrême( a aussi
joué sur le rejet des « élites » qui, bien sûr, ne peuvent que comploter
dans le dos du citoyen, innocente brebis, en vue daccomplir leurs buts
inavouables.
Lantilibéralisme, qui nest souvent que le
nouveau nom de l'antiaméricanisme, se nourrit de cette paranoïa. « On »
nous ment, « on » nous veut du mal, « on » veut nous mettre au chômage. Le
"on" est au choix, l'Europe, les États-Unis, le libéralisme, le
capital.
|
Je suis heureux de découvrir que la boucle est
désormais bouclée, plusieurs tenants du « non » de gauche soutenant désormais
officiellement les thèses conspirationnistes défendues notamment par Thierry
Meyssan à propos des attentats du 11 septembre 2001 : en résumé, les
attentats ont été organisés par les Américains eux-mêmes, voire nont tout
simplement pas eu lieu ! Le lièvre a été levé par le Nouvel Observateur daté
du 18 septembre. Sur le site de Chouard, on trouve un lien avec une interview
de lanimateur du « Réseau Voltaire » ainsi présenté: "
Thierry Meyssan : « Il faut arrêter les processus de
diabolisation :
désintoxiquez-vous ! Retrouver
lesprit critique »
"Passionnante interview donnée au site reopen911.info".
« Je ne sais pas si les États-Unis ont simplement
laissé faire les attentats ou sils les ont déclenchés », déclare
au NO ce noniste de choc qui prédisait une « guerre civile » si le traité
de Lisbonne était ratifié en France sans référendum. « Ce que je sais cest que les plus gros
mensonges passent comme une lettre à la poste. Pour les dirigeants
américains, 3000 personnes, ça compte pour rien : les gens ne sont que de la
merde sous leurs chaussures. Ce que dit Thierry Meyssan, un homme intelligent
et très cultivé, devrait être débattu et analysé par les journalistes, au
lieu de se trouver balayé par un canon à merde, dont Bigeard est aussi la
victime ». Subtil et raffiné, non ? Tout y est : antiaméricanisme
primaire, méfiance à légard des médias menteur, mépris des élites.
Bellaciao
, le site participatif de la gauche antilibérale, tout aussi hystèriquement
anti-européen que Chouard et qui trouve que la LCR est aligné sur Sarkozy,
c'est dire et dont je suis une tête de Turc régulière , y va aussi de son
soutien aux thèses conspirationnistes (par exemple ici ou ici), tout comme le
site Agoravox qui prétend faire
de chaque citoyen un journaliste (un exemple ici )
À pleurer de
bêtise. Mais je ne dirais pas comme Desproges : « Étonnant, non » ?
|
Ne
pouvant répondre en semaine pour cause de cours au lycée, jai répondu avec le
message suivant, le dimanche 28 septembre 2008, vers 22 h :
Bonjour à tous,
Une amie ma prévenu tardivement
de la publication de cette note. Jai alors lu la première page en diagonale, mais
je devais aller en cours et je ne pouvais pas répondre. Ce week-end, je viens
de prendre connaissance des quatre pages de commentaires, dont certains sont
tout simplement passionnants. Comme dhabitude, on ne progresse jamais tant que
dans la contradiction (à condition, quand même, de se respecter, je pense).
À mon sens, « la théorie de
la théorie du complot » celle que semble défendre Jean Quatremer et qui
traque de prétendues théories du complot ressemble bien à une interdiction
pour les citoyens de vérifier sil ny a eu complot ou pas, une sorte
dINTERDICTION DE DOUTER, sous peine de subir le ridicule réservé aux
paranoïaques, suspicieux au point den être malades.
Pour reprendre dabord vos
reproches un à un :
Dune part, je ne dis pas quil y
a eu tel ou tel complot : je dis justement que je nen sais rien et que
jaimerais bien lire TOUS les avis contradictoires sur la question pour me
forger une opinion éclairée ; ce nest pas pareil, il ne faut pas me faire
dire ce que je nai pas dit. Ladministration Bush développe sa propre théorie
du complot, mais on nest pas obligé de tout croire demblée, ni dans un sens
ni dans lautre, nest-ce pas ?
Jai expliqué à Ariane Chemin (une
journaliste du Nouvel Obs qui avait écrit un papier sur mon site en 2005 quand
elle travaillait au Monde) que les exécutifs à tendance tyrannique ont besoin
de « terroristes » ou d« ennemis extérieurs » pour obtenir
la docilité dune population effrayée (leçons bien connues dOrwell et des
différents anti-totalitaires). Pour ces chefs-là, les humains comptent moins
que de la crotte sous leurs chaussures, je le crois effectivement.
Le moins que je puisse dire est
que cette journaliste professionnelle, pourtant apparemment bienveillante au
téléphone, probablement trop pressée, na pas retenu grand chose dintéressant
de notre long entretien, et que le choix de deux phrases avec deux gros mots
(ce que je ne fais jamais à lécrit, évidemment, quand jai le contrôle de mon
registre de langage) nest pas neutre.
Votre propre dénaturation de cette
première déformation aboutit à une pensée méconnaissable où je ne me reconnais
pas. Il faut vraiment que japprenne à me tenir sur mes gardes quand je reçois
lappel dun « journaliste professionnel » car, comme dans un interrogatoire
policier, tout ce que je dis peut alors être retenu contre moi, en trahissant
sil le faut la promesse dune relecture de mes paroles citées.
De la même façon que je ne
prétends pas quil y a eu complot de ladministration Bush (sans lexclure) en
vue de rendre acceptables les exactions qui ont suivi (Patriot Act et
agressions armées, notamment), je ne « soutiens pas officiellement »
Thierry Meyssan (comme le souhaite apparemment J4M pour me faire rentrer dans
la boîte quil ma attribuée) : je trouve Meyssan intéressant, souvent
même très intéressant. Est-il possible de nuancer et ne pas voir le monde en
noir ou blanc ? Votre sens du discernement devrait vous permettre de
distinguer entre « trouver parfois très intéressant » et
« soutenir officiellement » ?
Je trouve aussi très intéressantes les thèses radicalement inverses,
mais argumentées, comme le lien donné par Bouffon vert (25/9, 1h55) vers une
réfutation méthodique des doutes exprimés.
Dautre part, je réfléchis
effectivement à des institutions honnêtes, cest-à-dire qui placent tous les
pouvoirs sous un contrôle permanent des citoyens (voyez mon forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum
cela représente un certain travail). Je prétends en effet, comme bien dautres
avant moi, que, issu ou pas dune élite, TOUT POUVOIR EST (À LA FOIS NÉCESSAIRE
ET) DANGEREUX, et que les élites qui font tout pour saffranchir des contrôles
sont, elles aussi, (nécessaires et) dangereuses.
Est-ce une pensée
anti-élite ? Pas du tout :
nous avons besoin de favoriser lémergence dune élite pour exercer le pouvoir,
cela va sans dire. Mais doù viendrait que cette élite pourrait gouverner sans
un contrôle sourcilleux des citoyens à tout moment ?
Je dis donc que CEST FOLIE DE
LAISSER LES ÉLITES au pouvoir modifier elles-mêmes la Constitution cest-à-dire
de FIXER ELLES-MÊMES LES LIMITES DE LEUR PROPRE POUVOIR. Et pour linstant,
personne na réussi à me montrer que jai tort, loin de là. Je suis sûr que la
stricte séparation du pouvoir constituant des pouvoirs constitués est une
grande idée qui peut permettre aux hommes de sémanciper enfin, vraiment.
Pour moi, les deux Congrès de
2008, au cours desquels les ministres et les parlementaires ont profondément
modifié la Constitution sans même nous consulter par référendum, sont donc deux
coups dÉtat.
Je connais un autre professeur
"petit" aussi ? qui pense comme moi : http://www.marianne2.fr/Haute-trahison_a78911.html
http://www.debout-la-republique.fr/intervention-d-Anne-Marie-Le.html
Ensuite, je nai jamais prédit
et encore moins voulu une guerre civile : jai seulement souligné quun
pouvoir qui impose brutalement à un peuple lexact contraire de ce que ce même
peuple vient de décider clairement par référendum, sur un point fondamental du
fonctionnement de la République, ce pouvoir à tendance tyrannique,
effectivement, prend le RISQUE dune guerre civile, je dis quil mérite une
insurrection, oui (même si celle-ci naura sans doute pas lieu). Résumer cette
évidence en disant que je veux la guerre civile ou que je la prédis, cest de
la diffamation ; cest rendre responsable de lincendie celui qui appelle
les pompiers. Cest ce que jappelle, à lécrit, une « machine à
salir » (et à loral, un canon à m.).
Donc, en me taxant
danti-américanisme, danti-élite, et danti-européanisme, vous fabriquez de
toutes pièces un diable qui nexiste que dans vos cauchemars
caricaturaux ; la réalité est plus nuancée ; toute vigilance nest
pas fatalement paranoïaque, et lexistence de quelques paranoïaques avérés ne
fait pas de tous les citoyens vigilants des paranoïaques.
La caricature des thèses
adverses nest-elle pas un aveu déchec à les réfuter correctement ?
_______________________________________________________________________
Dune façon plus générale et
plus importante, au-delà du libre débat nécessaire sur le 11 septembre, je
revendique le droit POUR TOUS de dire et de faire connaître les PENSÉES
DISSIDENTES en vue dun débat éclairant qui montrera sans doute la faiblesse
ou même linanité dune thèse ou dune autre.
Je ne revendique là rien dautre
que liségoria, ce « droit de parole pour tous, à tout propos et à tout
moment » que les Athéniens tenaient pour linstitution CENTRALE dune démocratie
authentique : les vrais démocrates, par des institutions appropriées,
protègent les pensées dissidentes comme un rouage décisif qui dévoile toutes
les intrigues et protège la démocratie elle-même, alors que les oligarques
interdisent et pourchassent les pensées dissidentes pour des raisons que chacun
peut deviner.
À propos de liberté dexpression, le mot « négationnisme » semble
être le redoutable successeur du mot « blasphème », avec la même
mission de fustiger des paroles radicalement interdites ; aux antipodes,
donc, de liségoria et de la liberté dexpression chère aux vrais libéraux. Je
naime pas le concept même de « négationnisme » qui impose une pensée
officielle, interdit le débat et laisse présager une future police de la
pensée. La réflexion de Noam Chomsky sur ce point est littéralement
passionnante, je trouve.
Cest par cette porte-là,
dailleurs, que je me suis intéressé au cas du 11 septembre : situation
révélatrice, emblématique, de la difficulté pour les pensées dissidentes à se
faire simplement respecter dans nos prétendues « démocraties ».
Les commentaires de Paul et
dEntada (28/9, juste après minuit) et celui de Jean-Luc Guilmot (28/9, 9h4)
sont vraiment très intéressants.
Je rappelle que jattends toujours
de ce blog la réponse à mes questions précises sur lUnion européenne.
Par exemple :
***************************************
Comment J4M et ceux qui pensent
comme lui justifient-ils la CONFUSION DES POUVOIRS qui règne à lévidence dans
les institutions quils défendent aussi bien dans les institutions européennes
que dans les institutions françaises ?
***************************************
Les libéraux qui discutent ici
devraient aimer les pensées dissidentes on a envie de dire « par principe »
, au lieu de les pourchasser. Cest à ny rien comprendre. Sont-ils vraiment
libéraux ?
Ont-ils lu les penseurs libéraux
(les vrais, pas les anti-libéraux que sont, en fait, les
« néo-libéraux »), ceux qui se méfiaient comme de la peste de lÉtat
Léviathan et de TOUS les pouvoirs à cause de leurs ABUS inévitables (ils sen
méfiaient radicalement sans quon les traite pour autant de conspirationnistes,
jinsiste) ? Ont-ils lu Locke, Rousseau, Montesquieu, de Staël, Constant,
Alain, Orwell, Aron, Rawls, Rosanvallon, Castoriadis, qui, tous, dénoncent la
confusion des pouvoirs comme source mère de la tyrannie ?
Nest-il plus indispensable, selon
vous, de dénoncer toute confusion des pouvoirs ?!
Pas de réponse sur ce blog.
Je narrive pas à trouver ici
déclaircissements sur les « PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES » qui,
ce me semble, permettent à des organes non élus de nous imposer sans contrôle
ce que jappelle, moi, cest plus clair, des « lois sans
parlement » :
À mon sens, et jusquà ce quon
mait démontré le contraire, DANS LES INSTITUTIONS DE LUNION EUROPÉENNE, LES
MINISTRES ET PRÉSIDENTS ACCUMULENT LES POUVOIRS EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF
SUR UNE SÉRIE DE DOMAINES CACHÉS AU PUBLIC sous le nom trompeur de
« procédures législatives spéciales » (art. 289 §2 TFUE pour le
principe ; les autres articles sont disséminés (cachés) dans le TFUE) et
d« actes non législatifs » (exemples : art. 24 TUE, ou art. 290
TFUE). Les ministres agents exécutifs, en principe se rassemblent en un
« Conseil » en oubliant curieusement de préciser que cest un
conseil de MINISTRES et se déclarent carrément co-LÉGISLATEURS (art. 16 TUE).
Ces violations caractérisées du
principe essentiel de la séparation des pouvoirs révèlent une dérive considérée
par la Déclaration des Droits de lHomme elle-même (art. 16 DDHC) comme la
marque la plus sûre du retour à la tyrannie : des pouvoirs non séparés
sont des pouvoirs à la merci des puissances privées du moment.
Pour des exemples sur ces discrètes « lois sans
parlement », voir http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Citoyens_d_Europe_Contre_le_Regime_Illegitime_references.pdf pages 3, 4 et 5.
Je sais que je me trompe peut-être
par endroit, comme vous il ny a pas de honte à se tromper,
heureusement : qui donc ne se trompe jamais ? , cest même pour le
vérifier que je vous interpelle, mais je ne me contente pas dune insulte pour
changer davis : montrez-moi calmement où je me trompe et je serai
heureux, sincèrement, de progresser, je ne demande que cela.
Enfin, pour ce qui concerne
laccusation danti-américanisme, on croirait à une blague : je suis marié
à une américaine (dont le père, accessoirement, fut blessé à Omaha Beach) et
une partie de ma famille vit en Amérique du Nord
Pas la peine den rajouter,
vous semblez avoir « une boîte à diables » et vous y collez tous ceux
qui vous contrarient. Certes, je dénonce une administration US bien précise,
cupide et cynique, qui multiplie les crimes contre lhumanité, cest pourquoi
je dis et je maintiens que la vie humaine na clairement aucune importance pour
eux, ce sont leurs actes pas des théories qui me le prouvent tous les
jours, mais cela na rien à voir avec un anti-américanisme général, en tout cas
si on juge mes propos de bonne foi.
Les généralisations de cette note
sont donc trop caricaturales et donnent une mauvaise image de leur auteur. Une
image fausse dailleurs, jen suis sûr, car personne n'est noir ou blanc et J4M
est souvent intéressant, sur dautres sujets.
Ça me rappelle ce que jécrivais
aux journalistes en 2005, et qui vaut encore tout à fait
aujourdhui : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/LettreAStephanePaoliEtBernardGuetta.pdf
Sans rancune.
Étienne.
Pour un résumé des observations
qui me conduisent à considérer lUnion européenne comme un régime profondément
ILLÉGITIME, et pour une PROPOSITION de résistance, concrète et libre :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/08/93-manifestations-obstinees
Pour un aperçu des pensées qui
mintéressent et un peu mieux me connaître moi, le diable hideux que vous
étiquetez « rouge/brun/vert »
et bientôt antisémite ? , vous
pouvez consulter ma page En vrac : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.pdf et bien sûr ma revue de presse quotidienne
Liens et documents utiles depuis trois ans : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf
Je suis un admirateur dAlain
cétait lui aussi un professeur de lycée ; "petit prof" à vos
yeux ? et je reproduis ci-dessous un propos qui discrédite assez bien
linterdiction de douter que certains ici voudraient imposer aux simples
citoyens en les traitant aimablement d« escadrille de crétins ».
On pourrait intituler cette
réflexion (dont lintérêt va crescendo) :
« Le citoyen a le devoir de penser librement, car les droits des
citoyens crédules sont comme abolis. Obéissez, mais nobéissez pas sans
contrepartie : sachez douter, refusez de croire.
Nacclamez point : les pouvoirs seront modérés si seulement vous
vous privez de battre des mains. »
Discours de l'instituteur. « Mes
chers enfants, puisque le pouvoir aujourd'hui nous écoute, je veux rassembler
en peu de mots ce que j'ai eu occasion de vous dire concernant la politique. Le
premier article, le plus ancien, le mieux connu, est qu'il faut obéir aux
pouvoirs, j'entends de bonne volonté, sans restriction, et au mieux. Cela va
loin. Obéir aux lois d'abord, mais encore exécuter promptement les ordres
reçus. Soit dans l'inondation, soit dans l'incendie, et surtout dans l'état de
guerre, il y va de la vie peut-être ; mais je ne vois point de pouvoirs
possibles sans cela, ni d'action commune possible sans cela. Le serment d'obéir
doit donc être souvent renouvelé dans vos curs. Quand il serait renouvelé
publiquement chaque année, je verrais là une belle fête. À tes ordres, César. »
Il est bon de dire que l'homme qui parlait ainsi avait un bras de moins, avec
la renommée d'un fantassin irréprochable. Son discours ne sonnait pas creux.
L'homme sans peur et sans reproche
avait encore quelque chose à dire. « Il faut, dit-il, une contrepartie. Ce
contrat entre les citoyens et le pouvoir ne peut être ainsi fait que l'un ait
tous les droits et que l'autre n'en ait aucun. Ne discutons pas sur le droit
d'agir, de posséder, de louer son travail, de le refuser, même d'exprimer ce
que l'on pense. Ces droits, de même que le droit d'élire, de critiquer, de
contrôler, sont réglés par des lois qui sont mieux que passables. Mais je
laisse ce détail pour en venir à l'essentiel qui est le devoir de penser
librement. Dès que le citoyen est crédule, tous les droits sont comme abolis.
Il ne faut point croire. Cela est très pénible de ne point croire ce que dit un
homme éloquent et qui occupe la plus haute place. Mais comprenez aussi qu'un
tel homme plaide toujours pour lui-même, qu'il est juge et partie, qu'il est
entouré de flatteurs, qu'enfin il exerce le pouvoir, chose enivrante,
aveuglante. Il sera trompé, il se trompera lui-même. L'histoire des peuples,
comme je vous l'ai montré, est l'histoire des erreurs où tombe naturellement
tout pouvoir qui gouverne aussi les pensées. Donc examinez, instruisez-vous,
écoutez les uns et les autres. Dans les cas difficiles, sachez douter.
L'opinion règne toujours ; elle se fait sentir par le vote, mais bien
avant le vote. Chacun de vous est partie de l'opinion et modérateur du pouvoir.
Le muet refus de croire y suffit.
« Encore un mot là-dessus,
mes amis. N'acclamez point. L'acclamation vous revient et vous prend au cur.
L'acclamation a fait tous les maux de tous les peuples. Le citoyen se trouve
porté au delà de son propre jugement, le pouvoir acclamé se croit aimé et
infaillible, toute liberté est perdue. Le lourd devoir d'obéir n'est plus
limité ni tempéré par rien. Je décris ici des murs nouvelles; je vous trace un
pénible devoir. Mais, mes amis, si l'on veut être libre, il faut le vouloir. Et
n'oubliez jamais que les pouvoirs seront modérés, prudents, circonspects,
préservés à jamais de l'infatuation, raisonnables enfin, et ménagers de vos
biens et de vos vies, si seulement vous vous privez de battre des mains. »
Le plaisant est que le pouvoir le
plus ombrageux ne peut rien trouver à reprendre dans ce discours ; mais il
bouillonne à l'entendre ; il voudrait appeler ses gardes ; il espère,
il appelle de tout son cur la désobéissance, cette autre garde des rois.
Alain, 8 décembre 1923.
===================
Source : Alain, « Éléments d'une doctrine
radicale », propos choisis de 1906 à 1924,
http://classiques.uqac.ca/classiques/Alain/elements_doctrine_radicale/elements_doctrine.html
Alain contre la proportionnelle, scrutin injuste qui
abandonne le pouvoir aux partis
(20 septembre 2008) (Lien)
Pendant
que je vis, chaque jour je lis Alain et
cest pour moi une source claire dintelligence pure ; à lire cet
homme, comme à lire son extraordinaire élève Simone Weil, jai limpression de grandir.
Je vous propose ici quatre Propos sur le mode de scrutin,
tout à rebours de lair du temps qui réclame aujourdhui la proportionnelle
comme un retour à la justice élémentaire, où Alain souligne que la
proportionnelle abandonne les citoyens aux luttes intestines des partis.
Chaque mot compte dans les Propos dAlain, tout y est à la fois léger
et dense, plaisant et puissant, sujet à réflexion.
Alain tenait à choisir un homme plutôt quun programme ; un
homme vertueux (travailleur et honnête), un homme lui-même contrôlé par ceux
quil représente.
(Les titres sont de moi.)
Entre le plébiscite et le référendum, une voie moyenne :
des députés indépendants des partis et le contrôle permanent des pouvoirs.
Le
plébiscite consiste à demander au peuple : « Quels maîtres voulez-vous ? Voici un exposé de leurs principes, quant à la police, quant
à la guerre, quant à la consommation, quant à la production ; réfléchissez et
choisissez. Après cela, vous donnerez un long crédit aux maîtres que vous aurez
choisis ; ils pourront légiférer et gouverner en regardant au loin, comme de
bons pilotes, au lieu d'être arrêtés à chaque instant par les réclamations des
uns et des autres. » Ainsi vivent tous les pouvoirs monarchiques ou
oligarchiques ; car tous les citoyens ne
sont pas malheureux en même temps, et les abus de pouvoir, si l'on n'y remédie
sur l'heure, sont bientôt oubliés ; par-dessus tout le citoyen
hésite devant une révolution qui est, dans un tel système, son unique
ressource. Ajoutons que ce pouvoir fort a bientôt fait de rafraîchir les têtes
chaudes et de bâillonner ceux qui parlent trop ; l'oubli vient ainsi avant
que la réflexion s'éveille. Aussi la tyrannie, avec un peu d'adresse et de
bonheur, peut durer longtemps.
Le référendum est un système tout à fait
opposé à celui-là, car les pouvoirs ne font alors qu'appliquer les lois; ils ne
sont que magistrats. Rien ne peut être changé dans les droits et les devoirs
sans que le peuple soit consulté. Par exemple la
solution du conflit entre la Marne et l'Aube serait demandée au suffrage
universel ; la formule des assurances ouvrières et paysannes, de même ; le plan
de notre action au Maroc, de même. Et l'on saisit sans peine pourquoi ce système est impraticable. Chaque citoyen devrait
passer son temps à lire, à calculer, à discuter ; ou bien alors il devrait
juger d'après l'expérience, je dis son expérience à lui ; mais les
répercussions d'une loi sur les fraudes ne se font sentir à tous les citoyens
qu'après un long temps ; et elles sont perdues presque toujours dans la masse
des faits. Pour le problème marocain, c'est encore plus évident.
Ajoutons que le contrôle des gouvernants par les gouvernés,
qui est ce à quoi le peuple tient le plus, et ce qu'il réclamerait certainement
par voie de référendum, ne peut s'exercer par le référendum même. [Ah bon ? ÉC]
Entre plébiscite et référendum, il faut donc choisir quelque système
intermédiaire ; et l'on est ramené au parlementarisme, dans lequel les représentants
du peuple exercent un contrôle sans limite sur les actes du pouvoir, et
aussi prononcent sur les réformes, en tenant compte à la fois de leurs
connaissances propres et de l'opinion de ceux qu'ils représentent. Par ce
mécanisme, qui suppose une familiarité et des échanges continuels d'idées entre
les électeurs et l'élu, le peuple ne choisit pas ses maîtres ; il fait bien
mieux, il règle, il modère, il redresse l'action des maîtres qu'il a, quels
qu'ils soient.
C'est pourquoi le
caractère du député, ses habitudes de travail, sa clairvoyance, son
indépendance sont le principal, une fois que le principe de la souveraineté du
peuple est posé et maintenu. S'il s'agit de mettre au jour quelque
friponnerie d'administration, un modéré, s'il n'est ni ignorant, ni faible, ni
dépendant, vaut assurément mieux qu'un paresseux, un craintif, un sceptique, un
prodigue, un brouillon qui aurait l'étiquette radicale. Et si, dans ma circonscription, mon candidat n'étant pas élu, l'élu
est un homme intègre et qui travaille, je suis représenté tout de même ; car si
je connais un abus de pouvoir ou quelque gaspillage dans l'administration, je
saurai à qui m'adresser. Voilà pourquoi je veux que l'on considère plutôt le
caractère d'un homme, sa probité et sa puissance de travail, que le parti
organisé dont il aura reçu l'investiture.
30 juin 1911.
Mon commentaire :
Et comment
contrôle-t-on les contrôleurs ? Qui juge et punit les parlementaires eux-mêmes
? Si ces contrôleurs écrivent eux-mêmes leur code de conduite la
Constitution, nous sommes perdus.
Par ailleurs, je
ne partage pas cette conviction dAlain que le peuple ne peut pas contrôler ses
élus par référendum. Linstruction et les moyens de communication ont beaucoup
progressé et ce qui était impensable hier semble devenu possible et même
souhaitable aujourdhui. Cependant, les termes de lalternative posés par Alain
restent dune pertinence lumineuse. Jaime lire cet homme.
Contre la proportionnelle, scrutin injuste.
Quand ils ont dit que la Proportionnelle est juste, ils
croient avoir tout dit. Et je vois bien une espèce de justice au premier moment,
c'est-à-dire quand on nomme les députés ; mais encore faudrait-il y regarder de
près. Si l'électeur est moins libre et moins
éclairé dans son choix, est-ce juste ? Si les comités départementaux ont tout
pouvoir pour imposer tel candidat et surtout pour en éliminer un autre, est-ce
juste ? Si un homme droit et sûr prête son appui, par nécessité, à des
ambitieux aussi riches d'appétits que de talents, mais de pauvre caractère,
est-ce juste ? Si un ferme et libre esprit ne peut être élu qu'en traitant avec
un parti, est-ce juste ? Si les partis ainsi organisés ont presque tout pouvoir
pour échapper à la pression des électeurs, et tromper leurs espérances, est-ce
juste ? Si l'élite, déjà si puissante, se trouve fortifiée encore par ce
nouveau système électoral, est-ce juste ? Si l'influence des politiciens sur
les vrais amis du peuple, déjà trop forte, s'exerce alors irrésistiblement, par
les délibérations et les votes à l'intérieur du parti, est-ce juste ? Et enfin,
si l'écrasement des minorités est injuste dans la circonscription, par quel
miracle devient-il juste au parlement ? Car il faut bien que l'on décide enfin,
et que la majorité l'emporte. En somme, quand vous dites que la
Proportionnelle c'est la justice, j'ouvre bien les yeux, car j'aime la justice,
mais je ne comprends rien, je ne perçois rien de ce que vous annoncez.
En revanche, il y a
quelque chose que je comprends très bien et que je perçois très bien, c'est que
les opinions pour et contre la Proportionnelle correspondent à des opinions très
bien définies concernant l'avenir de la République. Car les uns, qui sont
l'élite, et que je reconnaîtrais presque au port de la tête, craignent
par-dessus tout ce qu'ils appellent la démagogie et les intérêts de clocher.
Ils veulent qu'en toute chose, armée, impôts, travaux publics, ce soient les
compétences qui décident ; ils veulent que la grande politique, qu'ils
appellent nationale, échappe tout à fait au contrôle des petites gens, pour qui
vivre de leur travail et s'assurer contre les risques est la grande affaire.
Enfin ils se défient de l'électeur. C'est contre l'électeur qu'ils ont inventé
la Proportionnelle, et l'invention est bonne.
Les autres savent trop, par trop d'expériences, ce que
devient la volonté populaire lorsqu'elle se heurte à l'action continue des
grands Ambassadeurs, des grands Banquiers et des grands Bureaucrates. Ils
savent trop comment les députés cherchent trop souvent autour d'eux, dans ce
milieu parlementaire qui a ses préjugés propres, un appui contre l'électeur, et
de beaux prétextes pour oublier leurs promesses. Ils savent que les grands
intrigants sont déjà assez forts, et disposent déjà trop des réputations et des
influences ; que l'air parisien est déjà assez mauvais et dangereux pour les
provinciaux même les plus rustiques ; et qu'enfin le scrutin d'arrondissement
est la meilleure arme de la province contre l'élite parisienne. Prise ainsi, la
question est assez claire, il me semble. Et c'est parce que ces raisons
commencent à se dessiner dans le brouillard, que cet accord apparent de la
plupart des députés recouvre en réalité des divisions profondes et une
résistance formidable.
14 juillet 1914.
Mon commentaire : Daccord, MAIS, même avec le scrutin
darrondissement, les élections législatives restent une révoltante
escroquerie. La raison en est que tout scrutin, sil est dévoyé par les
intrigues partisanes, devient un scrutin détestable malgré toutes ses belles
promesses. Je continue à chercher, chez ce penseur exceptionnel quest Alain,
des traces de mon idée centrale « ce nest pas aux hommes au pouvoir
décrire les règles du pouvoir. »
Dans la même veine, il y a cet autre propos, excellent lui aussi :
Un bon scrutin permet de contrôler, de blâmer et de
détrôner tous les pouvoirs.
Le scrutin proportionnel, lui, offre un droit fictif et ne permet pas
davantage que de choisir un tyran parmi plusieurs tyrans.
Je vois que la Ligue des Droits de l'Homme, dans son
bulletin, recommande des cartes postales « proportionnalistes ». Il est
remarquable que tant de Républicains éclairés se soient laissés prendre par les
mots. Pour la Justice, pour le droit de l'électeur, ce beau programme devait
plaire à la Ligue. Un homme raisonnable me disait encore il n'y a pas longtemps
: « Je suis Proportionnaliste tout simplement parce que je veux conquérir
mon droit d'électeur. Je suis républicain, et assez décidé ; j'appartiens à une
circonscription où le royaliste est élu tous les quatre ans, sans lutte possible.
Que je vote ou que je ne vote pas, le résultat est, le même ; je demande
seulement que mon suffrage ne soit pas perdu ». Raison de belle apparence,
mais qui ne me frappe point.
Voter, ce n'est pas
précisément un des droits de l'Homme ; on vivrait très bien sans voter, si l'on
avait la sûreté, l'égalité, la liberté. Le vote n'est qu'un moyen de conserver
tous ces biens. L'expérience a fait voir cent fois qu'une élite gouvernante,
qu'elle gouverne d'après l'hérédité, ou par la science acquise, arrive très
vite à priver les citoyens de toute liberté, si le peuple n'exerce pas un
pouvoir de contrôle, de blâme et enfin de renvoi. Quand je vote, je n'exerce
pas un droit, je défends tous mes droits. Il ne s'agit donc pas de savoir
si mon vote est perdu ou non, mais bien de savoir si le résultat cherché est
atteint, c'est-à-dire si les pouvoirs sont contrôlés, blâmés et enfin détrônés
dès qu'ils méconnaissent les droits des citoyens.
On conçoit très bien un système politique, par exemple le
plébiscite, où chaque citoyen votera une fois librement, sans que ses droits
soient pour cela bien gardés. Aussi je ne tiens pas tant à choisir
effectivement, et pour ma part, tel ou tel maître, qu'à être assuré que le
maître n'est pas le maître, mais seulement le serviteur du peuple. C'est dire
que je ne changerai pas mes droits réels pour
un droit fictif.
Or la Proportionnelle m'offre un droit
fictif, qui est de choisir pour mon compte, entre trois ou quatre Partis, quel
sera le Parti-Tyran. Mais que ce soit selon mon choix ou selon un autre, le Parti-Tyran
sera toujours tyran, et mes droits seront toujours diminués. Dès que le député dépend plus d'un journal ou d'un comité,
et moins de l'électeur, la liberté est menacée. Je dis la liberté de tous. Car
si je suis radical, et si les radicaux sont les maîtres, j'aurai bien quelques
faveurs si je les demande ; mais je n'appelle point cela liberté. Ce que j'appelle liberté, c'est la dépendance
étroite de l'élu par rapport à l'électeur. C'est d'après cela seulement que je juge un système électoral. En termes
bien clairs, il s'agit pour moi d'empêcher que les riches ajoutent le
pouvoir politique au pouvoir économique qu'ils ont déjà. Or, avec les
Partis et la Haute Politique, je suis assuré que les riches gouverneront.
Tandis qu'avec notre système, et les perfectionnements qu'il peut aisément
recevoir, comme limitation des dépenses électorales et secret du vote, nous
arriverons à tenir en bride les Grands Politiques, et les Hommes d'État
impatients qui ne parlent que de restaurer l'autorité. Merci du cadeau. Le
meilleur des rois ne vaut rien.
6 décembre 1912.
Source de ces trois premiers 'propos' : « éléments dune doctrine radicale »
Nécessaire indépendance des députés à légard des
partis.
Tout contribue à jeter le chef dans de folles entreprises.
Lélection ne vaut pas contrôle.
Autant quun député juge à la manière dun arbitre, et sans
considérer un parti ou lautre, le peuple est libre, aussi libre que la
condition humaine le permet. Ce qui aura semblé nécessaire, utile, ou permis,
au plus grand nombre de ces arbitres sera tenu pour tel, et très raisonnablement.
Il nen sera plus de même si le député considère
les partis. Car, si laccusé, ici le ministre, est un des chefs de son
propre parti, il le soutiendra peut-être sans trop examiner, en vue de se
rapprocher de la tête. Si laccusé est soutenu par lautre parti, encore bien
mieux notre homme imaginera quelque ministère pour lui-même ou pour ses amis. Dans tous les cas il combattra comme soldat dune
armée ; il combattra au lieu de juger. Cest ce quon voit toujours à
quelque degré, car rien nest parfait ; mais le degré est ce qui importe. Supposez quun puissant parti occupe le pouvoir, et
paraisse en mesure de punir les indisciplinés et les traîtres par une exclusion
efficace, tout contrôle est rendu impossible et la liberté est perdue.
Les choses ne seront jamais tout à fait ainsi, parce que nul
système électoral ne détournera tout à fait le peuple de disloquer les partis
et de choisir des hommes. Mais il faut convenir que le système des listes, qui
vise toujours à écarter les isolés, nuit au contrôle et donne plus de liberté
aux pouvoirs quels quils soient. Vouloir que le chef aime le scrutin
darrondissement, cest trop demander. Les hommes font voir ici une
clairvoyance admirable. Observez les opinions, et vous remarquerez quelles
dépendent des fonctions. Tout homme qui détient une parcelle des pouvoirs,
quand ce ne serait quun chef de bureau, est pour le scrutin de liste et contre
le scrutin darrondissement. Aux yeux de celui qui nest point du tout chef, la
proportionnelle est suspecte en ceci quelle suppose des listes et des partis.
Par la même raison tous les tyrans, grands et petits, tiennent pour la représentation
proportionnelle. Les socialistes ne sont pas loin de le comprendre, mais
seulement par les effets, et non point par les causes ; sans compter quils
sont aisément un peu tyrans, et de bonne foi. « Si jétais roi », telle est
leur chanson.
Si
tu étais roi sans contrôle, tu serais un mauvais roi. Il nest point de sagesse
qui ne suse à exercer le pouvoir.
Limportance, une pointe toujours dentêtement, les difficultés réelles,
lexcès même du travail et le poids de mille affaires, enfin la mécanique du
pouvoir, qui est ladministration, tout
contribue à jeter le chef en de folles entreprises. Je le suppose
honnête, attaché au bien public, amoureux de la vraie gloire ; cela ne changera
rien. Et pareillement je suppose que ceux qui lont choisi soient réellement le
plus grand nombre, cela ne changera rien si ceux qui lont choisi nont pas le pouvoir de le modérer. Que les femmes
votent, cela ne changera rien. Mais au contraire, soit que les hommes votent
seuls, soit que les femmes sy joignent, et que les chefs de famille aient
plusieurs voix ou non, pourvu que le député
soit tenu par les électeurs et non par les partis, le pouvoir sera tenu de dire ses secrets,
dexposer ses projets, détaler ses comptes ; et tout ira passablement.
12 janvier 1924.
Source de ce dernier 'propos' : « Alain, Propos sur les pouvoirs », propos choisis et classés par Francis
Kaplan, Folio Essais n°1, 1985, p. 232.
Voyez aussi ALINALIA, le site des amis d'Alain : http://alinalia.free.fr.
Vous
pouvez réagir sur ce billet du blog :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/09/20/95-alain-contre-la-proportionnelle-scrutin-injuste-qui-abandonne-le-pouvoir-aux-partis
Laffaire DANON, révélatrice de lescroquerie
antidémocratique quest lUnion européenne, conçue par et pour les industriels
et les banquiers, contre les citoyens, contrairement aux apparences trompeuses
(12 mai 2008) (Lien)
Jai rencontré Jacques
Danon deux fois, et la position de lUE sur son combat contre les
multinationales de lassurance (cest vraiment David & Goliath) est
à la fois révoltante et emblématique ; nous devrions tous être interpellés
par le sort que lui réservent les institutions de lUnion européenne, cela
narrive pas quaux autres. Sa solitude pourrait bien être prochainement la
nôtre. Voyez son blog, il est bien fait.
Voici un mail récent que ma
envoyé une des personnes qui se battent à ses côtés, qui insiste sur quelques
points particulièrement choquants de laffaire DANON :
|
Bonsoir
Étienne
Jai écouté
très attentivement hier soir lune de vos interviews datée du mois de janvier
dernier qui se trouve sur votre blog. Vous dites, avec raison, que lEurope
nest plus une démocratie, que les puissances financières font la loi, que le
droit nexiste plus
Laffaire
emblématique de Jacques illustre tellement bien ce que vous dites : les
puissances financières qui dictent leurs lois, le droit qui nest soumis quà
leur arbitraire.
Vous avez
dit que lEurope est une fausse démocratie imposée en douce pour le compte
dune oligarchie et que les institutions de lUnion européenne ont été
voulues par les banquiers.
Par
rapport à vos considérants sur le comportement antidémocratique de lUE, laffaire
de Jacques offre une opportunité unique dexpliquer et de démontrer de façon
vivante et concrète comment les institutions européennes fonctionnent et que
limage de protection et de démocratie nest quune façade et quils sont
complètement déconnectés de leurs citoyens.
La
pièce maîtresse :
Sur ce blog, je me permets
dattirer votre attention toute particulière sur un document incroyable
(Novas) (annexe 1, en attache) qui démontre que loligarchie
financière sapproprie en toute impunité la puissance publique de lEurope en
se prévalant des Commissaire européens, de la Commission européenne, du
Parlement européen et de son Président et des députés européens contre une
victime européenne devant la justice suisse, justice qui accepte ces
écritures, se transformant ainsi en tribune des institutions de lUE contre
des citoyens de lUE ! ! ! ! ! !
La même philosophie est renouvelée par la suite dans la
presse suisse transformant les Danon, en ennemis des relations bilatérales
entre la Suisse et lUE (comme amplement démontré sur le site de la Ligue
des Droits de lHomme belge).
Lappel
au secours à lEurope passe par le seul moyen qua le citoyen, à savoir le
droit de pétition.
Les
Danon demandent secours et protection auprès des Institutions européennes qui
leur doivent protection.
Comment est traitée au Parlement européen
une pétition qui dérange loligarchie financière :
Le 14 février 2006, la pétition déposée le 22
septembre 2005 est déclarée recevable par la commission des pétitions du
Parlement européen. (annexe
2, en attache).
Cette pétition met en avant que pour avoir eu le courage
de faire valoir leurs droits pendant près dun quart de siècle, les Danon,
ont été punis et leur affaire transformée en une affaire dEtat en
utilisant, en toute impunité, les institutions de lUE contre eux, mais bien
pire encore, ils ont vu disparaître illégalement, arbitrairement et à leur
insu leur outil de travail de 25 ans et détruits, leurs intérêts économiques
vitaux et leur réputation équivalant à une mort économique et sociale. Leurs
avocats belges ont souligné le fascisme économique dont ils font lobjet.
Un éminent Professeur de droit bancaire suisse a conclu dans un avis de droit
boycott.
(Comme
vous le dites si bien Étienne, lEurope ne connaît plus le droit.)
Au
mois de juin 2006, lors dune audition au Parlement européen, le
comité des pétitions décide de convoquer la Winterthur devenue AXA
Winterthur, ainsi que la Suisse à laudition du mois doctobre 2006.
Au mois daoût 2006, AXA Winterthur essaye, par le biais de la justice belge
dobliger les Danon à retirer leur pétition.
Le 4 octobre 2006, la
pétition (soutenue par la Ligue belge des droits de Homme) qui mettait en évidence
les violations au droit international public, aux droits fondamentaux, aux
traités internationaux, et qui demandait la protection des Danon de la part
de lUE, est clôturée à lunanimité, en violant à lunanimité le
droit dêtre entendu sur leurs moyens de défense présentés par les
avocats belges
Par le
suite, soutenus par des députés européens, par la Présidente de la Sous
commission des droits de lHomme du Parlement européen, ainsi que par la
Ligue belge des droits de lHomme, les Danon demandent, comme ils en ont le
droit, la réouverture de cette pétition. Celle-ci leur est refusée.
Le 31
janvier 2007, la Présidente de la Sous Commission des droits de lHomme du
Parlement européen donne une conférence de presse sous le titre :
Affaire
Danon: Violations des droits fondamentaux et atteinte aux accords bilatéraux
UE-Suisse
Voir document en annexe 3 en
attache.
Le service de presse des Verts du Parlement européen lance
des centaines dinvitations à toute la presse européenne écrite et parlée.
Seuls les journalistes de la presse suisse, plutôt agressifs, se présentent,
ainsi que AXA Winterthur accompagnés dun
huissier
. ! ! ! ! !
Finalement les Institutions européennes se sont
pliées aux desiderata de loligarchie financière
au détriment de victimes européennes.
Cest
là où cette histoire des Danon, qui concerne aussi tous les citoyens de lUE,
démontre avec force le bien-fondé de votre analyse de lEurope que
jai pu entendre dans votre interview.
Merci
pour votre attention, je vous appelle tout prochainement,
Courtoises
salutations,
MP
|
Il me semble que nous devrions
nous montrer solidaires des Danon.
Ce cas est exemplaire.
Message collectif (email) : organisons partout des micro-résistances,
avec des MOCRIEs, Manifestations
Obstinées Contre le Régime Illégitime Européen,
à date et heure fixes dans toute lEurope
(13 avril 2008) (Lien)
Trets,
le 13 avril 2008, à 01:34.
Chers amis,
Contre les abus de pouvoirs
caractérisés que sont, à mon avis, tous les "traités constitutionnels",
je voudrais vous décrire une nouvelle idée pour résister au sabordage de la démocratie
par nos propres "représentants" : organiser partout une multitude de micro
résistances contre la source même de nos impuissances politiques :
1) Relier les signes alarmants
de lactualité à limpuissance politique des citoyens verrouillée par les
institutions ;
2) Concentrer nos protestations
sur lhonnêteté du processus constituant ;
3) Multiplier les micro
résistances à travers des manifestations hebdomadaires obstinées, le même jour
à la même heure, partout en Europe.
1) Les indicateurs alarmants sont nombreux qui
devraient nous inciter à contrôler tous les pouvoirs à tout moment :
Parmi les indicateurs
alarmants, on peut citer le crash financier majeur imminent, la dérive
policière des "démocraties" prétendument "libérales"
dans lesquelles même la torture pratiquée sur des citoyens incarcérés sans
procès et sans défense est autorisée et même encouragée au prétexte de "lutte
contre le terrorisme", lusage massif darmes nucléaires (des milliers
de tonnes de munitions à luranium) dans des pays écrasés par des guerres
contre dinsaisissables "terroristes", guerres déclenchées
sans que les peuples puissent linterdire, la prolifération exponentielle des
OGM sans moyen de résister, le sabordage des services publics au prétexte dune
dette fabriquée de toutes pièces par labandon de la création monétaire aux
banques privées, dette publique qui rend les prêteurs privés maîtres des
principales décisions publiques, labandon des peuples par leurs propres représentants
politiciens de métiers qui doivent trop leur pouvoir aux puissances
financières , les mécanismes de dérégulation à cliquet (à petits pas
irréversibles) qui dépouillent progressivement les États de leur droit
dinterdire le plus élémentaire (liberté de mouvement des capitaux imposée
par traité, AGCS négocié en secret, etc.), jusquaux constitutions !
écrites désormais directement par les présidents et leurs ministres et imposées
sans référendum !
La coupe est pleine et ça urge !
Il est temps que les citoyens reprennent le contrôle de leurs représentants.
Pourtant, les militants de tous
bords semblent mener leurs luttes sociales sans se préoccuper du tout de la
Constitution : ils luttent vaillamment sans
prêter attention aux fers que nous portons tous aux mains et aux pieds et qui
nous contraignent au plus haut niveau du droit.
Il me semble que toutes nos
luttes sociales sont vouées à rester de simples gesticulations sans effets
durables tant que des verrous institutionnels privent les citoyens du contrôle
des pouvoirs institués.
Lapparente indifférence des
militants sur ce point décisif métonne dautant plus que ces verrous, déjà
redoutables dans les droits nationaux, sont terriblement renforcés, pérennisés,
par les institutions européennes.
Ainsi, nous avons urgemment
besoin du référendum dinitiative citoyenne (RIC) que nous garantiraient
assurément dhonnêtes institutions. Et ce droit élémentaire,
les politiciens de métier ne nous le donneront jamais, pour la raison
simple que ce droit citoyen irait directement contre leur intérêt personnel en
les privant dune partie de leur pouvoir. Cest pourquoi je dis haut et fort
que ce nest pas aux hommes au pouvoir décrire les règles du pouvoir ;
ce nest ni aux parlementaires ni aux ministres ni aux juges décrire ou de
réviser la Constitution.
Doù cette idée, qui me semble
doublement originale :
2) Nous devrions nous concentrer sur lessentiel : lhonnêteté du processus constituant :
Il faudrait prioritairement protester contre lessentiel et, comme
je viens de le suggérer, il me semble que la source majeure de nos impuissances est lillégitimité
fondamentale des pouvoirs de lUnion européenne, conçue et
imposée par des exécutifs qui sont évidemment juges et partie dans un
processus constituant : ils sécrivent des règles pour eux-mêmes
et ça se voit partout.
Cette partialité au plus haut
niveau du droit est extrêmement dangereuse pour les libertés et on peut le
constater concrètement : ce qui est programmé grâce à lUE, cest limpuissance
politique des citoyens face au chômage, aux bas salaires, à la violence
économique et bientôt à la guerre, et labsence de contrôle public des
pouvoirs dans les domaines qui comptent le plus pour les industriels et les
banquiers : marché intérieur, concurrence, liberté de mouvement des
capitaux, droit fiscal et droit social, notamment.
Alors quune Assemblée
constituante désintéressée programmerait sans doute un véritable référendum
dinitiative citoyenne (RIC), rouage central du droit des peuples à
disposer deux-mêmes, qui nous
permettrait enfin, par exemple, dinterdire nous-mêmes, rapidement et sans
difficulté, à la fois les paradis fiscaux, les OGM en plein champ, les armes à
luranium "appauvri", la privatisation des services publics, le cumul
des mandats, la libre circulation des capitaux, labandon de la création
monétaire aux banques privées, et bien dautres fléaux dont, manifestement,
les politiciens de métier saccommodent fort bien malgré les souffrances des
citoyens.
La première
originalité de lidée que je vous propose serait donc de se concentrer très prioritairement sur la source même de
nos problèmes, cest-à-dire le processus constituant : il sagirait de
lutter contre le régime illégitime européen.
3) Une autre
originalité consiste à multiplier les micro-résistances et à protester toutes les semaines, le même jour et à la même heure, partout en Europe, par petits
groupes au début mais tout le temps et partout :
Ensuite,
deuxième originalité, plutôt que de faire une grande manif une fois tous les
six mois ou tous les ans, et puis plus rien jusquà la prochaine, avec une
frustration générale de ne rien pouvoir faire au quotidien, je propose de nous
inspirer de lexemple des Allemands de lest
et de leur idée, qui a très bien marché en 1989 (avec la chute du mur de
Berlin), et qui sappelait « les
manifestations du lundi » :
Nous
organiserions, modestement mais vaillamment, plein
de petites manifestations, un peu partout, dans tous les quartiers et villages
dEurope, le même jour à la même heure, toutes les semaines :
je propose le mercredi à 18 ou 19 h, mais il faut en parler entre nous, on fait
ce quon veut :o)
Ce serait un
rendez-vous régulier, facile à mémoriser et à
rejoindre par les nouveaux mécontents ou les nouveaux courageux, à
fréquenter sans peine puisque tout près
de chez nous, et permettant dêtre
nombreux même en nétant que 5 ou 10
personnes au même endroit puisque réunis un peu partout en
Europe au même moment, avec un site central et un forum par manif
pour faire connaître les initiatives et les infos utiles.
Ce serait
surtout le spectacle permanent dun mécontentent général
et persistant, mécontentement opiniâtre et
obstiné, pas résigné du tout, prêt à se cristalliser bientôt.
Ce serait des Manifestations Obstinées Contre Le Régime Illégitime Européen
(MOCRIE), régime imposé aux peuples européens par voie de
traités, sans Assemblée constituante ni Référendum.
Nota : pour permettre la cohabitation
pacifique de tous les résistants, je recommande de sinterdire tout étendard ou drapeau partisan dans
ces MOCRIEs : à lévidence, le clivage « gauche
droite » nous divise et nous affaiblit. Ce mouvement citoyen devrait
se concentrer sur lessentiel : rendre le contrôle des pouvoirs publics
aux personnes physiques.
Il semble que des initiatives
soient en train de naître dans le même esprit un peu partout en Europe.
Il y en a
déjà cinq qui sont apparues en France en quelques heures (voir
le blog) : ainsi, tous les
mercredis à 18h, à partir du 16 avril, il y aura
une petite MOCRIE à Trets, sur la place de la Mairie, une autre MOCRIE à
Lyon, place de la République, une troisième MOCRIE à Montpellier, une autre
MOCRIE à Rennes, place de la Mairie, et encore une à Nantes
(44000) devant le château de la Duchesse Anne
Vous aussi, nhésitez pas à créer votre propre petite MOCRIE,
tout près de chez vous, simplement.
Puis, venez nous en avertir ici :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/08/93-manifestations-obstinees
Si lidée vous
plaît, jai besoin de vous, évidemment, pour la faire connaître entre simples
citoyens et pour organiser les outils qui nous permettront de communiquer entre
nous. Je vais créer un site qui centralise les infos et qui offre
notamment un forum par MOCRIE, de façon à permettre aux participants de communiquer.
On verra si
cette graine didée est assez simple et assez forte pour survivre dans la tourmente
que vit en ce moment lidéal démocratique.
Amicalement.
Étienne.
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
De mon côté, je
propose ma première MOCRIE :
à TRETS (France 13530), le mercredi 16 avril
2008, à 18 h,
sur la place de la Mairie.
Je
vais préparer une banderole, avec dun côté
« CECRI : Citoyens
Européens Contre le Régime Illégitime,
contre des pouvoirs imposés par voie de traités et sans référendum »
et de lautre :
« MOCRIE : Manifestations
Obstinées Contre le Régime Illégitime Européen
toutes les semaines, le même jour à la même heure, partout en
Europe »
Les représentants
politiques des différents pays européens, tout en affirmant leur amour de la
démocratie, ont engagé depuis cinquante ans un processus constituant sans
les peuples quils sont pourtant censés représenter, et même parfois carrément
contre eux, comme en France et aux Pays-Bas où les élus imposent par
voie parlementaire ce que leur peuple vient de refuser expressément par
référendum.
Les reproches majeurs que nous faisons aux
institutions européennes (voir encadré page suivante), et notamment celui de
verrouiller partout limpuissance politique des citoyens, ne sont nullement
pris en compte par les élites politiques, médiatiques et économiques : la
démocratie imposée par nos élus est de plus en plus clairement factice.
Pourtant, les indicateurs alarmants
sont nombreux qui devraient nous inciter à contrôler tous les pouvoirs à tout
moment : le crash financier majeur imminent, la dérive policière des
"démocraties" prétendument "libérales" où
même la torture pratiquée sur des citoyens incarcérés sans procès et sans
défense est autorisée et même encouragée au prétexte de "lutte contre
le terrorisme", lusage massif darmes nucléaires (des milliers de
tonnes de munitions à luranium) dans des pays écrasés par des guerres contre
dinsaisissables "terroristes", guerres déclenchées sans que
les peuples puissent linterdire, la prolifération exponentielle des OGM sans
moyen de résister, le sabordage des services publics au prétexte dune dette
fabriquée de toutes pièces par labandon de la création monétaire, dette
publique qui rend les prêteurs privés maîtres des principales décisions
publiques, labandon des peuples par leurs propres représentants politiciens
de métiers qui doivent trop leur pouvoir aux puissances financières ,
jusquaux constitutions écrites désormais directement par les présidents et
leurs ministres et imposées sans référendum ! La coupe est pleine et ça
urge ! Il est temps que les citoyens reprennent le contrôle de leurs
représentants.
Nous, citoyens européens de
toutes tendances, attachés au droit des peuples à disposer deux-mêmes,
contestons solennellement le droit des responsables politiques à redéfinir
eux-mêmes leurs propres pouvoirs sans consulter directement les peuples
concernés. Les
élus ne sont pas propriétaires de la souveraineté populaire ; ils nont
pas de légitimité à modifier eux-mêmes les institutions.
Lexpression "traité
constitutionnel" est un aveu dabus de pouvoir : on nécrit pas les
constitutions par voie de traité. Ce nest pas aux ministres, ni aux
parlementaires ni aux juges décrire ou de modifier les institutions
européennes : seuls les peuples eux-mêmes, sur proposition dune
Assemblée constituante désintéressée, cest-à-dire dont les membres
nécrivent pas des règles pour eux-mêmes , seuls les peuples eux-mêmes ont
la légitimité politique de fixer et limiter les pouvoirs de leurs représentants,
par référendum, à lissue dun vrai débat public.
Au contraire, les
gouvernants européens profitent de leur pouvoir pour en abuser : le
processus constituant « par traités » rend les institutions
européennes très profondément illégitimes. Il nous semble important et urgent de
résister à cette dérive tyrannique et dorganiser cette résistance pour aussi
longtemps quelle sera nécessaire.
Un
souvenir : avant la chute du mur, les Allemands de lest manifestaient
tous les lundis à 18 h pour dire simplement : « le
Peuple, cest nous ». Ils étaient parfois une poignée, parfois des dizaines
de milliers, mais ils étaient toujours là, visibles.
Ce geste courageux de résistance
durable pourrait nous inspirer dans la lutte contre le processus despotique qui
se joue avec les traités inconstitutionnels européens : nous
pourrions, nous, institutionnaliser la résistance, autant que possible,
en multipliant les lieux où se manifeste le mécontentement :
Dans toutes les villes
dEurope où il existe des résistants déterminés, seraient organisées
DES MANIFESTATIONS HEBDOMADAIRES,
tous les mercredis à 18 h par exemple.
Lors de ces manifestations, on
pourrait médiatiser internationalement les principales initiatives citoyennes
du moment,
ce qui donnerait à ces initiatives de la visibilité, et donc de la force. Par
exemple :
la plainte de milliers de citoyens auprès
de la Cour européenne des droits de lhomme (CEDH) contre lÉtat pour
violation du droit à élire notre Corps législatif, plainte dorigine
citoyenne que soutient www.29mai.eu,
la pétition contre le parasitisme
financier, déchaîné par des institutions européennes complaisantes qui
interdisent aux États de gêner la libre circulation des capitaux,
pétition dorigine citoyenne que défend www.stop-finance.org,
la pétition pour lindispensable et très
populaire Référendum dInitiative Citoyenne (RIC), pétition et projet
citoyen développés par www.ric-france.fr,
etc.
Dans les grandes villes, cest même chaque
arrondissement (ou chaque quartier) qui pourrait organiser une telle manif
hebdomadaire, pour que chacun puisse sy associer souvent sans trop perdre de
temps en transport inutile ; il est dailleurs sans doute plus efficace
pour signifier quune colère générale gronde que les manifestations, même
petites, soient très nombreuses, un peu partout en Europe.
Un site web (un wiki ou un
spip pour permettre le travail collaboratif) centraliserait une carte
européenne des manifestations et récapitulerait les villes et les villages
européens actuellement en résistance affichée, ainsi que les meilleures initiatives
populaires (slogans, visuels, plaintes, actions, événements, manifestes,
images et textes
).
Est-ce cette petite graine didée saura
germer partout en Europe ? Je lespère :o)
Étienne
Chouard.
(8 avril 2008)
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/07/93-pour-des-manifestations-populaire-obstinees-mpo
Voyez, ci-après, la liste des principaux
griefs contre les institutions européennes, ainsi que les textes de
référence correspondants :
|
Liste des principaux malheurs programmés par les institutions
européennes,
institutions écrites sans les citoyens, et même
souvent contre eux :
a) Dabord et principalement, le chômage de masse est
incroyablement encouragé par les institutions européennes à travers une
politique monétaire contraire à lintérêt général : la lutte contre linflation
comme mission absolument prioritaire et intangible dune Banque centrale
européenne (BCE) rigoureusement indépendante des représentants du peuple
(art. 119, 130 et 282 §2 et §3 TFUE) est une priorité contestable fixée au
plus haut niveau du droit, donc inaccessible à tout revirement de lopinion
publique. Cette priorité qui navantage que les rentiers, imposée jusquà
nouvel ordre par les institutions européennes, entretient délibérément un
chômage massif et des bas salaires, ce qui présente lavantage pour
certains de rendre tout le monde très docile et ne profite quaux
plus riches. Ce seul point devrait conduire tous les salariés (91% de la
population active) dans la rue contre le dernier acte du coup dÉtat européen
quest le traité de Lisbonne.
b) Ensuite, et cest un vrai
hara-kiri financier, la
création monétaire est totalement abandonnée aux banques privées :
la constitution européenne (art. 123 TFUE) interdit aux banques centrales de
prêter de largent aux États [prêts qui permettraient un financement des
investissements publics sans subir la charge des intérêts]. Il est essentiel
de comprendre que cette interdiction impose aux États demprunter cet argent
avec intérêts ! aux acteurs privés qui ont de largent à placer
(pour senrichir sans travailler). Cette règle scandaleuse contraint les
États (cest-à-dire nous tous) à payer des intérêts ruineux pour
financer les investissements publics et à accumuler rapidement une dette
extravagante au regard de lintérêt général (plus de 40 milliards deuros
par an dintérêts pour la France) , alors que, si notre banque centrale pouvait
financer les équipements publics, les intérêts payés pourraient être
redistribués à la collectivité au lieu denrichir les
« investisseurs » privés. Non seulement elle nous ruine, mais en
plus, la dette publique (rendue inexorable par les institutions dans le
monde entier) verrouille au plus haut niveau du droit limpuissance de nos
représentants politiques, réduits au rôle de marionnettes dépendantes des
puissances financières. Cet autre vice majeur devrait suffire, à lui seul, à
alimenter une révolte générale.
c) Linterdiction
faite aux États de limiter les mouvements des capitaux (art. 63 TFUE) et la liberté détablissement (art. 49 TFUE)
ont privé les travailleurs de tout contre-pouvoir face à la démesure des
actionnaires, les livrant à la concurrence intégrale à tous
niveaux ; elles exposent nos économies à la spéculation effrénée,
aux crises boursières à répétition et bientôt à la faillite
générale. Après avoir maté les travailleurs, les financiers leur feront
bientôt payer la note, à travers leurs salaires et leurs impôts. Qui donc a
intérêt à cette liberté absolue des renards libres dans le poulailler
libre ? Sûrement pas lintérêt général. Encore un vice majeur dont
« lélite » ne veut pas débattre et qui devrait lever les foules
contre tous les « traités constitutionnels » européens.
d) La clause de défense mutuelle entre pays
membres de lUE ne met pas en cause les engagements souscrits au sein de
lOTAN (art. 42 §2 TUE). Cette clause, qui confirme lart. 5 du pacte
atlantique, soumet de
fait toute défense européenne à celle de lOTAN, puisque ce sont
les États européens les plus puissants militairement, économiquement et
politiquement qui ont la double appartenance. Cet assujettissement est
dautant plus grave que, dune part, lUE et lOTAN permettent aux États qui
en sont membre de sassocier pour des interventions ou des missions sur des «
théâtres extérieurs » et que, dautre part, les instances politiques et
militaires de lOTAN envisagent une restructuration de lAlliance, fondée sur
la possibilité de frappe nucléaire « préemptive » (en premier) et
léventualité dopérations engagées sans autorisation des Nations Unies
décidées par un simple consensus.
e) Les
Ministres et Présidents accumulent les pouvoirs exécutif et législatif sur une série de domaines cachés au public sous le nom
trompeur de « procédures législatives spéciales »
(art. 289 §2 TFUE pour le principe ; les autres articles sont
disséminés cachés dans le TFUE) et d« actes non
législatifs » (exemples : art. 24 TUE, ou art. 290 TFUE). Les
ministres agents exécutifs, en principe se rassemblent en un
« Conseil » en oubliant curieusement de préciser que cest un
conseil de ministres et se déclarent carrément co-législateurs (art.
16 TUE). Ces violations caractérisées du principe essentiel de la séparation
des pouvoirs révèlent une dérive considérée par la Déclaration des droits de
lhomme (art. 16 DDHC) comme la marque la plus sûre du retour à la
tyrannie : des pouvoirs non séparés sont des pouvoirs à la merci des
puissances privées du moment.
f) Les
exécutifs contrôlent aussi la carrière des juges européens dont le pouvoir est considérable : les juges sont nommés
pour six ans, ce qui est court, renouvelables, ce qui crée une
dépendance dangereuse (art. 253 TFUE). Cette violation du principe essentiel
de lindépendance des juges par rapport aux autres pouvoirs bafoue encore le
principe protecteur de la séparation des pouvoirs, et encore une fois au
profit des ministres (qui nomment et renouvellent ou pas les
juges) ; on voit partout que ce sont eux, ministres, qui ont écrit les
règles.
g) Le
pouvoir législatif ordinaire, mais aussi constituant est contrôlé, pour
lessentiel, par des organes non élus. Exemples : conférence intergouvernementale (composée de
ministres) modifiant les institutions (art. 48 §4 TUE), Commission européenne
(non élue) ayant lexclusivité de linitiative législative (art. 17 §2 TUE,
ce qui est une véritable insulte à la démocratie représentative), ministres co-législateurs
(!) (art. 16 TUE), Banque centrale productrice de normes obligatoires à
portée générale (art. 132 TFUE), etc.
h) Les
citoyens nont aucun moyen de résister à un abus de pouvoir et les
initiatives citoyennes sont muselées à
travers une procédure d« initiative dinvitation » trompeuse
car sans aucune force contraignante (art. 11 §4 TUE). On prend les
citoyens pour des imbéciles en leur offrant bruyamment des cadeaux
absolument vides.
i) Les
procédures de révision permettent aux exécutifs de modifier eux-mêmes les
institutions, et surtout sans consulter les peuples concernés (art. 48 TUE). Ce sont dabord toujours des organes non
élus qui sont chargés de réviser la Constitution européenne, ainsi que de
contrôler toute proposition de révision, et surtout les citoyens sont
tenus bien à lécart du processus constituant qui nimpose aucun
référendum : la « démocratie » que nous imposent nos élus
est factice.
j) Tout cela est dû,
daprès nous, à ce que le
processus constituant est lui-même profondément vicié par le fait que les
hommes au pouvoir, à la faveur de la construction européenne, sécrivent des
règles pour eux-mêmes (art. 48 §4 TUE), alors que seule une
Assemblée constituante désintéressée peut programmer de bonnes
institutions : les membres de cette Assemblée ne doivent pas avoir un
intérêt personnel à limpuissance politique des citoyens : ils
doivent donc, dabord, être déclarés inéligibles aux fonctions quils
instituent, et surtout, ils ne doivent pas être élus parmi des candidats
désignés par des partis, car ces hommes-là sont forcément à la fois
« juges et parties » dans un processus constituant.
|
|
Consultez tous les textes de références cités à cette
adresse :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Citoyens_d_Europe_Contre_le_Regime_Illegitime_references.pdf
|
Extraits
(7 pages) des institutions européennes modifiées par le traité de
Lisbonne :
articles incriminés par lappel
à des Manifestations Obstinées Contre le Régime Illégitime (MOCRIE)
0Hhttp://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/04/08/93-manifestations-obstinees
[commentaires en vert et entre crochets] (Mise
à jour du 18 avril 2008)
et autres
documents (2 pages) propres à étayer les affirmations de cet
appel :
|
[Nota : quand le traité parle de « Conseil »,
les juristes semblent, avec ce nom abrégé et ambigu, préférer que les
citoyens oublient quil sagit dune assemblée de Ministres : la
confusion des pouvoirs qui règne partout au profit des exécutifs se verrait
davantage, sans doute, avec son vrai nom : « Conseil des Ministres ».
Ne pas oublier que les institutions européennes sont écrites,
précisément, par les pouvoirs exécutifs, qui sécrivent donc des règles
pour eux-mêmes, et ça se voit partout.]
|
|
Article 16 TUE [confusion des pouvoirs : pouvoir
législatif abandonné à des ministres, censés uniquement exécuter les lois,
surtout sans les écrire !]
1. Le Conseil [des
Ministres] exerce, conjointement avec le Parlement européen, les
fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition
des politiques
et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de
chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement
de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
Article 17 TUE [exclusivité de linitiative des lois (pouvoir
législatif) donné à la Commission (non élue !)]
1.
La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives
appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que
des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille
l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de
l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle
exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément
aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique
étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités,
elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les
initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour
parvenir à des accords interinstitutionnels.
2.
Un acte législatif de l'Union ne peut
être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les
cas où les traités en disposent autrement. [Remarque : les cas en question ne
prévoient jamais que le Parlement pourrait être autonome sur un sujet donné
ou un autre, jamais : les exceptions à lexclusivité de linitiative
sont toujours prévues pour donner du pouvoir aux exécutifs, toujours !] Les autres actes sont
adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.
|
|
Article 119 TFUE [priorité absolue de la BCE = lutte contre linflation,
et tant pis pour le chômage, tant pis pour les travailleurs, tant mieux pour
les riches rentiers]
1.
Aux fins énoncées à larticle 3 du traité sur lUnion européenne, l'action des États membres et de lUnion
comporte, dans les conditions prévues par les traités, l'instauration d'une
politique économique fondée sur l'étroite coordination des politiques
économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition
d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
2.
Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les
traités, cette action comporte une monnaie
unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite d'une politique
monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques
générales dans lUnion, conformément au principe d'une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre.
3.
Cette action des États membres et de lUnion implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables,
finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements
stable.
Article 282 TFUE [priorité absolue de
la BCE = lutte contre linflation, et tant pis pour le chômage (2ème
couche)]
1. La Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La
Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États
membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent
la politique monétaire de l'Union.
2. Le Système européen de banques centrales est
dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à
la réalisation des objectifs de celle-ci.
3. La Banque centrale européenne a la personnalité
juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la
gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union
ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.
(
)
Article
130 TFUE [parfaite indépendance de la BCE : interdiction dessayer
dinfluencer la BCE en quoi que ce soit]
Dans
l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs
qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE,
ni la Banque centrale européenne, ni une
banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de
décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des
institutions, organes ou organismes de lUnion, des gouvernements des États
membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou
organismes de lUnion ainsi que les gouvernements des États membres
s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les
membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des
banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
|
|
Article
123 TFUE [interdiction faite aux États de créer la monnaie dont ils ont
besoin pour financer les investissements publics, monnaie qui serait créée en
empruntant sans intérêt à la BCE. Cet article est un vrai scandale.]
1.
Il est interdit à la Banque centrale
européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après
dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de lUnion, aux
administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres
autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États
membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque
centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de
leur dette est également interdite.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui,
dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques
centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la
Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés
de crédit.
[Certains sappuient sur le second paragraphe de cet article 123
pour soutenir lidée que lÉtat, sil le voulait, pourrait créer la monnaie
de financement dont il a besoin par
lintermédiaire de ces établissements publics de crédit. Cest méconnaître le
fait quentre un tel établissement et le Trésor Public les échanges
monétaires ne peuvent seffectuer quen monnaie centrale (inutilisable
pour les dépenses ordinaires). Dit autrement, un établissement public de
crédit ne peut pas ouvrir un crédit à lÉtat. Cf. AJH dans son tout dernier
livre : « La dette publique, une affaire rentable. »]
|
|
Article
63 TFUE [interdiction faite aux États de limiter la circulation des
capitaux, ce qui rend possible et favorise même la folle spéculation qui va
probablement, finalement, tous nous ruiner]
1.
Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux
entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont
interdites.
2.
Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions
aux paiements entre les États
membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
Article 49 TFUE [interdiction faite
aux États de limiter la liberté détablissement des entreprises, ce qui rend
possible et facilite même les délocalisations]
Dans
le cadre des dispositions visées ci-après, les
restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre
dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de
succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis
sur le territoire d'un État membre.
La
liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment
de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions
définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants,
sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
|
|
Article
42 TUE [« Compatibilité » imposée de la défense
européenne avec les choix de lOTAN]
(
)
2. (
) La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte
pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de
certains États membres, elle respecte les
obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États
membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre
de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est
compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans
ce cadre.
(
) 7. Au cas où un État membre serait l'objet
d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui
doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir,
conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte
pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de
certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine
demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du
traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,
le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.
|
|
[Actes juridiques : règlement = loi, directive
= loi-cadre, décision = décret avec le risque
darbitraire lié à la confusion des pouvoirs correspondante.
Procédures législatives : procédure législative ordinaire = codécision avec des Ministres
tuteurs du Parlement,
et
procédures législatives « spéciales »
qui sont carrément des lois sans Parlement du tout.
Les actes non législatifs
ne sont pas bien définis et doivent se comprendre « en creux », par
rapport à lart. 289 §3, quand les
procédures législatives sont exclues : par exemple, en matière de PESC (à propos de la
guerre, rien que ça), les décisions sont prises par les exécutifs à
lexclusion expresse de toute procédure législative, cest-à-dire sans
donner le moindre pouvoir au Parlement
(voir plus bas les art. 24, 26 et 28
TUE).]
Article
288 [Les actes juridiques de lUnion]
Pour
exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements,
des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire
dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État
membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments.
Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour
ceux-ci.
Les
recommandations et les avis ne lient pas.
Article
289 TFUE [Actes législatifs =
issus dune des procédures législatives : soit ordinaire, soit
« spéciale »]
1.
La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement,
d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et
le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à
l'article 294.
2. Dans les cas spécifiques prévues par les traités,
l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement
européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.
3. Les actes juridiques adoptés par procédure
législative constituent des actes législatifs.
[Pour un exemple dactes non législatifs, voyez la PESC, dans la
case suivante.
Pour comprendre ces « procédures législatives
spéciales » quon devrait plutôt appeler « lois sans
parlement » , il faut parcourir un à un les centaines darticles
des traités
Le fait de refuser de présenter la moindre liste de ces lois
sans parlement est, en soi, éminemment suspect : pourquoi donc cacher
ces domaines réservés où lexécutif légifère seul ?
Voici un exemple de procédure législative ordinaire
et de procédure législative spéciale, en matière de politique sociale :
les domaines de codécision entre
Parlement et Ministres sont surlignés en gris, les domaines
où lexécutif légifère seul (Montesquieu fait la toupie dans sa tombe) sont
surlignés en rouge]
Article
153 TFUE [domaines de la
politique sociale et procédures législatives correspondantes]
1.
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, lUnion soutient et
complète l'action des États membres dans les domaines suivants :
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail
pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
b) les conditions de travail ;
c) la sécurité sociale et la protection sociale
des travailleurs ;
d) la protection des travailleurs en cas de
résiliation du contrat de travail ;
e) l'information et la consultation des travailleurs ;
f) la représentation et la défense collective
des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous
réserve du paragraphe 5 ;
g) les conditions d'emploi des ressortissants
des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de lUnion ;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du
travail, sans préjudice de l'article 166 ;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne
leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ;
j) la lutte contre l'exclusion sociale ;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale,
sans préjudice du point c)
2.
À cette fin, le Parlement européen et le
Conseil :
a)
peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États
membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à
développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à
promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion
de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres ;
b) peuvent arrêter, dans les domaines visés au
paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions
minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et
des réglementations techniques existant dans chacun des États membres.
Ces
directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de
petites et moyennes entreprises.
Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément
à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social
et du Comité des régions.
Dans les domaines visés au paragraphe 1, points
c), d), f) et g), du présent article, le Conseil statue conformément à une
procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation
du Parlement européen et desdits Comités.
Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après
consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure
législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du
présent article. [Mystère : le point c, et lui seul, ne pourra en aucun cas
relever de la codécision. Domaine réservé des ministres.]
3.
Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande
conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du
paragraphe 2 ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil
adoptée conformément à l'article 155.
Dans
ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive ou
une décision doit être transposée ou mise en oeuvre, les partenaires sociaux
ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant
d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite
directive ou ladite décision.
[Est-ce quon pourrait expliquer aux citoyens pourquoi « la
sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs » (point c)
sont rigoureusement exclues du pouvoir du Parlement et réservées au pouvoir
sans contrôle du Conseil des ministres ?]
|
|
[Actes non législatifs : pas facile de comprendre quelle est la
portée de ces normes européennes qui ressemblent à notre pouvoir
réglementaire en France :
On a un bel exemple de ces "actes non législatifs" à
propos de la PESC, politique étrangère et de sécurité commune :
où, quand et comment allons-nous faire la guerre
Le
Parlement na aucun pouvoir en la matière : les exécutifs semblent y
avoir confisqué tous les pouvoirs, sans contre-pouvoir (vous avez dit "démocratie" ?) :]
Article 24 TUE
1.
La compétence de l'Union en matière
de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité
de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense
commune qui peut conduire à une défense commune.
La
politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen
et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les
traités en disposent autrement. L'adoption d'actes
législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres,
conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de
la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de
justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces
dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article
40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions
visées à l'article 275, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne.
[Les Présidents des États membres fixent les grandes lignes de la
PESC,
les Ministres décident les détails
Donc, notez : sur la PESC, le Parlement semble navoir AUCUN
pouvoir
PESC = domaine désormais strictement réservé aux exécutifs. Vous avez dit
« démocratie » ?]
Article 26 TUE
1.
Le Conseil européen identifie les intérêts
stratégiques de lUnion, fixe les objectifs et définit les
orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y
compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. Il
adopte les décisions nécessaires.
Si
un développement international l'exige, le président du Conseil européen
convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les
lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.
2.
Le Conseil élabore la politique étrangère et
de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à
la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations
générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
Le
Conseil et le haut représentant de lUnion pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité veillent à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de
l'action de l'Union.
3.
La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les États membres,
en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.
Article 28 TUE
1.
Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de
l'Union, le Conseil adopte les décisions
nécessaires. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à
mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en
uvre et, si nécessaire, leur durée.
2.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur
une question faisant l'objet dune décision visée au paragraphe 1, le Conseil révise les principes et les objectifs
de cette décision et adopte les décisions nécessaires.
3.
Les décisions visées au paragraphe 1
engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la
conduite de leur action.
4.
Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application
dune décision visée au paragraphe 1 fait lobjet dune information par
lÉtat membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une
concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information
préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple
transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
5.
En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut
dune révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, les États
membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant
compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre qui prend de
telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
6.
En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision visée au présent
article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les
solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs
de la décision visée au paragraphe 1 ni nuire à son efficacité.
|
|
[Autre exemple d« actes non législatifs », sortes de
« lois sans Parlement », voici les « actes délégués »,
sur le modèle de nos ordonnances, (emblématiques de la mise au pas du
Parlement par lexécutif sous la cinquième République en France). Toute notre
sécurité juridique dans ce contexte de confusion des pouvoirs dans les
mains de non élus va reposer sur linterprétation par les juges de
lexpression « éléments non essentiels » :]
Article 290 TFUE
1.
Un acte législatif peut déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou
modifient certains éléments non essentiels
de l'acte législatif.
Les
actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la
portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les
éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne
peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2.
Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la
délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes :
a)
le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ;
b)
l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par
l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas
d'objections.
Aux
fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des
membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. L'adjectif
"délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des actes délégués.
|
|
Article 253 TFUE
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant
des compétences notoires, sont nommés d'un
commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres,
après consultation du comité prévu à larticle 255.
Un
renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les
trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de
lUnion européenne.
Les
juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de
justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent
être nommés de nouveau.
|
|
Article 48 TUE
[Révision
des institutions : ce sont les exécutifs qui écrivent les
propositions de révisions et qui, de surcroît, les font valider sans
référendum, cest-à-dire sans les peuples concernés, cest à pleurer.]
1. Les traités
peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision
ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures
de révision simplifiées.
Procédure de révision ordinaire
2. Le gouvernement
de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces
projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les
compétences attribuées à lUnion dans les traités. Ces projets sont transmis
par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
3. Si le Conseil
européen, après consultation du Parlement européen et de la
Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à lexamen des
modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants
des parlements nationaux, des chefs dÉtat ou de gouvernement des États
membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale
européenne est également consultée dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les
projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une
Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que
prévue au paragraphe 4.
Le Conseil européen peut décider à la majorité
simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de
Convention lorsque lampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce
dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des
représentants des gouvernements des États membres.
4. Une Conférence des
représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président
du Conseil en vue darrêter dun commun accord les
modifications à apporter aux traités. [Ce sont donc exclusivement des membres de
lexécutif qui écrivent désormais la Constitution des
« démocraties » européennes
Fin
de létat de droit, relire la Déclaration des droits de lhomme, article
16.]
Les modifications entrent en vigueur après avoir
été ratifiées par tous les États
membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
5. Si à lissue dun délai de deux ans à compter de
la signature dun traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des
États membres ont ratifié ledit traité et quun ou plusieurs États membres
ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil
européen se saisit de la question.
Procédures de révision simplifiées
6. Le gouvernement
de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut
soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou
partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le
fonctionnement de lUnion européenne, relatives aux politiques et actions
internes de lUnion.
Le Conseil européen peut adopter une décision
modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité
sur le fonctionnement de lUnion européenne. Le Conseil européen statue à
lunanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission
ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications
institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision nentre en
vigueur quaprès son approbation par les
États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas
accroître les compétences attribuées à lUnion dans les traités.
7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de
lUnion européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil
statue à lunanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil
européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la
majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne
sapplique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.
Lorsque le traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut
adopter une décision autorisant ladoption desdits actes conformément à la
procédure législative ordinaire.
Toute initiative prise par le Conseil européen sur
la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas dopposition
dun parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette
transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa nest pas
adoptée. En labsence dopposition, le Conseil européen peut adopter ladite
décision.
Pour ladoption des décisions visées au premier ou
au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à lunanimité, après
approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres
qui le composent.
|
|
Article 132 TFUE [pouvoir
normatif autonome de la Banque centrale européenne (BCE) :
pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire concentrés dans un
seul organe, non élu !
Une invraisemblable confusion des pouvoirs sur un sujet
essentiel pour la société, la monnaie.]
1.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC [système européen des
banques centrales], la Banque centrale européenne, conformément aux traités et selon les
conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la BCE :
-
arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des
missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou
25.2 des statuts du SEBC et de la BCE, ainsi que dans les cas qui sont prévus
dans les actes du Conseil visés à
l'article
129, paragraphe 6,
-
prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au
SEBC en vertu des traités et des statuts du SEBC et de la BCE,
-
émet des recommandations et des avis.
2.
La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions,
recommandations et avis.
3.
Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil,
conformément à la procédure prévue à l'article 129, paragraphe 6, la Banque
centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et
des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.
|
|
Article 11 TUE
(
)
4.
Des citoyens de l'Union, au nombre d'un
million au moins, ressortissants d'un nombre
significatif d'États membres, peuvent prendre
l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour
lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est
nécessaire aux fins de l'application des
traités.
[Nota : cet article ne comporte rigoureusement aucune
force contraignante : la Commission fait ce quelle veut, sans même
avoir à motiver sa décision : elle peut jeter linitiative à la
poubelle, elle peut la déformer ou la vider de son sens
Et ensuite, le
Conseil des Ministres et le Parlement peuvent faire de même
On se moque des
citoyens en prétendant leur offrir un droit démocratique tant attendu avec
cet article 11 qui est, en fait, une véritable insulte.]
|
|
Source pour le TUE et le TFUE consolidés (avec la nouvelle
numérotation) :
Rapport dinformation de la Commission des affaires étrangères de lAssemblée nationale (publié en décembre 2007)
(1Hhttp://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf)
|
|
Art. 16 Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 (DDHC)
Toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Source : 2Hhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm
[Le principe de la
séparation des pouvoirs est enseigné partout dans le monde comme le premier
principe fondateur qui doit guider des institutions républicaines, lexigence
la plus importante pour protéger les hommes contre larbitraire.
Ce que tout citoyen
devrait savoir dès son plus jeune âge, cest que sa principale
protection contre les abus de pouvoir réside dans la séparation des pouvoirs, et que cette
séparation des pouvoirs ne peut être imposée quau plus haut niveau du droit,
dans un texte essentiel pour les libertés qui sappelle Constitution, qui se sert pour
ainsi dire quà cela : séparer les pouvoirs pour les empêcher de
nuire.
Cest pour cela que
les révolutionnaires de 1789 ont signalé solennellement dans la Déclaration
des Droits de lHomme et du Citoyen quune société qui ne garantit pas la
séparation des pouvoirs na pas de constitution : cette société est
gravement exposée aux abus de pouvoir.
Par exemple, notre
propre Constitution, celle de 1958 qui institue la 5ème
République, précise expressément :]
Art 23-1 Constitution française de 1958 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire.
Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constit.htm
|
Documents complémentaires pour étayer/illustrer les
affirmations de la proposition :
Indicateurs alarmants évoqués :
« En octobre 2006, le Congrès
étasunien a franchi le pas et a approuvé un projet de loi légalisant la
torture, en flagrante violation des principes même de la démocratie. La
majorité républicaine ainsi que plusieurs élus démocrates de la Chambre des
représentants et du Sénat ont autorisé lutilisation des preuves obtenues sous
la torture contre le « combattant ennemi illégal ». Le
texte, intitulé Loi des commissions militaires, 2006 , reconnaît
lexistence de tribunaux secrets pour juger tout ressortissant étranger soupçonné
de porter atteinte aux intérêts des États-Unis. Laccusé ne pourra pas
prétendre au choix de son avocat, ni connaître les charges qui pèsent contre
lui. De plus, les preuves présentées contre lui pourront rester secrètes. Bien
évidemment, il pourra également être détenu sans pouvoir réclamer dêtre
présenté devant un juge, et ce indéfiniment. Il ne pourra pas contester la
légalité de sa détention, ni les tortures dont il aura été victime [6].
La loi confère également au président
étasunien « lautorité [pour] interpréter la signification et
lapplication des conventions de Genève » prohibant la torture. Ces
dernières ne pourront pas être invoquées « comme source de droit devant aucun
tribunal des États-Unis ». La section V de la législation stipule que
« personne ne pourra invoquer les conventions de Genève ni aucun de leurs
protocoles dans une quelconque action dhabeas corpus ou tout autre acte
civil ou toute poursuite judiciaire dans lesquels les États-Unis, un
fonctionnaire en activité ou non, un employé, un membre des forces armées ou
tout autre agent des États-Unis est partie en tant que source de droit ». En outre,
« aucun tribunal, aucun juge naura le pouvoir dentendre ou de prendre en
considération une demande en assignation dhabeas corpus introduite par
un ressortissant étranger (ou en son nom) qui est ou qui a été détenu par les
États-Unis et qui a été considéré comme étant correctement détenu comme
combattant ennemi ou en instance de cette qualification [7] ».
Non seulement cette
loi liberticide, dessence totalitaire, représente une menace pour nimporte
quel citoyen du monde ne bénéficiant pas de la nationalité étasunienne, mais
elle octroie une impunité totale aux responsables des traitements cruels,
inhumains et dégradants. LUnion européenne et la France en particulier ont
maintenu un silence scandaleux au sujet de cette législation. Que se
serait-il passé si la Chine, Cuba, lIran, la Russie ou le Venezuela avaient
adopté une loi similaire ? Qui peut encore parler, en référence aux États-Unis,
de modèle de démocratie ? »
[6] et [7] :
voir « Quand Washington légalise la torture » 5Hhttp://www.humanite.fr/popup_imprimer.html?id_article=838696
Source : « Quand
Reporters sans frontières légitime la torture » 6Hhttp://www.voltairenet.org/article151200.html
Autres points évoqués, à
étayer :
Lire JP Fitoussi,
Professeur des Universités à l'Institut
d'Études Politiques de Paris, Président du Conseil Scientifique de l'IEP de
Paris, Président de l'OFCE et Secrétaire général de l'Association
Internationale des Sciences Économiques, entretiens avec JC Guillebaud, « La politique de limpuissance »,
2005, Arléa.
Extrait édifiant :
- JCG : « Vous êtes en train de dire
quau fond, obsédé par la lutte contre
linflation, on a littéralement consenti au chômage. »
- JPF : « Pis que ça ! On
a dans une première phase instrumentalisé le chômage pour combattre
linflation. Chaque "banquier central" de la planète sait que, dès
quil augmente les taux dintérêts, il met au chômage une partie des catégories
les plus vulnérables de la population. Non seulement il le sait, mais cest
précisément pour ça quil le fait. Pourquoi augmente-t-on les taux dintérêts ?
Parce quon est persuadé que la demande est trop forte et que les entreprises
produisant à pleine capacité ne pourraient la satisfaire quen augmentant leurs
prix. La douche froide des taux dintérêts réduit ainsi la demande et incite
les entreprises à licencier. » (p. 45)
(
)
- JCG : « Que pensez-vous des deux arguments martelés à cette époque
[après 1982] à propos de linflation et du respect des grands équilibres ?
Premièrement on a dit quil était légitime (y compris moralement) de lutter contre
linflation parce quelle pénalisait les plus pauvres ; deuxièmement,
quil fallait maintenir les grands équilibres par simple respect et générosité
pour les générations à venir, afin de ne pas faire peser une charge trop lourde
sur la tête de nos enfants. On a habillé, en quelque sorte, cette politique
dun discours de générosité
»
- JPF : « Cétait un double
mensonge. En augmentant les taux
dintérêts, et surtout en les maintenant à un niveau élevé une fois linflation
vaincue, on savait quon favorisait ceux qui détiennent le capital financier,
et que lon excluait de laccès aux biens durables (qui exigent un recours à
lemprunt) les catégories les plus vulnérables de la population. (
) Le second
mensonge, cest quen augmentant les taux dintérêt on faisait du service de la
dette un des postes les plus importants du budget de lÉtat. »
(P. 46)
- JPF : « Que lorientation
des politiques économiques de lUnion soit, pour lessentiel, indépendante de
tout processus démocratique est à la fois contraire aux traditions politiques
des peuples européens, et dangereux pour lefficacité économique de
lensemble. » (p. 72)
- JPF : « En forçant le trait,
on pourrait affirmer que le « gouvernement économique » de lEurope
se rapproche à sy méprendre dun despote éclairé qui, à labri des pressions
populaires, chercherait le bien commun au travers de lapplication dune
doctrine rigoureuse le libéralisme -, supposée supérieure à toutes les autres
en termes defficacité économique. La démocratie ne serait donc pas le système
politique le mieux à même dappréhender lintérêt général ; elle placerait
les gouvernements en position de vulnérabilité devant les pressions des
populations en faveur de la redistribution. Le pouvoir a ainsi changé de
mains. Les politiques ont préféré le confier à des agences indépendantes. (
)
Mais il est vrai aussi
que, dès lorigine, la construction européenne fut luvre dune démocratie des
élites, plutôt que de la démocratie tout court. Cependant les élites ont changé
(
) aujourdhui elles ont tendance à assimiler le bien public au marché.»
La suite est proprement
incroyable
Un petit livre important, à lire
La panne (Vendredi 15 février 2008) (Lien)
Vendredi 15 février 2008, 10 h : mon
site est en panne depuis lundi 11,
en panne dans
toutes ses pages interactives (blog, forum, wiki).
La base de données est inaccessible pour les visiteurs, depuis trois jours
entiers.
Le support de Free me certifie quil ne peut rien faire.
Jai limpression de navoir aucun moyen de régler le
problème moi-même.
Cest peut-être fini. Désolé.
Jen ai marre de toutes ces impasses.
Jai encore une idée à essayer
Après, je vais recommencer à voler.
Vendredi 15, 14 h : jai trouvé. Cest réglé. Cétait de ma faute.
Mais cette longue interruption ma fait mal. Un mal
profond et inattendu.
Jai senti comme je suis devenu accro à léchange, devenu si simple sur le net.
Jai senti comme je suis devenu dépendant de vos émotions et réactions, chez
moi.
Jai senti comme vous étiez devenu un moteur essentiel de mon travail
quotidien.
Je crois quil faut que je retourne voler un peu ; je deviens trop « One track
Minded ».
Je vais aller retrouver mes montagnes chéries, mes herbes folles dans la brise
parfumée, et mes cumulus adorés.
Je vais retrouver mes amis les rapaces et les martinets, et enrouler avec eux
de beaux thermiques jusqu'aux barbules odorantes, merveilleuse odeur des
nuages.
Je vous raconterai.
Merci dêtre toujours là, malgré les pannes.
:o)
Étienne.
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2008/02/15/90-la-panne
Chers amis,
Le lien entre nos institutions malhonnêtes dès leur
constitution, de façon à bien verrouiller notre impuissance politique et
les intrigues des banques privées qui sont capables, pour nous
asservir, de voler la création monétaire à la collectivité, et même de
contraindre les représentants politiques à livrer le pays à des bourreaux
quelles ont fait naître , est pour moi la découverte de l'année 2007.
Cette découverte permet de progresser dans notre réflexion sur une Constitution
d'origine citoyenne. Ceux qui disent qu'on ne progresse pas se trompent.
Alan Greenspan vient de déclarer : « je dois
prévoir que quelque chose dinattendu va arriver et nous mettra à terre... » « ... Nous, ainsi que toutes les autres banques
centrales, perdons le contrôle des forces qui accroissent les prix. »
C'est évoqué là : http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3655
Et on dirait bien que c'est le pire
cauchemar des banquiers : le cauchemar des banquiers, c'est de
lâcher par mégarde la gorge des salariés (80% de la population active), et de
les voir s'échapper pour recommencer à lutter victorieusement pour augmenter
leurs salaires...
C'est cette obsession viscérale
des salaires chez les banquiers qu'a utilement soulignée Annie Lacroix-Riz dans ce livre important
qu'est "Le choix de la défaite"
(*) (ne
ratez pas cette vidéo) : sabordage historique dont la preuve
formelle apportée par l'historienne pour les années 30 met en lumière (et
permet d'enfin comprendre) le même choix pour les mêmes raisons :
tenir en cage les salaires , à travers la construction européenne ardemment
voulue et imposée par les banquiers, à commencer par Jean Monnet...
Des
salariés dotés d'institutions leur permettant de se défendre financièrement...
Une République, quoi... L'horreur absolue de tous les banquiers et de tous les
rentiers du monde...
Je trouve qu'entendre Greenspan redouter sérieusement cette perspective
d'inflation est un vrai bon pronostic de bonne année... :o)
Bonne année à vous tous, chers amis
!
Étienne.
(*) Annie Lacroix-Riz souligne fortement, preuves formelles à
l'appui, ce qui la distingue bien de nombreux historiens contemporains faux-nez
du MEDEF que, même en 1936, le Ministre des finances avait promis au
Gouverneur de la Banque de France (également maître du Comité des Forges, MEDEF
du moment) de bien tenir les salaires (comme le faisaient, et le font toujours
?, tous les ministres des finances avant de prendre leurs fonctions), et que c'est
uniquement sous la pression irrésistible de la rue, sous la contrainte de
centaines de milliers de salariés en colère et prêts à en découdre physiquement,
que les Ministres (et leurs banquiers matons) ont dû lâcher les congés payés,
les 40 heures, les hausses de salaires, etc.
Annie Lacroix-Riz souligne
qu'aujourd'hui encore, comme hier, il n'y a pas grand-chose à attendre de
l'initiative de nos "représentants" puisque leurs vrais maîtres sont
les banquiers : rien ne se fera de bon si
les salariés ne prennent pas eux-mêmes en charge la défense de leurs
intérêts.
Elle souligne aussi que l'obsession des banquiers contre les hausses
de salaires était telle que la Banque de France a soutenu activement Hitler
depuis le début, que la même Banque de France a soutenu d'autres dictateurs,
que la même Banque de France a rendu possible le financement de l'effort de
guerre de l'Allemagne et que la même Banque de France a finalement voulu et
imposé la capitulation rapide de la France devant Hitler, carrément... car
Hitler était formidable du point de vue des salaires : exactement l'homme dont
la Banque de France aimait les méthodes pour traiter les syndicats et autres
agitateurs d'esclaves... Tout ça est passionnant. Cette historienne est un
phare, un des derniers qui soient allumés.
Voyez aussi cette deuxième longue et intéressante vidéo :
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3024.
Voir aussi cette bonne recension du livre :
http://www.solidariteetprogres.org/spip/special/Ent-Lacroix-Riz.pdf
Sur la profonde malhonnêteté de nombreux historiens actuels, grassement payés par les plus riches (et encensés publiquement
tous les jours par des médias aux ordres qui peut résister à cette corruption
?) pour réécrire une histoire sur mesure et sans preuves , il faut
absolument lire cet autre livre, tout petit celui-là mais décapant au possible
: « L'histoire
contemporaine sous influence » ;
voir cette bonne recension : http://www.voltairenet.org/article13259.html.
Je viens de recevoir ce message qui
me peine profondément.
Au
revoir
« Cest
avec beaucoup démotion que je vous écris ces lignes. Toute ma vie, jai payé
cash le prix de mes choix. Il en est allé ainsi, une fois encore, lorsque jai
pris la décision de soutenir la candidature de José Bové.
Je
suis sans emploi et sans ressources. Depuis des mois, je cherche. En dépit dun
curriculum vitae bien fourni, qui, ailleurs, maurait très vite ouvert de
nombreuses portes, notamment à lUniversité, en France, mon pays dadoption, je
nai trouvé ni soutien sérieux, ni proposition crédible.
Au
Cambodge, où on na pas oublié le rôle que jy ai joué pendant douze ans pour laider
à sortir des séquelles dune des plus grandes tragédies du XXe siècle, certains
ont appris ma situation. Ils ont considéré que ce nétait pas acceptable. Une
offre mest faite de travailler comme expert-consultant auprès du gouvernement
cambodgien sur certains dossiers où je peux apporter quelque chose à ce pays.
Je lai acceptée. Comme jai accepté une autre offre sur le Liban. Je vais
partager les quatre années qui me séparent de la retraite entre ces deux pays.
Depuis
sept ans, je me suis impliqué, avec toute la force de mes convictions, dans
laction citoyenne. Comme militant altermondialiste dabord, au nom dune
certaine idée de lEurope ensuite, dans la recherche dune gauche de gauche
enfin. Je lai fait en toute liberté, sans souci de carrière. En restant fidèle
à mes convictions et en nobéissant quà ma conscience.
Ce
qui me peine le plus au moment de me retirer de laction militante, cest de
laisser derrière moi un champ de ruines où gisent toutes les gauches. Dans les
gravats, on ne trouve que sauve-qui-peut carriériste ou sectarisme. Le socialisme
a contribué de manière décisive à la mondialisation néolibérale et à son
extension aux champs européen et français. Les disciples de Lénine, quelle que
soit la secte quils dirigent, ont tué lespérance née le 29 mai 2005. Les
militants altermondialistes sont repliés sur des combats certes essentiels,
mais dans une approche trop sectorielle.
Le
mot « gauche » ne porte plus aucune espérance. Il demeure néanmoins,
pour ceux qui entendent mettre leurs actes en cohérence avec leurs convictions,
une certaine manière de penser et dagir qui allie liberté, égalité et fraternité,
qui recherche le beau et le bien, qui ne renonce jamais à lengagement. Cest à
cela que jentends rester fidèle, plus que jamais disciple des Lumières et
attaché aux idéaux de Mai 68.
Je
ne serai pas là pour participer à la création dune gauche nouvelle fondée sur
des valeurs et une pratique où la fin se trouve déjà dans les moyens. Je le
regrette profondément. Je ne serai cependant pas absent du débat européen grâce
à un livre que je termine ces jours-ci.
Je
souhaite à chacune et à chacun du bonheur dans vos vies et vos combats.
Raoul
15
août 2007
Raoul Marc JENNAR
consultant - questions internationales
7, place du Château, 66500 Mosset
Email : raoul.jennar@wanadoo.fr »
Je suis ému et triste. Raoul a profondément changé ma vie avec
son immense livre « Europe, la trahison des élites », puis avec son amitié
chaleureuse et exigeante. Je nai pas su laider comme il en avait besoin dans
cette difficile passe "après-Bové" ; je me sens nul. Nous aurons du
mal à nous battre sans lui : cest un fin connaisseur des tromperies de lUnion
européenne et un des plus solides résistants au féodalisme des multinationales
et des banques qui sen va.
C'est incroyable que les dizaines de milliers de résistants
qui lui doivent tant et qui vont tant avoir besoin de lui dans les années qui
viennent soient incapables de se grouper et de se cotiser durablement (ou de
l'aider à trouver un poste de chercheur en faculté) pour lui permettre
simplement de vivre et pour qu'il puisse continuer de lutter à nos côtés. Notre
(éternelle) indifférence au sort d'autrui et notre manque de discernement sont
désespérants.
Jai le bourdon.
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/08/16/81-au-revoir-un-message-bouleversant-de-raoul-marc-jennar
Je suis en train
de découvrir le détail d'une situation financière incroyable.
Vous croyez que
la monnaie est créée par l'État ? Vous vous trompez : ce sont les banques privées qui
créent la monnaie, et qui en perçoivent le prix (l'intérêt).
Si c'était l'État qui créait la monnaie,
il pourrait l'investir directement lui-même (sans devoir payer le moindre
intérêt jusqu'au remboursement) ; il pourrait aussi prêter cette monnaie
nouvelle aux banques (charge à elles de la prêter à leur tour) et en percevait
le premier intérêt (des milliards d'euros), ce qui pourrait aussi financer les
services publics, au lieu de garnir des poches de soie au prix d'un déficit
paralysant pour l'État.
L'État (c'est-à-dire nous tous) a perdu le droit de
battre monnaie et ce sont des banques privées à qui nos soi-disant
"représentants" ont abandonné ce pouvoir décisif.
Vous pensez que la monnaie est un outil
qui sert l'intérêt général ? Vous vous trompez : la monnaie est
devenu (discrètement) un outil qui sert d'abord des intérêts privés.
La construction de l'Union européenne pourrait bien
être motivée principalement par ce détournement de la richesse publique,
notamment à travers à l'article 104 du traité de Maastricht : « Il est
interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres, ci-après
dénommées « banques centrales nationales » daccorder des découverts ou tout
autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux
administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités
publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres;
lacquisition directe des instruments de leur dette, auprès deux, par la BCE
ou les banques centrales nationales, est également interdite. »
Par cet article (repris quasiment tel
quel dans le TCE, art. III-181), les États (c'est-à-dire nous tous) ne peuvent
plus financer les investissements publics qu'en empruntant à des acteurs
privés, et en leur payant un intérêt.
Cette prise de conscience m'a conduit à écrire un billet à
Judith Bernard, sur le Big Bang Blog, qui s'inquiétait du sort des
services publics et de leur financement prétendument problématique (d'après nos
représentants politiques).
Je reproduis ci dessous le billet en
question et je le fais suivre de quelques citations importantes pour
étayer mon propos. Tout ça est un peu long mais de la plus haute importance :
avec le contrôle de l'argent, on est au coeur du problème des hommes avec le pouvoir
: ça vaut le coup de lire pour comprendre. Les citoyens sont fous de ne pas
approfondir personnellement cette cause majeure de leur travail forcé.
Non,
ce n'est pas "trop cher" : pour financer
nos services publics,
il nous suffit de reprendre aux banques privée
la création monétaire
que la puissance publique n'aurait jamais dû abandonner
27 avril 2007.
Bonjour
Judith,
Dabord, merci
pour tout ; dordinaire silencieux, je savoure vos textes, forts et beaux, dans
mon coin, comme on goûte du lait au miel :o)
Ceux qui vous maltraitent cette fois, en faisant comme si vous
étiez à la fois utopique et irresponsable à tant apprécier la dépense publique
sans vous soucier des financements, ceux-là se trompent : nous naurions aucune
peine à financer TOUS les investissements utiles à notre collectivité si nous
avions le contrôle de notre monnaie, au lieu de lavoir cest proprement
incroyable abandonné aux banques privées.
Ceux qui vous
vilipendent font comme si la monnaie, aujourdhui rare, était forcément rare,
ce qui nest pas le cas. Ils vous enferment ainsi dans une économie de rareté.
Mais cette rareté est artificielle, elle est voulue, elle est fabriquée, et
elle est la source de la richesse immense de certains acteurs qui savent rester
discrets.
Bien sûr, si
la monnaie est rare, elle est chère et son prix sajoute aux prix de toutes
choses ; les échanges sont pénalisés par le coût des crédits. Mais la monnaie
pourrait être abondante, ou plus exactement suffisante. Pour cela, il faudrait
que lÉtat (cest-à-dire nous) ait le contrôle de sa création.
Or il se
trouve vous nallez pas me croire que les États ont abandonné la création
monétaire aux banquiers privés. Les États (cest-à-dire nous) ne peuvent plus
créer la monnaie dont ils ont besoin pour fluidifier léconomie. Quand
lÉtat (c'est-à-dire nous) a besoin dargent (pour construire des hôpitaux ou
des crèches), il doit aujourdhui emprunter cet argent aux acteurs privés et
leur payer un intérêt, au lieu de créer lui-même largent dont il a besoin.
Cest idiot. Non, cest criminel. En tout cas, ce nest pas une fatalité :
cest un choix politique et un choix qui na rien à voir avec lintérêt
général.
Quand une
banque vous prête 100 000 , elle ne les a pas. Elle les crée (par une simple
écriture) pour vous les prêter, et elle les détruira quand vous lui rendrez.
Mais au passage, elle aura perçu un intérêt (considérable) qui ne correspond à
aucun service, aucune privation de sa part : lintérêt que perçoivent les
banques privées sur la monnaie créée ex nihilo (à partir de rien) est
foncièrement injuste, une sorte de paiement de lindu, un racket gigantesque de
toute léconomie par des acteurs privilégiés.
Quelle est la
raison de ce sabordage monétaire qui asphyxie notre économie ? Une volonté
politique. Un phénomène réversible, donc. Il ne tient quà nous de récupérer
notre souveraineté monétaire.
Tous les
citoyens devraient prendre quelques heures pour étudier lhistoire du racket
financier imposé par les banques (en France, en Europe, aux États-Unis) : ils
comprendraient les solutions qui simposent, à la fois simples et fortes ; la
création monétaire doit impérativement et exclusivement relever de la puissance
publique.
Ne croyez pas les épouvantails et autres chiffons rouges quon va
agiter devant vos yeux pour vous persuader que lÉtat créateur de monnaie est
forcément imbécile : de bons contrôles sont évidemment imaginables pour que la
création publique de monnaie soit raisonnable. Ce quon appelle la « planche
à billet » nest pas forcément une catastrophe, bien au contraire, cest le
sens de mon message : cest labus de la planche à billets qui est une
catastrophe, OK ; mais son utilisation raisonnable est non seulement utile,
mais indispensable pour un bon fonctionnement de léconomie. Ceux qui
prétendent le contraire ont souvent une idée derrière la tête et pas seulement
l'intérêt général en ligne de mire.
Dailleurs, la masse monétaire augmente denviron 10% tous les ans sans
déclencher dinflation, ce qui est bien la preuve que ce spectre de la planche
à billets nest quun épouvantail (bien commode pour nous conduire à accepter
que l'État soit dépouillé de ce droit essentiel).
Par contre,
les banques privées devenues créatrices (et vendeuses) de notre monnaie (ces
banques à qui on a abandonné la « planche à billets », précisément) sont,
effectivement, de véritables parasites, à très grande échelle. Rien
nimpose, économiquement, que ce soit des acteurs privés qui maîtrisent la
planche à billets, au contraire.
Nous sommes
fous daccepter de perdre ce levier vital des politiques publiques, aussi bien
en France quen Europe.
Les soi-disant
"libéraux" font tout pour ruiner les États, ce qui offrira plusieurs
avantages aux acteurs privés déjà très riches : une fois ruiné, lÉtat ne
pourra plus assumer que les fonctions sécuritaires (armée, police, justice),
bien utiles aux très riches (ces fonctions étatiques là, ils y tiennent,
curieusement). Une fois ruiné, lÉtat vendra les services publics aux copains
privés des prétendus « hommes dÉtat » complaisants. Je vous laisse imaginer
les yeux cupides avec lesquels les compagnies dassurance lorgnent le marché du
financement de la santé publique, pour sen tenir à votre exemple. Les
"libéraux" vont leur vendre tous nos plus précieux services publics.
Et lUnion
européenne, lOMC, le FMI sont leurs principaux outils de désarmement politique
des populations, daffaiblissement des États, de renoncement au peu de
démocratie que ces populations avaient pourtant chèrement payée.
Si on ne se paie pas de mots en ne lisant, dans les institutions,
que les préambules et les généreuses déclarations dintention liminaires, si on
va lire tous les articles en détail pour contrôler que la séparation des
pouvoirs existe bien, vérifier si le contrôle des pouvoirs est effectif,
surveiller lindépendance des juges qui doit être réelle, sassurer que
linformation honnête des citoyens soit protégée et garantie, prendre garde à
ce que des moyens soient offerts aux citoyens pour résister vraiment à
déventuels abus de pouvoir, si on contrôle tout ça, Judith, et bien cest une
catastrophe : ils sont en train de nous piquer la démocratie. Et en jurant le
contraire !
Et pour
lurgence, il y a un des deux candidats qui nous promet de nous violer dès
qu'il sera élu (au moins, on est prévenus) : le « mini traité » imposé par voie
parlementaire, c'est un cauchemar : c'est dans la partie 1 que se trouvent les
dispositions les plus dangereuses pour la démocratie (les autres parties
sont déjà en vigueur et le resteront : ça ne les gêne pas de les retirer de la
"réforme").
Lire à ce
sujet C'est
la partie 1 du TCE qui est la plus dangereuse, celle qui nous retire la
démocratie : pas question de l'accepter sans référendum].
Mais le cur
de limpuissance politique grandissante des hommes est encore plus difficile à
percevoir : comme je vous le disais, la grande absente de nos débats publics
est la monnaie. Pourtant, nous pourrions satisfaire bien des besoins vitaux en
reprenant son contrôle.
Il tient aux
journalistes et aux citoyens « donneurs dalerte » de faire monter le sujet sur
la place publique : je vous conseille la lecture de cette page « La vérité
sur la dette » (http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=La+v%C3%A9rit%C3%A9+sur+la+dette),
mais aussi celle dun petit livre formidable et important : « Les 10 plus
gros mensonges sur léconomie » (http://www.10mensonges.org/)
; ne pas rater les mensonges 1 à 4, essentiels.
Prenez surtout
le temps détudier le tableau de la page 73 qui montre de façon pédagogique que
toute somme dépensée par lÉtat se retrouve dans ses caisses au bout de quatre ou
cinq ans dimpôts (ce qui montre la bêtise des politiques frileuses réclamant
un État pingre) et que cet investissement a été multiplié (on parle dailleurs
de multiplicateur dinvestissement) et a répandu ses bienfaits dans des
proportions immenses.
Les difficultés financières de l'État ne viennent pas du tout de
son incurie, mais de sa pauvreté artificiellement programmée à travers un
système bancaire inique, un privilège de type féodal discrètement consenti aux
banques privées le droit de créer la monnaie et de prélever un intérêt sur
cette monnaie neuve, et l'obligation pour l'État de s'endetter auprès des
acteurs privés pour financer les besoins publics système bancaire qui met le
pays en coupe réglée, sans aucun espoir de jamais rembourser une dette sans fin
puisque la création monétaire est rançonnée.
Nous sommes
victimes dun sabordage monétaire de la part de nos propres « représentants »
et la construction européenne permet de verrouiller ce sabordage monétaire
au plus haut niveau : européen et constitutionnel. Normalement, si leur plan
aboutit, aucun peuple ne pourra plus jamais saffranchir de la tutelle du
système financier privé.
Consultez
aussi le site passionnant http://www.fauxmonnayeurs.org/.
Pour relier
cette affaire à mon idée fixe « ce nest pas aux hommes au pouvoir
décrire les règles du pouvoir » ; il nous faut un processus constituant
honnête pour nous protéger enfin des abus de pouvoir ; les candidats pour
lassemblée constituante ne doivent surtout pas être désignés par les partis
, je pense que les politiciens professionnels actuels, tels quils sont élus,
ont trop d"ascenseurs à renvoyer", ils sont trop ligotés par ceux
qui ont financé leurs campagnes électorales : seul le référendum
dinitiative populaire rendra aux peuples le pouvoir dimposer, avec une
légitimité politique incontestable, aux acteurs privés les plus puissants ce
que les hommes politiques ne peuvent déjà plus faire.
Nous sommes donc au cur de votre billet : dans létat actuel
daffaiblissement des puissances publiques face aux multinationales privées, la
protection des services publics passe, à mon sens, par une réforme institutionnelle
qui rend du pouvoir aux peuples, pouvoir nécessaire pour défendre eux-mêmes les
services auxquels ils tiennent, et cette réforme nest possible que si
lassemblée constituante nest pas composée dhommes de partis car les partis
ont un intérêt personnel à limpuissance politique des citoyens, ce qui
explique quils ne nous donneront jamais le pouvoir qui nous est dû. Cela vaut
pour la France comme pour lEurope.
Je sais que
tout cela nest pas très poétique, pardonnez-moi, mais les attaques qui fusent
contre vous sont injustes et me hérissent car elles révèlent et défendent une idéologie
inepte (ou plutôt très intelligente) qui nous ruine tous, chaque jour un peu
plus.
Amicalement.
Étienne.
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php
(Cette page de liens et documents est assez lourde à charger (environ 4 Mo),
mais elle est incroyablement riche en informations pour résister ; je
lactualise presque tous les jours.)
PS : encore un
mot, chère Judith : je suis sûr que vous apprécierez les derniers textes que
jai publié sur la partie blog de mon site : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php.
Je découvre et
dévore des auteurs immenses comme Alain (extraordinaire blogueur), Jacques
Duboin, Simone Weil, George Orwell
autant de résistants dont les
pensées gagnent à être remises en avant pour nous défendre contre les affreux.
PPS :
l'immense économiste Maurice Allais (http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Allais)
("prix Nobel" d'économie, considéré à l'étranger comme un vrai génie)
assez à droite sur certains points, mais plutôt à gauche sur d'autres, traite
les banques privées de « faux-monnayeurs », et il le démontre fortement. Il
écrit : « Par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les
banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent
bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des
faux-monnayeurs, si justement réprimée par la loi. »
PPPS : il faut
aussi lire deux petits livres formidables, de Jacques Généreux, chez
Seuil : "Les vrais lois de l'économie" et "Pourquoi la
droite est dangereuse". Ce sont deux petits bijoux d'intelligence, de
concision, de précision... Cet homme porte bien son nom et ferait un excellent
Président.
Au passage, je
réclame le droit d'élire un citoyen non candidat. Pourquoi sommes-nous
limités à l'offre politique des partis, pourquoi devons-nous choisir parmi ceux
qui veulent le pouvoir alors quils sont sans doute les plus dangereux pour
l'exercer ? Bon, j'arrête, car je suis intarissable là aussi... :o)
Merci pour
tout ce que vous faites, ne changez pas :o)
Voici maintenant quelques
citations importantes pour appuyer mes dires (ne ratez pas les
textes formidables de Bernard Maris) :
Citation n°1, de Denis Clerc :
« Les banques créent de la monnaie
très simplement. Lorsque le titulaire dun compte obtient un prêt à court terme
(moins dun an), par exemple une avance sur salaire : dans ce cas, la banque
inscrit au crédit du bénéficiaire la somme demandée (doù le terme de crédit). Elle
a créé de la monnaie scripturale à partir de rien. Une inscription sur un
compte lui a suffit. »
Source
: Denis Clerc, « Déchiffrer léconomie », Chapitre 4 La monnaie et le
crédit, p. 163.
Citation n°2, de la Banque de
France :
En 1971, la Banque de France éditait un
opuscule dénommé « la Monnaie et la Politique monétaire » dans lequel elle
précisait : « Les particuliers même
paraît-il certains banquiers ont du mal à comprendre que les banques aient le
pouvoir de créer de la monnaie ! Pour eux, une banque est un endroit où ils
déposent de l'argent en compte et c'est ce dépôt qui permettrait à la banque de
consentir un crédit à un autre client. Les dépôts permettraient les crédits.
Or, cette vue n'est pas conforme à la réalité, car ce sont les crédits qui
font les dépôts. » [et pas linverse. (ÉC)]
Source : Banque de France, donc pas vraiment des mickeys :o)
Citation n° 3, de Maurice Allais :
« Fondamentalement,
le mécanisme du crédit aboutit à une création de moyens de paiements ex nihilo [(à partir de
rien (ÉC)],
car le détenteur dun dépôt auprès dune banque le considère comme une encaisse
disponible, alors que, dans le même temps, la banque a prêté la plus grande
partie de ce dépôt, qui, redéposée ou non dans une banque, est considérée comme
une encaisse disponible par son récipiendaire. À chaque opération de crédit, il
y a ainsi duplication monétaire. Au total, le mécanisme de crédit aboutit à
une création de monnaie ex nihilo par de simples jeux décritures
(*).
(*) Ce nest quà partir de la publication en 1911 de louvrage
fondamental dIrving Fisher, The purchasing Power of money, quil a été
pleinement reconnu que le mécanisme du crédit aboutit à une création de
monnaie. »
Source : Maurice Allais, "Prix Nobel" de
sciences économiques, « La crise monétaire daujourdhui. Pour de profondes
réformes des institutions financières et monétaires. », Éd. Clément Juglar,
1999, p. 63.
Citation n°4, de Maurice Allais :
« Le jugement éthique porté sur le
mécanisme du crédit bancaire s'est profondément modifié au cours des siècles.
(...) À l'origine, le principe du crédit reposait sur une couverture intégrale
des dépôts. (...) Ce n'est que vers le XVII e siècle, avec l'apparition des
billets de banque, que les banques abandonnèrent progressivement ce principe.
Mais ce fut dans le plus grand secret et à l'insu du public » (...) « En abandonnant au secteur bancaire le droit de
créer de la monnaie, l'État s'est privé en moyenne d'un pouvoir d'achat annuel
représentant environ 5,2 % du revenu national. »
Source : Maurice Allais,
Prix Nobel déconomie 1988, La réforme monétaire, 1976).
Citation n°5, de Bernard Maris :
Création et destruction monétaire
« (
) Cest le principe fondamental de
la création monétaire : si je fais un crédit papier de 100 et si je sais quune
grande partie de ce crédit reviendra chez moi banquier, je peux multiplier le
crédit bien au-delà du stock dor dont je dispose. (
) Le mécanisme est décrit
dans ladage : « les prêts font les dépôts ». Le crédit fait les
dépôts, il fait largent. Et non linverse ! Avis à ceux qui croient que
lépargne fait largent. Quel contresens économique !
(
) Mais la vraie garantie de la
création monétaire, cest lanticipation de lactivité économique, du cycle production
consommation. Encore faut-il que cette anticipation soit saine : toute création
monétaire saine débouche sur une destruction monétaire équivalente.
(
) Nous percevons mieux la nature de la
monnaie : des dettes (des créances sur la banque émettrice) qui
circulent. Des dettes qui, si elles sont saines, doivent, par lactivité
économique, provoquer leur remboursement.
Aujourdhui, la monnaie
est détachée de tout support matériel, on peut en créer à linfini. »
Source : Bernard Maris,
professeur duniversité en France et aux États-Unis, « Anti-manuel
déconomie », éd. Bréal, oct. 2003, p. 219.
Citation n°6, de Bernard Maris :
Le déni d'existence
« Longtemps, les économistes ont
négligé largent. Les économistes libéraux, orthodoxes sentend. Encore
aujourdhui, nombre déconomistes considèrent que largent, la monnaie, ne sont
pas des questions en soi. La monnaie est neutre. Elle na pas dincidence sur
léconomie réelle (souligner dix fois), léconomie véritable, profonde, celle
qui parle des produits, des services, de lemploi, des prix.
Il y a deux aspects de léconomie,
disent les grands économistes classiques, Ricardo, Say, Smith, Malthus, et
après eux les grands monétaristes, Friedman, Patinkin, Lucas aujourdhui : 1)
léconomie déchange, où les produits séchangent contre les produits, le
travail contre des biens, par exemple, et, à côté, la monnaie. Elle est en plus.
Elle vient définir le niveau des prix, mais ça na pas dincidence fondamentale
sur le fonctionnement de la production, du commerce, et sur lemploi. Cela
paraît extravagant, mais cest comme ça ! Aujourdhui encore, en 2003, on
enseigne dans les universités la « théorie du cycle réel », Real Business
Cycle, qui sefforce dexpliquer les fluctuations cycliques des économies par
les goûts des consommateurs, le progrès technique, en supposant que largent
nexiste pas. (
)
Même les autoproclamés monétaristes,
comme le prix Nobel Milton Friedman, ont échafaudé leur scolastique pour
annihiler la monnaie, pour démontrer quelle navait pas dinfluence sur le
réel, sur la réalité des productions et des échanges, mais simplement sur les
prix. Cette conception aberrante de la neutralité de la monnaie ne
mériterait-elle pas, pour elle seule, quon rejette la théorie orthodoxe aux
poubelles des stupidités idéologiques ? Oui, mais il faut comprendre ce
que cache ce rejet systématique de la monnaie.
(
)
Pourquoi les
économistes classiques, néoclassiques, orthodoxes, monétaristes, nient-ils
largent ? Parce quils nient le pouvoir de lémetteur, le pouvoir du seigneur,
le seigneuriage, ils nient la politique, gravée sur le denier par leffigie de César,
et au-delà, [ils nient] tout ce que largent contient de « sociétal » (
)
Ricardo et les classiques considéraient
que le travail mesure la valeur des choses. Dès lors, il est clair que la
valeur relative des objets et des services sexprime en termes de travail : sil
faut deux fois plus dheures de travail pour produire une table quune chaise,
une table vaut deux chaises. On peut tout mesurer dans léconomie à partir des
chaises, tout exprimer en termes du numéraire « chaise », les voitures comme
les services davocat. Léconomie montre les échanges dobjets et de services
contre des objets et des services, chacun valant une certaine quantité de
travail.
Alors, à quoi sert la monnaie, les
pièces dor ? À rien, si ce nest à faciliter les échanges. « La monnaie est
un voile posé sur les échanges » disaient les classiques, une sorte de
fluide ou déther qui facilite la circulation des choses mais qui ne leur donne
aucune valeur, et qui elle-même nen a aucune. La valeur de lor est la
quantité de travail nécessaire à produire lor. Certes, lor est plus facile à
manipuler que les chaises pour léchange. Mais on aurait pu prendre des
coquillages ou des cigarettes comme unité de monnaie.
Supposons quune pièce de 1 euro circule
10 fois en une journée entre les consommateurs. 10 est la vitesse de rotation
de la monnaie, soit V. Supposons que le prix P des objets échangés soit de 2,
et que 500 objets soient échangés. La valeur des échanges de la journée est
donc 2 x 500 = 1000. Combien faut-il de pièces de monnaie de 1 euro, M, pour
permettre les échanges ? Il en faut 100, car 100 pièces qui circulent 10 fois
permettent de réaliser 1000 euros déchanges. On obtient donc une relation
comptable, une tautologie, que lon va baptiser « équation monétaire » : MV=PQ.
Cette équation résume toute la théorie
monétaire. Elle dit : la monnaie, multipliée par sa vitesse de circulation, est
égale au niveau général des prix multiplié par le volume des transactions. Elle valut un prix
Nobel à Milton Friedman. La monnaie fixe le niveau général des prix. Plus il y
a de monnaie en circulation, plus les prix augmentent. Mais léconomie réelle,
elle, ne bouge pas. La monnaie détermine seulement linflation : 10% de hausse
de monnaie en volume conduira à 10% de hausse de prix, cest mécanique. Dune
équation comptable, on a fait une théorie niant limpact de la monnaie sur
léconomie. Tout se passe comme sil y avait deux secteurs dans léconomie
: le secteur réel, les entreprises, les usines, le travail, les consommateurs,
et le secteur monétaire, une banque qui injecte de la monnaie et qui fixe les
prix.
Petit aparté : toute la conception
européenne de la Banque centrale, indépendante du pouvoir politique et
interdite de recevoir des ordres des gouvernements, tient à la « neutralité »
de la monnaie. La Banque centrale est là pour maintenir la valeur de la
monnaie, éviter quil y ait trop dinflation. Ne pas trop donner de monnaie
revient donc à faire des économies, car plus il y a de monnaie, plus les prix
augmentent. Cette obsession de la monnaie rare et forte relève de la
neutralité, de la théorie classique (Ricardo, Friedman).
Ordre des débiteurs et
ordre des créanciers
Mais pourquoi faut-il que largent soit rare ? Nous retrouvons ici notre
vieil ami, le problème économique, le problème de la rareté. Partout, les
économistes promeuvent la rareté. Largent rare sera cher, surévalué peut-être
même. Qui a de largent ? Les riches, les épargnants, ceux qui ont pu
accumuler ou hériter. Si le taux dintérêt est élevé, le taux dintérêt étant
le prix de largent, largent est demandé, il sévalue. Le capital est rare et
cher. Les créanciers, les détenteurs dargent, sont contents, tout comme les
prêteurs et les rentiers sont contents. Les rentiers dont les loyers des
maisons sont élevés. Les créanciers ont une certaine vision de lordre
économique.
Qui sont ces créanciers ? Des personnes riches, âgées. À qui prêtent-ils ? À
des personnes sans argent, des locataires ou des entrepreneurs, qui empruntent
pour leur entreprise. Ce sont des débiteurs. Ils préfèrent que largent soit
bon marché, et même quil se dévalue. Linflation ruine les créanciers et
enrichit les débiteurs. Un emprunteur, si la hausse des prix est constante,
et si son salaire suit cette montée, rembourse de moins en moins. Alors que les
salariés et les entrepreneurs sont contre largent cher, les épargnants et les
rentiers sont pour.
Lorsquune activité est endettée et ne
peut plus rembourser ses dettes par son activité, soit on la maintient sous
perfusion en lui donnant dautres crédits sans contrepartie, puisquil ny aura
pas de sa part création de richesses matérielles, soit on lui dit : « Fini !
Vous remboursez ! » Si elle ne rembourse pas, elle est mise en faillite, et
avec la faillite sopère un redéploiement de la propriété industrielle (ce que
Schumpeter appelait la destruction créatrice) : lordre des créanciers décide
de ce redéploiement. Plus de textile en France. Plus dacier de basse qualité.
En échange, se développent des services, des logiciels
Lordre des débiteurs, lordre
économique du point de vue des débiteurs, est radicalement opposé à celui des
créanciers. Lantagonisme débiteur-créancier est total : ce qui profite à lun
nuit à lautre. La lutte des débiteurs et des créanciers, terrible, occulte, est
une lutte pour la définition de la propriété industrielle : dans quels secteurs
les entrepreneurs sont-ils autorisés à travailler par lordre des créanciers ?
Ils peuvent se tourner vers Internet, par exemple, ce qui a créé une bulle
énorme et un endettement terrible des entreprises comme Vivendi ou France
Telecom. Lhistoire économique est faite de ces affrontements.
En 1976 en France, le
ministre Raymond Barre prend une décision historique : il décide que lÉtat paiera
les intérêts de sa dette au-delà du taux dinflation. Il dit : « Je place
lÉtat au service des créanciers, des épargnants. Finie linflation qui érode
le capital. Vive les rentiers ! » Fini lordre des salariés et des
entrepreneurs, finies les Trente Glorieuses, la monnaie se renforce, le chômage
augmente, les salaires stagnent, la rente réapparaît. Dix ans plus tard, en
2003, le partage du produit national sest fait au profit des créanciers : 10%
du PIB a basculé du côté du profit et de la rente. (
)
La mondialisation, dune certaine
manière, est un basculement de léconomie au profit des créanciers, des boursiers,
des rentiers, des financiers. »
Source : Bernard Maris, «
Anti-manuel déconomie », éd. Bréal, oct. 2003, p. 206 s.
Citation n°7, de Bernard Maris :
La Banque de France
« La Banque de France était à lorigine
une banque privée, dotée dune assemblée ou dun conseil de deux cents gros
actionnaires. Ces deux cents actionnaires les plus puissants de la place de
Paris ont donné naissance au mythe des « deux cents familles », les deux cents
familles bourgeoises contrôlant largent en France et cimentant le « mur de
largent », ce mûr contre lequel se heurtaient les gouvernements progressistes.
Les régents de la Banque de France étaient recrutés dans les deux cents
familles, les Mallet, Vernes, Rothschild, Hottinger, Wendel. La loi de Germinal
an XI définissait la parité du franc par rapport à deux métaux, lor et
largent, la Banque de France devant, statutairement, garantir la solidité du
franc, en contrôlant le volume de la création monétaire. En gros, la Banque
suivait le principe du « tiers » : le crédit consenti à léconomie était égal à
trois fois les réserves dor et dargent contenues dans les caisses. Cétait
une gestion prudente, et le franc germinal se révéla le plus solide de toutes
les monnaies, résistant le dernier à la crise de 1929 et restant convertible en
or jusquen 1926, alors que la livre, le dollar, le mark étaient depuis
longtemps inconvertibles. (Déjà politique du franc ultra fort, déflationniste,
qui fit dire à Keynes que « les français étaient des paysans assis sur leur tas
dor ».)
Mais les banquiers et les industriels du
conseil de la Banque de France, contrôlant le crédit, contrôlaient dune
certaine manière la politique de la France. Ainsi lÉtat sétait ruiné après la
guerre de 14. Les dépenses de reconstruction étaient importantes. Le chômage
menaçait. La politique coloniale était coûteuse. Les dépenses à caractère
social pointaient leur nez, léducation coûtait cher. En 1924, arrive au
pouvoir le Cartel des gauches, qui demande des avances à la Banque de France
pour boucler son budget. Une avance de la Banque de France à lÉtat, autrement
dit au Trésor, se traduit dans le langage populaire par : « faire marcher la
planche à billets ». Moreau, le régent de la Banque de France refuse. Herriot
le radical, Président du Conseil, démissionne ! La Banque de France a fait
chuter le gouvernement ! La gauche sest fracassée sur le mur de largent !
En 1934, Pierre Laval,
chef du gouvernement, et surtout Léon Blum, Président du conseil, en 1936, du
gouvernement du Front Populaire, soumettent la Banque de France à la tutelle
publique. Vincent Auriol, ministre des Finances du Front déclare : « Les
banques je les ferme, les banquiers je les enferme ! » Il décrète le franc
inconvertible. Les régents de la Banque de France, transformés en gouverneurs,
et des sous-gouverneurs sont nommés par lÉtat. En 1945, le général de
Gaulle, chef du gouvernement provisoire, nationalise la Banque de France :
cest fini. En même temps, les trois grandes banques de dépôt, le Crédit
Lyonnais, le Comptoir national descompte de Paris (CNEP) et la Banque
nationale pour le commerce et lindustrie (BNCI) sont nationalisées. Le
crédit est sous tutelle publique. LÉtat a recouvré son autorité sur la monnaie,
ce qui ne durera pas.
Retour de la création monétaire au privé
1945-1993 : presque un demi siècle de
tutelle publique. En fait, lÉtat cesse de contrôler le crédit en 1983, lorsque
le gouvernement socialiste décide darrimer le franc au mark, monnaie forte, de
stabiliser la France dans lEurope, et de laisser le contrôle du crédit et de
lémission monétaire (à nouveau !) à la Banque de France. LÉtat a donc
contrôlé le crédit de 1934 à 1983, pendant cinquante ans.
En 1993, lÉtat prend
acte de lindépendance de la Banque de France par la loi de décembre.
Désormais, le gouverneur est nommé mais ne peut plus être « démissionné » par
lÉtat. Il est interdit à la Banque de France de financer le déficit du
budget de lÉtat, autrement dit de faire marcher « la planche à billets ». Si
lÉtat a besoin de sous, quil les emprunte et quil les rembourse ! Les
nouveaux statuts de la Banque interdisent aux membres de son conseil (art. 1) «
de solliciter ou daccepter dinstruction du gouvernement ou de toute personne
». Et voilà. Le pouvoir politique est soumis. La dictature des rentiers a
triomphé.
Les statuts de la Banque de France, calqués (et « aggravés » en quelque sorte)
sur ceux de la Bundesbank, gardienne du temple de la monnaie forte, seront
copiés par la Banque centrale européenne. Lordre des créanciers règne en
Europe.
Aux États-Unis, cest linverse. La Banque fédérale de
réserve est responsable devant le Congrès. La planche à billets fonctionne
toujours. Le statut dhyper puissance permet aux États-Unis daccaparer, chaque
année, les deux tiers de lépargne nouvelle dans le monde, essentiellement en
provenance de lEurope et du Japon. Les États-Unis, souverains du monde,
fonctionnent selon le principe régalien de la création monétaire.
Voilà une question
essentielle déconomiste : qui fabrique largent qui nous fait vivre ? Au
profit de qui ? Pour quelles activités ? De 1945 à 1976, lÉtat fabrique
largent au profit de la reconstruction, puis de la croissance. Et puis, après
cette très brève parenthèse du capitalisme, le privé reprend ses droits. »
Source : Bernard Maris, «
Anti-manuel déconomie », éd. Bréal, oct. 2003, p. 221 s.
On comprend avec ce dernier extrait que rien n'est
inéluctable et que la lutte politique permet de progresser.
Citation n°8, de Éric Dillies :
Naissance de la Banque d'Angleterre
« "Le passé est pour les
économistes l'objet d'un mépris sans borne". Ainsi s'exprimait
Tocqueville dans "L'Ancien Régime et la Révolution". En effet,
s'il est un événement peu connu dans l'histoire économique, c'est bien celui de
la naissance de la Banque d'Angleterre. Guillaume d'Orange, gendre de Jacques
II qui s'était converti au catholicisme, usurpa le trône d'Angleterre après la
Révolution de 1588.
Gaston Bardet écrit qu'"en 1694,
Guillaume d'Orange, devenu Guillaume III d'Angleterre; n'avait
plus d'argent pour payer son armée. Ce hollandais dont le succès avait été
financé par les banquiers protestants de son pays, va juste retour des choses
être pris dans l'engrenage des usuriers anglo-hollandais. Un syndicat
d'usuriers, dirigé par William Paterson, lui proposa la combinaison suivante :
a) Le syndicat privé
avancera au gouvernement un prêt en or de 1 200 000 livres au taux de 6 %,
le capital et l'intérêt étant garanti par l'État et payés en or ;
b) En récompense, le
syndicat privé a le droit de s'appeler Banque d'Angleterre ;
c) Comme le syndicat se
démunissait de tout son capital pour financer le prêt, il avait en échange le
droit d'émettre et de négocier des billets à ordre jusqu'à concurrence des 1 200 000 livres prêtées en or à
l'État".
Ainsi l'Angleterre
fut le premier État à se départir de son droit régalien de battre monnaie au
profit d'un "syndicat privé" (à l'intérieur duquel Isaac Newton était
grand Maître de la monnaie), qui s'en arrogeait le droit contre un intérêt...
financé par l'impôt.
Si l'on veut aller plus loin, l'une des causes
fondamentales de la Révolution d'Indépendance des États-Unis fut provoquée en
1751 par l'Angleterre qui obligea ses colonies d'Amérique à utiliser dorénavant
sa monnaie à intérêt au lieu de leur monnaie gratuite. Et d'après Benjamin Franklin
"La Nouvelle Angleterre mit moins d'un an à passer de la plus extrême
prospérité au plus extrême marasme".
Irruption de la monnaie de crédit dans
la pensée économique
1) C'est certainement à l'uvre de Clément
Juglar (1859-1905) : "Des crises commerciales et de leurs retours
périodiques", en 1860, que l'on doit la connaissance de la première
intrusion de la monnaie de crédit dans l'économie.
En effet, Juglar constate que l'économie
enchaîne des phases de croissance rapide et de récession en des cycles de 7 à
10 ans. Après avoir rejeté comme origine de crises, les saisons
agricoles et climatiques, retenues par Jevons (1835-1882), il considère
qu'elles sont le produit du mécanisme monétaire de l'économie de marché et
des variations de la masse monétaire et du crédit. Ainsi, les banques prêtent au-delà de leurs encaisses métalliques
grâce aux billets de banque jusqu'au jour où la confiance des agents
économiques disparaît et entraîne la conversion de leurs avoirs en or. Cela
entraîne des faillites de banques, la réduction drastique de la masse monétaire
et la récession jusqu'au retour à l'équilibre.
On le voit, contrairement aux [sornettes et superstitions] classiques,
l'équilibre économique est instable et la monnaie intervient directement dans
l'économie.
2) Knut Wicksell
(1859-1926), économiste suédois, est le premier à reconnaître l'importance du
système bancaire dans l'offre de crédit. Il met en évidence que ce n'est pas l'épargne qui paie les investissements
mais le crédit bancaire par la monnaie scripturale.
Il sépare épargne et
investissement et montre que ce ne sont pas "les dépôts qui font les
crédits mais les crédits qui font les dépôts", et démontre par là
l'inanité de la loi de Say. Ce n'est pas l'offre qui crée sa propre demande,
mais le crédit.
Je pourrais citer d'autres exemples qui
ne feraient que confirmer l'intuition selon laquelle la monnaie n'est ni
neutre, ni externe. Comme le pensait Schumpeter (1883-1950),
par le crédit la monnaie est au commencement de l'économie capitaliste, et le
banquier "est l'éphore de l'économie d'échange". "La
monnaie préexiste aux marchés" rappelle Michel Aglietta.
(
)
D - Les instruments de la Banque
Centrale
Le système est dit hiérarchisé car les
agents économiques empruntent auprès de leurs banques secondaires qui se
refinancent auprès de la Banque Centrale au taux de réescompte.
Il est appelé à réserves fractionnaires,
car chaque banque secondaire doit avoir un compte auprès de la Banque Centrale
où elle doit déposer des réserves, en monnaie fiduciaire, non rémunérées.
Et chaque emprunt nouveau de la part
d'un agent économique doit être gagé pour partie en monnaie centrale
(actuellement entre 1 et 5 %).
Pendant "les
Trente Glorieuses", 80 % des financements accordés aux agents
économiques (ménages et entreprises) se faisaient par le canal bancaire et
permettaient un pilotage direct de la masse monétaire par la Banque Centrale.
Avec l'ouverture des marchés monétaires
aux entreprises au début des années 80, les banques secondaires ont perdu leur
monopole de financement. On a appelé cela la désintermédiation bancaire.
La déréglementation des marchés sous la pression des firmes multinationales
s'est faite sous le couvert du renouveau des idées libérales. En effet,
l'ouverture des marchés financiers était perçue comme un moyen de limiter le
niveau des taux d'intérêt, grâce à la concurrence, et d'assurer une allocation
optimale des moyens de financement. La substitution s'est faite rapidement car
les crédits bancaires ne représentent plus que 20 % du financement de
l'économie.
Le seul instrument qui reste à la Banque
Centrale pour piloter la politique monétaire est le taux d'intérêt ou taux
directeur établi par les appels d'offre ou les prises en pension (l'appel
d'offre est l'un des deux outils de la politique monétaire de la Banque
Centrale). Deux fois par semaine, après consultation des banques, la Banque
Centrale procède à l'achat ou à la vente sur les marchés financiers d'un
certain volume de titres (bons du trésor) qu'elle échange contre de la monnaie
au taux d'appel d'offre. La prise en pension est le deuxième outil de la
politique monétaire. Au lieu d'acheter et de vendre des titres, la Banque
Centrale peut "prendre en pension" pendant cinq à dix jours, des
effets de commerce détenus par les banques en échange de la monnaie au taux de
prise en pension).
Dans "La monnaie dévoilée",
Galand et Grandjean étudient les
conséquences du pilotage de la politique monétaire par les taux d'intérêts. En résumé, pour relancer l'activité, la Banque
Centrale baisse les taux qui facilitent le crédit et dynamisent l'économie.
Mais pour éviter l'emballement par le levier du crédit, la Banque Centrale va
augmenter ses taux progressivement et rendre l'investissement non rentable,
produisant par là même le retournement de conjoncture. Mais comme les effets de
cette politique se font sentir dans une période de 6 à 18 mois, l'économie
retombe en récession sans que la Banque Centrale puisse l'éviter.
Le cycle de ce "stop and
go" est non seulement inefficace mais démontre l'instabilité
intrinsèque de toutes économies financées par la monnaie d'endettement. À cela s'ajoute, dans
une économie mondialisée où chaque pays s'endette de plus en plus avec
l'extérieur, la contrainte du taux de change. Pour maintenir le taux de change,
la Banque Centrale doit rendre attractive sa monnaie par des taux d'intérêt
suffisamment élevés. La Banque Centrale doit donc arbitrer entre croissance
économique et stabilité des changes.
Pour des raisons
d'unification monétaire, Bérégovoy, Balladur et Juppé ont choisi la deuxième
solution et ont jeté des millions de personnes dans la misère et la pauvreté,
réduisant la politique économique au "traitement social du
chômage".
Or, nous rappelle Jean-Paul
Fitoussi, président de l'OFCE, le taux d'intérêt est la variable
sociale par excellence, car plus il est élevé, plus il va récompenser les
richesses accumulées au détriment des futurs créateurs de richesse qui ne
pourront emprunter à cause de la cherté de l'argent. Il va déprécier le futur
et lui préférer le présent en donnant de l'importance au passé. Il empêche
toute mobilité sociale et renforce les inégalités.
Aussi, comme l'avait
parfaitement compris Keynes, dans une économie
d'endettement, il faut euthanasier le rentier-accumulateur au profit du
débiteur-créateur par des taux d'intérêt nominaux inférieurs aux taux d'intérêt
réels. Ce fut, entre autres, la politique des Trente
Glorieuses.
E - Les marchés financiers
Il y a une quinzaine de jours, M.
Kessler (celui du MEDEF, pas le grand écrivain) expliquait que les marchés financiers
qui ont mauvaise presse, ne sont en fait que le marché mondialisé de
l'allocation optimale de l'épargne de chacun d'entre nous. Ce n'est pas faux,
mais est-ce seulement cela ?
Pour comprendre ce qui se cache
derrière, faisons un peu d'histoire, chose que les économistes n'aiment pas,
comme le rappelait Tocqueville.
Au sortir de la seconde guerre mondiale
fut institué par les accords de Bretton-Woods,
un système de change fixe reposant sur un dollar convertible en or (35
dollars l'once). Morgenthau, secrétaire au Trésor, avait voulu
faire du dollar le reflet de la suprématie totale de l'Amérique dans le domaine
politique, industriel et financier et "mettre le dollar au centre du
système monétaire international" (Michel Aglietta, le FMI).
Il fallait, pour cela, "transférer
le centre financier du monde de Londres et de Wall Street vers le gouvernement
des États-Unis". Car, comme le rappelle Armand Van Bormael,
dans La guerre des monnaies, après la crise de 29, "seul
le contrôle de la politique monétaire et financière par les autorités pouvait
assurer le plein-emploi, des prix stables et le bien être général". Et Morgenthau
avait la ferme intention de "chasser les usuriers du
Temple de la finance internationale".
Ce système a relativement bien
fonctionné jusqu'à la fin des années cinquante, période de redémarrage des
économies européennes favorisant les échanges, donc... des transactions
financières. Les banques américaines répondant à la demande de médiation et de
crédit de la part des entreprises européennes, installèrent des succursales en Europe, en particulier
à la City de Londres où les contraintes financières étaient quasi inexistantes.
Ainsi, ces succursales
émirent des lignes de crédits pour financer les entreprises et... les déficits
publics des états européens. L'Eurodollar était né, c'est-à-dire des dollars
émis de l'étranger et circulant à l'étranger en dehors du contrôle de la Federal
Reserve.
L'apparition de
l'eurodollar sur la scène internationale est équivalent à ce que fut, au XIXe
siècle, l'apparition de la monnaie de crédit. On assista sur l'euromarché,
libéré de toutes contraintes étatiques, au miracle de la multiplication des
pains : un empilement gigantesque de moyens de paiement privés n'ayant
comme contrepartie que "la plume du comptable" comme le
rappelle Milton Friedman.
Face à la multiplication des
Eurodollars, les États-Unis se retrouvèrent dans l'incapacité d'assurer la
convertibilité en or du dollar, et le 15 août 1971, Richard Nixon décida
de laisser flotter le dollar.
Avec la naissance de l'Eurodollar, les
banquiers avaient remporté leur première victoire sur les États ; avec les
changes flottants, ils venaient d'en remporter une seconde. En effet, avec
l'instabilité des changes, chaque transaction internationale devenait
périlleuse et obligeait chaque opérateur à s'assurer contre les risques de
changes. Le marché des changes était né et procurait aux banquiers de
confortables bénéfices d'un système qu'ils avaient instauré.
En 1965, les eurodollars représentaient
11 milliards de dollars, en 1972, 82 milliards, en 1980, 700 milliards. Aujourd'hui,
" une masse de plus en plus monstrueuse de monnaie apatride en progression
géométrique, dont le total dépasse 4 000 milliards de dollars, est animée
de mouvement échappant à tout contrôle et à toute justification économique
réelle ". Jean Remy, Aux sources de l'erreur libérale.
Actuellement, le marché des changes totalise 1 500 milliards par jour et
le montant des engagements de gré à gré sur les marchés dérivés atteint
72 000 milliards de dollars.
Comme le signale Maurice
Allais, tout ceci ne fut rendu possible que par la multiplication des
"faux-droits", par la création ex nihilo de moyens de paiement
privés qui accaparent la planète. Pour conclure, je citerai Jean Remy
parlant de l'internationalisation des monnaies rendues pleinement
convertibles et donc privatisées : "cette privatisation bien que résultant
de la volonté des États, porte en elle-même dans un effet de rétroaction, la
destruction de leurs souverainetés".
V - Monnaie et Souveraineté
A - La souveraineté mondiale
Après ce survol rapide de l'évolution
monétaire, nous voilà ramenés au dilemme de départ: la monnaie est-elle un bien
public ou un bien privé ?
Face à cette privatisation du monde,
deux postures se dégagent. La première est de dire que face à la mondialisation
par le privé, il faut opposer une mondialisation par le public. Il faut faire,
à l'échelle mondiale, ce qui s'est produit au début du XXe siècle et en
particulier après la crise de 29 au niveau national : la Banque Centrale
qui encadre et qui gouverne le crédit, donc le pouvoir financier. Les
institutions pour accomplir cette mission existent déjà en germes, l'ONU pour
édicter les règles de droit, le FMI, comme prêteur en dernier ressort. C'est la
thèse de nombreux économistes dont Michel Aglietta est la figure
emblématique.
La fonction de prêteur en dernier
ressort est apparue à la fin du XVIIIe siècle et a été conceptualisée par Bagehot,
banquier et économiste, en 1873. "En cas de crise, le prêteur en
dernier ressort assure la liquidité des banques de second rang, de façon à leur
permettre de faire face à leurs engagements. En se posant comme ultime recours
dans les périodes de "courses à la liquidité", la Banque Centrale
apporte au marché la régulation qu'il ne peut trouver en lui-même". Ruffini
op. cit.
Cependant, cette gouvernance mondiale ne
règle pas le problème de l'émission anarchique de crédit. Et comme
le défend Maurice Allais, à la suite de Hayek et de
Fisher, seule une couverture intégrale des dépôts à vue et a
terme, peut mettre un terme à "la spéculation gigantesque que l'on constate
[...] parce que l'on peut acheter sans payer et vendre sans détenir".
C'est-à-dire que chaque crédit émis doit correspondre à une épargne
correspondante.
Comme cette condition sine qua non
pour assainir la finance n'est pas réclamée par les défenseurs de la gouvemance
mondiale, ce droit exorbitant de prêteur en dernier ressort peut être assimilé
à un pousse-au-crime : en effet, le banquier prête jusqu'au-delà du
raisonnable, et la Banque Centrale intervient pour rembourser le créancier
avec l'argent... des contribuables (cf. L'affaire du Crédit Lyonnais et des
caisses d'épargne américaines).
Dans un tel système, le banquier peut
s'écrier "pile je gagne, face tu perds". On appelle cela
pudiquement l'aléa moral.
D'ailleurs, le FMI s'en est bien rendu compte,
car dernièrement il a refusé d'intervenir dans l'affaire argentine, laissant
les créanciers en face de leurs responsabilités.
L'autre reproche que l'on pourrait faire
à cette thèse est : "Comment une autorité mondiale pourrait-elle s'imposer
et faire respecter l'universalité de ses lois à des pays aussi différents, aux
intérêts aussi divergents, sans l'avènement d'une puissance
impériale ?" Les États-Unis pourraient éventuellement, à terme,
assurer ce rôle, mais il faudrait une crise autrement plus grave que celle du
11 septembre.
Face à cette impasse idéologique, il
faut faire un retour à l'État national.
B - Le droit régalien de battre monnaie
Il est de bon ton depuis la révolution
monétariste initiée par Milton Friedman de reprendre le célèbre jugement de
David Ricardo : "l'expérience prouve
que toutes les fois que le gouvernement ou une banque ont eu la faculté
illimitée d'émettre du papier-monnaie, ils en ont toujours abusé".
Pour le courant monétariste, la monnaie est chose trop sérieuse pour la laisser
entre les mains des gouvernants.
[Curieusement], cela ne semble pas
heurter les monétaristes que ce pouvoir illimité ait été confié à des intérêts privés.
Maurice Allais rappelle que "pendant
des siècles, l'Ancien Régime avait préservé jalousement le droit de l'État de
battre monnaie et le privilège exclusif d'en garder le bénéfice ; la
république démocratique a abandonné pour une grande part ce droit et ce
privilège à des intérêts privés. Ce n'est pas le moindre paradoxe de notre
époque".
Maurice Allais a démontré de manière
définitive que l'origine de l'inflation est due essentiellement à la
multiplication des moyens de paiement par la création ex nihilo dans les
banques secondaires, entraînant l'inflation qui a détruit l'épargne dans les
années soixante-dix. Si elle n'apparaît plus actuellement, c'est à cause des politiques
restrictives menées depuis 20 ans, qui ont pour but de contracter la masse salariale,
donc la demande solvable, mais elle est bien présente sur les marchés
financiers.
Maurice Allais
propose donc l'interdiction totale de toute création monétaire à l'intérieur
des banques secondaires par le taux de couvertures intégrales des prêts, et
l'exclusivité de l'émission monétaire à la Banque Centrale.
C - Conséquences pour notre économie
Il est un phénomène curieux qui ne cesse
d'interroger les politiques et les économistes, c'est la progression croissante
de la dette publique. De 79 milliards de francs en 1975, elle est passée
à plus de 5 000 milliards en 2000. Elle est concomitante à la progression
des marchés financiers.
Pourtant cela s'explique très
facilement. Jusque dans les années
soixante-dix, l'inflation était supérieure au taux d'intérêt, donc l'intérêt
réel (intérêt nominal déduit de l'inflation) était négatif et favorisait le
débiteur-investisseur face au créancier. Cela dynamisait l'économie car le
poids de la dette diminue avec le temps.
Sous l'influence des
idées monétaristes, les États se mirent à lutter contre cette inflation en
augmentant considérablement les taux d'intérêt, rendant le taux d'intérêt réel
positif. En 1973, une loi interdit tout concours de la Banque Centrale au
trésor, c'est-à-dire pour 1'Etat de créer de la monnaie.
Face à ce renversement, les entreprises
virent leurs projets devenir moins rentables, voire pas rentables du tout. La
longue litanie de faillites et de chômage commença. Cette politique
restrictive, dite aussi de désinflation compétitive, obligea les entreprises à
augmenter leur autofinancement car elles ne pouvaient plus accéder au crédit
devenu usuraire, en comprimant la masse salariale et diminuant par là même la
demande solvable.
Comme la nature a horreur du vide, c'est
l'État, contraint et forcé, qui se substituera au désendettement des
entreprises et des ménages en voyant sa dette croître de manière géométrique,
entre autres à cause de la montée inexorable du chômage.
Les États, pris dans le piège récessif
firent appel aux marchés financiers pour emprunter, alourdissant par la charge
des intérêts le poids de la dette. En 1995, les intérêts de la dette
représentaient 19 % des recettes fiscales, soit 72 % de l'impôt sur le revenu.
En refusant d'exercer son droit régalien
de battre monnaie, l'État s'est mis à l'encan [sest vendu au plus offrant] des financiers au
détriment de tous. Or comme l'enseigne Abraham Lincoln, "le privilège de créer de la monnaie est le
plus opportun dessein d'un gouvernement. Par l'adoption de ces principes, le besoin
ressenti depuis longtemps d'uniformiser la monnaie aux besoins sera satisfait.
Les assujettis aux taxes seront libérés des intérêts. L'argent cessera d'être
le maître pour devenir la servante de l'humanité".
D - Le caractère récessif de l'économie d'endettement
Il y a près de 80 ans, le Major
Clifford Hugh Douglas, fondateur du "social credit
movement" mettait en évidence avant la crise de 1929, par le théorème
A + B, le caractère nécessairement récessif des économies d'endettement.
Chaque prix d'un bien se décompose en
deux parties. L'une A, comprend les salaires et les revenus immédiatement
disponibles. L'autre B, est formée des charges fixes, financières, sociales,
fiscales et des bénéfices réinvestis. Elles ne sont pas immédiatement
disponibles. Le prix du produit est formé de A + B, or seul A est immédiatement
disponible. Donc pour acheter A + B, il faut faire appel au crédit. Et
plus la production va croître et plus la dette va devenir pesante.
Tovy Grjebine, par sa "théorie
séquentielle de la récession" qu'il expose dans Récession et
Relance et Théories de la crise et politiques économiques arrive à la même
conclusion. Il remarque cependant que dans
une économie en croissance, tant que les agents économiques augmentent leurs
endettements, la production peut être écoulée. Mais quand ils atteignent le
seuil d'endettement, et ne peuvent plus aller au-delà, les stocks d'invendus se
forment, l'économie entre en récession.
Toute croissance économique
suppose une croissance de la masse monétaire similaire. Mais il est fondamental
que cette croissance monétaire n'ait pas comme contrepartie une dette.
Il est intéressant de noter qu'Aristote
est hostile à toute forme d'intérêt et qu'à l'origine, la monnaie est considérée
comme un moyen d'éteindre la dette [cf. notre citation d'Aristote plus haut]. .
Grjebine considère alors que seul l'État est capable de changer les contreparties
de la monnaie et opérer le désendettement de tous les agents économiques par la
mise en place d'une monnaie libre et franche d'intérêt, en permanence au
service de la communauté.
S'il est à la fois sain et nécessaire de
désendetter notre économie, M. Grjebine signale que si 25 % des entreprises le
faisaient en même temps, cela entraînerait l'effondrement de l'économie par la
diminution drastique de la masse monétaire.
Toutes les études démontrent que la
monnaie endogène ou de crédit est nécessaire pour stimuler l'économie mais
qu'elle n'est qu'un palliatif qui se révèle à terme pire que le mal. Il faut donc remplacer la monnaie d'endettement par
une monnaie permanente.
E - la politique de changement des
contreparties de la monnaie
Initiateur et
concepteur de la proposition de loi organique 157 déposée par l'intergroupe conjoncture
à l'Assemblée Nationale en 1981, Tovy Grjebine proposait de stimuler
le désendettement des agents économiques par des crédits d'impôt correspondants. Ce qui, nécessairement,
entraînerait l'augmentation du déficit public qui serait compensé par une
injection égale de monnaie de la Banque Centrale.
Il n'y aurait pas
d'augmentation de la masse monétaire mais simplement changement des contreparties
de la monnaie qui assainirait l'économie et diminuerait la charge des frais
financiers. L'opération pourrait être renouvelée plusieurs années de suite,
elle stimulerait l'économie. Des études prospectives ont été faites en
France et aux États-Unis qui donnèrent comme résultat une
croissance de 5 % par an et une éradication du chômage en une législature.
Malheureusement ce projet de loi ne fut
examiné qu'en juillet 1981. Le nouveau gouvernement socialiste avait pris une
autre voie dont chacun se souvient des pitoyables résultats.
Avant de conclure ce chapitre et
d'aborder le dernier par un aperçu historique des politiques de relance par le
désendettement, je citerai cette phrase de Marcel Macaire,
professeur d'économie à Nanterre : "la création monétaire
par la Banque Centrale est par nature une dette sans créancier puisque l'État
se prête à lui-même. C'est parce qu'il se croit obligé d'en avoir, qu'il
emprunte à d'autres que lui-même et crée de ce fait un déficit budgétaire.
C'est cette méprise et elle seule qui crée la dramatique situation du chômage
dans laquelle nous nous débattons aujourd'hui".
VI - Aperçu historique des politiques de
relance
A - Moïse
Curieusement la première analyse sur
la tyrannie de la dette et les moyens de s'en défaire se trouve dans le
Lévitique 25, 10-11: Un des livres du Pentateuque que la tradition attribue à
Moïse (treize siècles av. J-C). Il proclame l'extinction de toutes les
dettes et la libération de tous les hébreux mis en esclavage pour cause de
dettes tous les 49 ans, année du Jubilé. Ce texte n'est évidemment pas
argumenté puisque c'est un décret divin, mais l'on ne peut qu'y constater sa
pré-science dans une économie non monétaire.
Je signale qu'un gramme
d'or épargné à la naissance de Jésus Christ à 3,25 % par an représenterait
actuellement 6,1026 tonnes d'or, soit l'équivalent de la masse de la
terre.
Deux économistes genevois, Dembinski
et Bovin ont repris récemment l'idée jubilaire de remise des dettes
et de créances dans Rapport moral sur l'argent dans le monde, 2000 (www.obsfin.ch).
B - L'Antiquité
Le monde grec traversa au VIIe siècle
av. J-C. une crise qui fit croître les domaines des grands propriétaires
terriens et réduisit les paysans pauvres à la misère et à l'esclavage pour
dette. Constatant que l'armée athénienne se réduisait de manière dramatique
(car seuls les hommes libres pouvaient combattre), Solon (640-561) libéra
les athéniens mis en esclavage et éteignit toutes les dettes. Il procéda en
même temps à une dévaluation de 30 % et développa l'artisanat en vue de
l'exportation.
Petite ville au VIIe siècle, Athènes
était devenue une ville prospère au début des guerres médiques (490-479). Mais,
c'est à la suite de la découverte des nouveaux
filons argentifères dans les mines du Laurion, qu'Athènes doit sa splendeur.
En effet, cet afflux soudain de métal précieux fut utilisé par Thémistocle
(524-459) en 483 pour la construction d'une flotte gigantesque de 200 trirèmes
qui lui permit de remporter la victoire de Salamine en 480 contre les Perses.
Il assurait à l'avenir l'hégémonie d'Athènes sur le monde grec jusqu'à la fin
de la guerre du Péloponnèse en 404. La ville d'Athènes tirait
l'essentiel de ses ressources de l'exploitation des mines lui procurant une
richesse inégalée dont il reste encore actuellement tant de vestiges.
Face à l'afflux de richesses, les
Athéniens étaient confrontés au danger de l'accumulation et de la thésaurisation.
Ils l'évitèrent par une politique active de grands travaux (la construction du
Pirée, de l'Acropole...) et par les lois de liturgie qui obligeaient les
citoyens les plus riches et les métèques à des dépenses de service public dont
la plus coûteuse était l'équipement des trières.
Il est intéressant de
noter que la chute d'Athènes, d'après Thucydide, fut due à la trahison d'Alcibiade
qui conseilla aux Spartiates d'occuper en 413 la Décélie qui contrôlait les
mines du Laurion. Alcibiade ajouta "des richesses que compte le pays,
la majeure partie vous reviendra" et du même coup, "les
Athéniens se trouveront privés des revenus des mines d'argent du Laurion"
[Histoire de la guerre du Péloponnèse, VI, chap. XCI].
À l'origine, Rome ne connaissait que la
monnaie de bronze, l'as qui suffisait aux échanges de la cité. Mais à la fin du
IIIe siècle, la deuxième guerre punique (218-202) contre Carthage entraîna des
dépenses telles que Rome dut faire appel à l'emprunt privé. Dans l'incapacité
de rembourser ses créanciers, Rome dévalua progressivement sur 16 ans des
5/6èmes de sa valeur, monétisant en grande partie l'Ager Publicus.
Heureusement, la victoire souriait aux Romains qui s'accaparèrent les mines
argentifères espagnoles de la région de Carthagène jusqu'alors sous domination
carthaginoise qui rapportèrent à Rome 25 000 deniers d'argent par jour.
L'État romain conserva jusqu'à sa chute
le monopole de la frappe des monnaies dont les quantités quintuplèrent
annuellement entre 140 et 90 avant J.-C., pour se stabiliser jusqu'à
l'avènement de l'Empire. Pour avoir un ordre de grandeur, quelques années de
monnayages romains représentaient l'équivalent d'un siècle de monnayage
athénien. Cependant, Rome connut de nombreuses crises d'endettement et de
paiement, en particulier au 1er siècle avant notre ère, qui étaient
souvent dues à des crises extérieures comme la guerre d'Asie contre Mithridate
(89-85 av. J-C) qui entraînaient la perte de confiance, la rides publica,
la thésaurisation et le manque de liquidités, l'inopia nummorum. L'État
procédait alors à des injections massives par le canal des dépenses militaires,
décidait un moratoire des dettes et octroyait des crédits d'impôt.
L'équilibre serait rétabli avec la victoire par le butin ou le tribut. Ainsi
l'Asie et la Grèce seront pressurées de telle manière que cela prendra des
allures de cataclysme économique. Son " endettement " vis-à-vis de
Rome était de 720 millions de deniers qu'il faut rapporter à ce que coûtait la
distribution de blé annuelle à Rome, 15 millions, soit à peine 2 % de la dette
de l'Asie.
Un autre phénomène
intéressant est l'absence de dette publique à Rome. Différence notable avec
l'Occident qui connut le problème insurmontable de la dette publique dès le
début du XIVe siècle et créa une classe inconnue de l'Antiquité : les
financiers. Claude Nicolet
dans Rendre à César, conclut que "l'absence de dette publique
explique que les entreprises financières et le système de crédit ne se soient
pas transformés à Rome". Rome ne connaissait pas la monnaie
d'endettement.
L'observation de l'histoire monétaire
nous montre que toute grande renaissance politique fut précédée par un
afflux massif de numéraire. Le siècle d'Auguste, le "siècle
d'or", fut financé par le pillage des temples égyptiens après la victoire
d'Actium contre Marc-Antoine, la renaissance carolingienne par la découverte de
mines d'argent en Dacie, la Renaissance par l'afflux d'or des Amériques, la
révolution industrielle en Europe par la découverte des mines d'or de
Californie...
C - L'époque contemporaine
Mais ceci s'est produit
sous le régime de la monnaie métallique. Il en va autrement avec la
monnaie d'endettement dont nous avons vu qu'elle résout le problème de l'écart
récessionniste en le reportant dans le temps jusqu'au moment où est atteint
le seuil d'endettement qui ne permet plus de l'utiliser, c'est alors la crise.
Or, la crise la plus exemplaire et qui a
laissé le plus de traces dans la mémoire européenne est celle de 1929.
Sans entrer dans les détails, son origine est due au rétablissement de la
convertibilité du Franc et de la Livre en or en 1925-1928.
En effet, dans le système de Gold
Exchange Standard, l'or se trouvait aux États-Unis et uniquement le dollar
était convertible. Churchill et Poincaré en
rétablissant la convertibilité de leur monnaie, échangèrent des dollars contre
de l'or, ce qui diminua le stock aux USA, et qui par contrecoup réduisit la
part de la monnaie permanente dans la masse monétaire. Les premiers
signes d'essoufflement de l'économie américaine apparurent au début de 1929.
Malgré les discours rassurants, la
production industrielle se mit à baisser. Dès septembre, la spéculation boursière
financée essentiellement par le crédit bancaire commença à montrer des signes
d'inquiétudes, les ventes s'accélérèrent et en octobre, le jeudi 24, les prix
dévissèrent entraînant dans leur chute la faillite du système bancaire
américain.
La répercussion en Europe ne se fit pas
attendre, et dès les premières semaines de 1930, elle entrait en dépression.
L'Allemagne et l'Autriche furent les plus touchées car leurs économies étaient
extrêmement liées au secteur bancaire américain (qui avait prêté énormément par
les plans Dawes et Joung décidés à la Conférence de Gênes en 1922. Il s'agit à
l'époque de trouver une solution aux questions des réparations).
En 1931, la moitié du système bancaire
allemand et autrichien avait fait faillite, entraînant une diminution formidable
de la masse monétaire en jetant dans la misère des millions de personnes. En 1932, l'Allemagne connaîtra 7 millions de chômeurs, et
25 % de la population sera plongée dans la mendicité.
Face à l'incapacité de la République de
Weimar et face au péril de la révolution bolchevique, les Allemands se jetèrent
dans les bras d'Adolf Hitler en janvier 1933, seule planche de salut dans un
monde qui venait de chavirer.
Ici apparaît un homme,
ignoré de l'histoire économique et dont il faut remercier M. Grjebine d'avoir
eu le courage de le ressusciter, M. Ernst Wagemann. Il rentrait
des États-Unis, où il enseignait l'économie, avec une solution : ce que
nous vivons actuellement est le contraire de l'hyper-inflation du début des années
vingt où il y avait trop de monnaie en circulation par rapport à la production.
Maintenant, nous sommes en déflation, il manque de la monnaie par rapport à
la production. Il faut donc en émettre. La nouvelle équipe dirigeante
fut séduite et Schacht, le magicien de la finance, fut chargé d'appliquer cette
solution.
Il est intéressant de signaler que la
préface de la Théorie Générale de J. M. Keynes, publiée en 1936, était
consacrée à la politique du docteur Schacht et faisait l'apologie de la méthode
de préfinancement de l'économie par le troisième Reich. Cette méthode était
considérée par l'auteur comme le seul moyen efficace de lutter contre la crise
et le chômage. Mais Keynes ne s'arrête pas là, et au cours de son ouvrage, il
défend les thèses de Silvio Gessell et du major Cliford Hugh Douglas et
pense qu'il y a encore beaucoup à trouver dans ces deux économistes qui sont
restés dans l'anonymat.
En quoi
consistait-elle ? L'État passa commande de travaux auprès des
entreprises privées qu'il paya avec des bons de travail escomptables auprès de
la Banque Centrale. Les entrepreneurs payèrent leurs salariés et leurs
fournisseurs avec ces moyens de paiement, qui furent ensuite présentés et
escomptés auprès d'une banque secondaire qui elle-même les présenta et se les
fit escompter auprès de la Reichbank, qui ne se les fit jamais rembourser par
l'État. L'État avait procédé à une émission ex nihilo de monnaie permanente. Les résultats ne se
firent pas attendre ; en 1937 le chômage avait disparu, l'économie connaissait
une croissance formidable et en 1938, l'Allemagne dut faire
appel à de la main-d'ceuvre étrangère.
L'expérience venait de
démontrer que l'argent n'est pas gagé parce qu'il y a derrière lui, mais
parce qu'il y a devant, le travail et la production de la communauté.
En 1938, aux États-Unis, malgré les
plans de relance par le déficit public, le chômage touchait encore 8 millions
d'américains. Les bruits de bottes venant d'Europe se faisant entendre, le gouvernement
fédéral décida la loi prêt-bail de financement de l'effort de guerre. Il émit
des bons du trésor qui furent rachetés par la Federal Réserve. 20 % de l'effort
de guerre furent financés par ce principe. En 1941, les États-Unis ne
connaissaient plus le chômage.
D'autres expériences ont été menées
depuis. Pendant les Trente Glorieuses parce qu'on appelle "le circuit
du trésor", au Japon entre 1975 et 1980 et plus récemment aux
États-Unis en 1991, la Federal Réserve a monétisé 100 milliards de dollars
de bons du trésor dont chacun a pu mesurer les conséquences par l'expansion et
le dynamisme de l'économie américaine pendant 7 ans.
Conclusion
Pour reprendre une
métaphore chère aux Anciens, la monnaie est à l'économie ce que le sang est
au corps humain; s'il en manque, c'est l'anémie, s'il y en a trop, c'est la
congestion. Il ne viendrait à l'idée de personne d'emprunter son propre sang.
Alors, il revient à l'État, pour le service du bien commun, d'assurer l'offre à
la demande de monnaie pour qu'enfin l'économie soit au service de l'homme. »
Source : Éric Dillies, dans
une synthèse passionnante intitulée « Monnaie et souveraineté » :
http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html.
(Extrait du Bulletin Science
et Foi n°64 et 65, 2e Trime 2002, CESHE
France - B.P. 1055 - 59011 Lille cedex)
Il faut absolument lire les
parties III à VI de ce document exceptionnel.
Citation n°9, de Jacques Généreux :
« Lacceptation du chômage et le
culte de la désinflation
Le mal politique de
lépoque nest plus le chômage, cest linflation. En effet, en 1979 aux
États-Unis et en Grande-Bretagne, puis au début des années 1980 en Europe
continentale, on fait le deuil de lobjectif du plein emploi qui faisait
lunanimité depuis des années 1940, pour se convertir au culte dune nouvelle
priorité, la désinflation.
Le fondement officiel de cette
conversion est la nécessité dêtre compétitif dans un monde où la concurrence
internationale est de plus en plus vive.
En réalité, si tout le monde réduit son
inflation, personne ne devient plus compétitif. On nest donc
contraint à la désinflation que parce que quelquun a initié le mouvement et
que les autres sont obligés de saligner, non pas pour être plus
compétitifs, mais pour éviter de lêtre moins.
Si les pays navaient aucun intérêt
propre à la désinflation, ils tenteraient probablement de se dissuader les uns
des autres de se lancer dans une guerre des prix, exactement comme ils
sentendent pour éviter des pratiques de concurrence déloyale. Ainsi, quoique
la concurrence internationale ait certainement joué un rôle, la conversion
générale et rapide aux dogmes de la rigueur monétaire et de linflation
minimale na pu se produire que parce quelle présentait un
autre intérêt pour les élites dirigeantes. Mais lequel ? Pourquoi cette
conversion est-elle désirée par les politiques ? Pourquoi est-elle somme
toute acceptée par la société ? Pourquoi à ce moment-là et pas
avant ? Si linflation est le mal absolu que lon dénonce alors, pourquoi
lavoir toléré si longtemps ?
Cest que jusqualors, précisément,
hormis les rentiers, tout le
monde trouvait son compte dans les
politiques dexpansion monétaire modérément inflationnistes.
Dabord, parce que les revenus nominaux
des salariés et des entreprises progressaient plus vite que linflation.
Ensuite et surtout, parce quune
telle politique monétaire se traduisait par des taux dintérêt réels faibles ou
négatifs, ce qui, pour faire simple, signifie que le
crédit est gratuit, voire rapporte de largent à celui qui
sendette !
Cette politique
très favorable à linvestissement et au financement bancaire des entreprises nétait pas moins
avantageuse pour les ménages : ceux-ci pouvaient accéder plus vite aux
biens déquipement et devenir propriétaires de leur logement.
Les seuls vrais perdants de cette
politique monétaire étaient ceux qui tiraient une part essentielle de leurs revenus
de placements financiers : ne pouvant trouver dans les taux dintérêt une
rémunération stimulante, ils investissaient dans les actions des grandes
sociétés cotées en Bourse. Mais, là aussi, leurs exigences en matière de
rendement étaient limitées par celles des managers qui privilégiaient dautres
objectifs (croissance de la firme, prestige, etc.). Les dirigeants disposant dun accès aisé au financement bancaire
étaient relativement indépendants de leurs actionnaires.
Dautant que ces derniers, dans un
espace financier réglementé et cloisonné à peu près partout dans le monde,
navaient pas la liberté ni lopportunité de chercher ailleurs des managers
plus complaisants à leur égard. En un mot, les actionnaires nétaient pas
alors en position de force pour exiger les meilleurs dividendes.
Si les rentiers avaient
donc, à lévidence, intérêt au retournement des politiques monétaires en faveur
de la désinflation et dune meilleure rémunération de lépargne, ils restèrent longtemps
isolés dans une société qui tolérait linflation et jouissait du crédit
gratuit.
Mais au tournant des
années 1970-1980, leurs aspirations sont devenues celles de toute une génération
de cadres économiques et politiques accédant alors au pouvoir.
Ces derniers
appartenaient en effet aux classes aisées et intermédiaires qui, durant les Trente
Glorieuses, avaient pu constituer un patrimoine immobilier et une épargne
financière, grâce à la progression des revenus et à la faiblesse des taux
dintérêt.
Mais une
fois leur patrimoine constitué, les quadragénaires et quinquagénaires des
années 1970-1980 navaient plus besoin du crédit gratuit. Ils espéraient au
contraire des taux dintérêt plus élevés qui rémunéreraient mieux leur épargne. Linflation navait
plus à leurs yeux la moindre vertu, tandis quelle érodait la valeur réelle de
leur patrimoine. Aussi devint-elle un souci majeur dans les années 1970 (
) »
Source : Jacques Généreux,
professeur déconomie à Sciences Po, La Dissociété, Seuil, 2006).
Il faut absolument lire ce livre
formidable : cest un chef-duvre de clarté et de pédagogie.
Chaque paragraphe est important, du début à la fin.
Ainsi, lâge et la fortune des
hommes au pouvoir permet de comprendre enfin pourquoi la misère perdure pour
le plus grand nombre !
Je ne peux mempêcher de penser au tirage au sort
comme une véritable panacée juridique pour nous affranchir des effets pervers
de lélection qui est largement une illusion, celle de dominer nos maîtres en
les désignant
Pure illusion, à lexpérience des faits.
Si vous avez des infos complémentaires sur ce
scandale du hara-kiri monétaire accepté discrètement par les politiciens
de métier, vous êtes bien sûr les bienvenus :o)
Vous pouvez réagir, critiquer ou compléter ces idées sur la partie blog de
ce site :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux
Surtout,
ne ratez pas le très précieux http://www.fauxmonnayeurs.org/
Je viens de lire
le
projet de "traité modificatif" du Conseil européen et jen ai
encore des bosses sur la tête. Tout dabord il faut expliquer quil sagit dune
feuille de route, ce nest pas encore un nouveau Traité. Il faut être prudent
sur la critique car on ne connaît pas encore le contenu du futur
document. Mais en lisant cette simple feuille de route, jai sursauté à tous
les paragraphes. Il est souvent répété dans ce document que les travaux de
la Convention Giscard de 2004 devront être intégrés dans le Traité.
Cela signifie tout simplement que le Traité constitutionnel Européen, celui qui
a été conçu par la Convention Giscard et qui a été expressément refusé par les
Français et les Hollandais, à quelques détails près, va nous être imposé par la
voie parlementaire.
J'analyse cette
démarche autoritaire des exécutifs contre leur propre peuple comme une
reprise du viol politique qui dure depuis cinquante ans et qui n'a été
interrompu que par les cris de la victime le 29 mai 2005, le temps qu'on lui
remette rapidement son bâillon.
Dans le détail
du texte, cest indéniable, il y a un certain nombre de changements. Mais c'est
surtout le fait dévolution de la terminologie pour effacer l'idée qu'il s'agirait d'une
constitution. Ainsi les termes de « loi » et « loi
cadre » sont abandonnés au profit de « règlements » et
« directives » qui névoquent pas ce coté institutionnel, et l'usage
du mot "Constitution" est expressément proscrit. Mais ce sont des
détails, des manoeuvres rhétoriques.
En réalité, ce
texte est un danger pour ce qu'il dit, mais aussi pour ce quil ne dit
pas : il ne permet toujours pas le contrôle des pouvoirs (personne n'est
responsable de ses actes dans les institutions européennes) ; l'exécutif bénéficie toujours de la même confusion
des pouvoirs sur des sujets cachés (sous le nom trompeur d'"actes non
législatifs" et de "procédures législatives spéciales", art.
I-34 et I-35 du TCE) ; il laisse perdurer l'extravagante dépendance des
juges européens envers les exécutifs qui les nomment (art. I-29.2), et n'organise
pas l'indépendance des médias ; la Banque centrale y a toujours une mission
chômagène favorable aux rentiers (I-30.3) ; les citoyens y sont toujours aussi
impuissants contre les abus de pouvoir ; etc.
En fait, le plus
important dans cette affaire est soigneusement éludé dans les débats par les
politiciens de métier, vous le constaterez : les hommes ont inventé le concept
de Constitution non pas pour organiser les pouvoirs (qui sont bien capables de
s'organiser tout seuls) mais pour affaiblir les pouvoirs, pour les diviser,
pour les contrôler. Ceci est essentiel.
Donc,
de la même façon que ce n'est pas l'étiquette "Constitution" qui est
dangereuse pour les citoyens, ce n'est pas l'absence d'étiquette
"Constitution" qui peut nous rassurer : ces institutions, par les pouvoirs qu'elles mettent en place,
SONT une Constitution PAR NATURE et elles sont, par là même, dangereuses pour
tous ceux qui vont obéir à ces pouvoirs ; et nous
sommes bien fous de laisser les exécutifs écrire eux-mêmes les limites et les
contrôles de leurs propres pouvoirs.
En proclamant que
leur texte "n'est plus une constitution", les auteurs sont doublement
en situation d'abus de pouvoir caractérisé : il ne leur appartient pas d'écrire
ce texte la Conférence Inter Gouvernementale (CIG) est profondément
illégitime dans ce rôle et il ne leur appartient pas davantage de le
requalifier. Ce processus malhonnête est un coup
d'État de nos propres exécutifs contre les principes de base de la démocratie.
Vous pouvez réagir là
(sur le site www.marianne2007.info) :
http://www.marianne2007.info/Etienne-Chouard-Avec-le-traite-modificatif,-les-chefs-d-etat-violentent-leurs-peuples-_a1625.html
Chers amis, je résume
ici, sur une page, ma critique de nos soi-disant
« démocraties » :
Cest
aux Citoyens décrire eux-mêmes leur Constitution et ensuite de la protéger.
Pour rester libres, les citoyens doivent toujours rester vigilants à lencontre
des pouvoirs.
Vous pouvez proposer
vos propres questions ici :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/03/09/59-sos-journaliste-en-panne
Le Monde du 6 mars 2007 résume les abus de
pouvoir programmés sans vergogne par les trois soi-disant "grands"
candidats :
« Le traité de Sarkozy face au référendum
de Royal »
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-879503,0.html
« (
) Ce n'est qu'après un accord sur ces
politiques qu'elle [Ségolène Royal] pourrait imaginer, dit-elle, de faire
ratifier, par un nouveau référendum avant ou lors des élections européennes
de juin 2009 un traité reprenant les dispositions institutionnelles de celui
qui a été rejeté par les Français en 2005. "Je suis prête à consulter
de nouveau les Français, mais je demande qu'entre-temps l'Europe fasse ses
preuves sur les politiques communes et sur le social", a-t-elle réaffirmé
dans Le Monde du 6 mars.
Cette position suscite de fortes réserves à Berlin, où le gouvernement d'Angela
Merkel, qui allie la droite chrétienne démocrate aux sociaux -démocrates, tente
de trouver une issue au blocage de l'Union. La crainte est forte outre-Rhin de
voir la candidate socialiste s'enfermer, pour des raisons internes au parti
socialiste, dans une position d'affrontement dont les dirigeants ne voient pas
l'issue. L'obligation qu'elle s'est donnée d'organiser un nouveau référendum
sur tout nouveau traité est ouvertement critiquée par ses propres amis du parti
social-démocrate. "Un second échec serait une catastrophe pour
l'Union", s'évertue à expliquer l'eurodéputé Jo Leinen, président de la
commission institutionnelle du Parlement européen, rallié à l'idée d'un
processus par étapes après s'être battu pour garder le traité au plus prêt du
projet initial de Constitution.
François Bayrou s'étant lui-même prononcé pour un référendum sur un
nouveau texte qu'il veut ambitieux, sans vraiment en préciser les contours,
les discussions se sont du coup nouées autour de la proposition de "mini-traité"
institutionnel lancée en septembre dernier, à Bruxelles, par Nicolas
Sarkozy.
Cette proposition, qui a déclenché dans un premier temps une levée de boucliers
dans les pays qui ont déjà ratifié le traité actuel, a fait son chemin. Elle a
le mérite, pour ces derniers, de prévoir une ratification par le seul
parlement et de pouvoir aller vite sur la réforme des institutions avant de relancer une
nouvelle grande négociation sur le contenu politique de l'Europe. (
) »
Mon commentaire :
On nimpose
pas une Constitution par Traité, et encore moins sans consulter directement le
peuple.
Un "traité constitutionnel" est un abus de
pouvoir, une
profonde atteinte à la démocratie.
Les locataires de la souveraineté en disposent comme s'ils en étaient
propriétaires.
Ce nest évidemment pas aux hommes au pouvoir décrire les limites de leur
propre pouvoir.
Si
on élit ces gens-là, on sait où on va, et on aura ensuite ce quon mérite.
Si on est assez bête pour désigner ceux qui nous annoncent quils vont nous
violer, tant pis pour nous.
Mais
les autres candidats sans parti, de gauche ou de droite, ne valent
guère mieux (José Bové, Nicolas Dupont-Aignan, etc.) sils nous imposent
une Assemblée Constituante élue, car ses membres proviendront alors
fatalement des partis et ces hommes-là, comme ils l'ont toujours fait,
parce que cest dans leur intérêt personnel, programmeront fatalement notre
impuissance.
...
Hum
Et si on élisait des NON CANDIDATS ?
Pourquoi
nous laissons-nous imposer les candidats des partis ?
Pourquoi ne pouvons-nous pas désigner librement le
ou les citoyens que nous jugeons valeureux ?
Puis, parmi ces milliers délus non candidats,
on choisirait par plusieurs tours successifs (5 ou 6 ?)
ou bien on tirerait au sort parmi ceux qui ont été les plus
appelés (et qui ont accepté).
Dans les deux cas, on aurait alors à la fois l'élection et l'émancipation
des partis
On
aurait enfin un vrai filtre honnête de compétence fabriqué directement
et exclusivement par nous tous et non pas réduit malhonnêtement par ce
deuxième filtre qu'est l'autoproclamation de compétence de la part de tous les
candidats des partis qui, pour l'instant, s'imposent à notre choix.
Pourquoi
est-ce que ce sont les élus qui nous imposent le mode délection et de
sélection des candidats ?
Qui
est légitime pour
faire cet immense choix de société ?
Les
élus eux-mêmes ou les citoyens ?
Nous
devrions reprendre l'initiative du choix des candidats, comme l'initiative
du choix des questions importantes auxquelles nous souhaitons répondre.
Établissons
une véritable initiative populaire, libérée des idéologies partisanes.
Tout
ça passe par les institutions.
Le
seul moyen de nous émanciper vraiment est d'écrire nous-mêmes notre
Constitution.
On
n'en sortira pas sans une Constitution d'origine Citoyenne.
Si vous
connaissez des pays ou des époques où les hommes ont institué de telles
élections sans candidats, faites-nous passer l'information : avantages,
inconvénients, modalités, pièges à éviter, etc. Merci :o)
Amicalement.
Étienne.
Vos
réactions :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/03/08/58-nous-devrions-elire-des-non-candidats
Voici ce que j'avais prévu de dire
mercredi soir, 7 février, à Aubagne, au cours du premier meeting de José Bové
(je n'ai pas tout dit : 3 minutes max, c'est une terrible tenaille).
Souvenez-vous : pour des
dizaines de milliers de citoyens, la campagne référendaire de 2005 fut un
révélateur de notre impuissance politique, en Europe comme en France :
· ni contrôle de nos élus, qui substituent sans frein leur
volonté propre à la volonté générale,
· ni pouvoir dinitiative, pour nous autres citoyens, même
sur les sujets que nous considérons massivement comme importants.
Pourtant,
nous pourrions gagner la plupart de nos luttes sociales avec le référendum dinitiative
citoyenne (ou populaire), RIC ou RIP, version moderne, pour une population devenue
nombreuse, de lisègoria, droit antique essentiel, droit
pour tous les citoyens de prendre la parole à lassemblée, à tout moment
et à tout propos : 1 % posent les questions qui leur semblent
importantes et 50 % (ou plus) décident éventuellement que la question est
effectivement importante et imposent la volonté populaire avec une légitimité
incontestable (directe). Ce droit existe en Suisse, entre autres, et les Suisses
sen félicitent.
Avec le RIC, donc, nous pourrions
nous opposer efficacement et définitivement aux privatisations, au CNE, aux OGM
en plein champ, à notre intoxication par les fabricants de produits chimiques,
aux transferts de souveraineté sans contrôle populaire vers lUnion européenne,
nous pourrions imposer les scrutins proportionnel et préférentiel, le respect
du vote blanc, nous pourrions imposer que la création monétaire soit retirée
aux banques privées pour être rendue à lÉtat, décider dun revenu maximum,
etc.
POURQUOI cette impuissance ? Parce quelle
est programmée quelque part. Où ça ?
Dans la Constitution. Et qui écrit la Constitution (jusquà présent) ? Les
élus, les ministres, les juges, les hommes de partis... Or, tous ces gens ont un
intérêt personnel à ce que nous soyons impuissants politiquement : il ne
faut donc pas sétonner que nous nayons aucun moyen de résister aux abus de
pouvoirs ; ce qui compte, ce nest pas qui vote
la Constitution, ce qui est essentiel, cest qui écrit la Constitution.
Et ma thèse est celle-ci : ce
nest pas aux hommes au pouvoir décrire les règles de leur propre pouvoir. Ce nest pas aux parlementaires
ni aux ministres décrire ou modifier la Constitution car ils sont juges et parties et
que leur intérêt personnel est contraire à lintérêt général.
Et il ne sert à rien dincriminer
les élus, il faut nous en prendre à nous-mêmes car cest bien nous qui sommes négligents
et qui les laissons faire, en nous désintéressant de cet outil essentiel :
cest parce quon leur abandonne lécriture de la Constitution que lon est
privé du droit des peuples à disposer deux-mêmes au profit dun
incroyable droit des élus à disposer des peuples.
Cest à nous dexiger que soient
rigoureusement séparés le pouvoir constituant des pouvoirs constitués (séparation
des pouvoirs plus importante, finalement, que lautre séparation des
pouvoirs quon doit aussi respecter ensuite, entre les pouvoirs législatif,
exécutif, judiciaire et (bientôt) les médias).
Alors COMMENT séparer ces
pouvoirs ? Avec une Assemblée Constituante, mais attention pas une Assemblée
Constituante élue, sinon les partis vont nous imposer leurs candidats
via les commissions dinvestiture et ce sont de nouveau des hommes de parti,
des hommes de pouvoir, qui vont écrire les règles du pouvoir et des contrôles
factices. Non, la seule Assemblée Constituante qui vaille doit
être tirée au sort, parmi les citoyens volontaires : tout vaut mieux, pour nous tous,
que des auteurs qui écrivent des règles pour eux-mêmes.
Et QUI donc va déclencher ce
processus constituant honnête, avec une assemblée constituante tirée au
sort ? Un candidat de parti, un homme de parti ? Jamais de la
vie : si on attend ça on va attendre longtemps. Seul
un candidat hors parti peut nous offrir cette libération.
Et cest là que la candidature de
José est historique, très originale, incroyablement porteuse despoir :
José est un homme libre, il na de comptes à rendre à personne et sil a
compris limportance de cet enjeu, son rôle historique, et sil est honnête et
courageux, ce que je crois, il est le seul crédible aujourdhui et il
peut convaincre des millions de personnes, bien au-delà des seuls militants.
Pensez à ces 70 % de citoyens
qui ne font plus confiance à aucun parti, ni de gauche ni de droite : cest un homme sans parti quil
leur faut, un homme qui leur dise : « je ne veux pas être votre
chef, je veux être votre porte-parole, je veux vous rendre la parole et vous
laisser décider vous-même de ce que vous considérez comme important. Ne me
demandez pas quel est mon programme, habitués que vous êtes à ce que des élus
décident à votre place ; je vous propose une évolution démocratique :
mon programme est de vous laisser écrire le programme, librement,
intelligemment, au fur et à mesure, projet par projet, sans nous figer dans une
ligne de parti, sans nous emprisonner dans le carcan dune discipline de parti,
sans nous enfermer dans des clans hostiles par principe. Je protègerai des
valeurs, mais vous déciderez vous-même de votre sort, au fur et à mesure. Je
vous rendrai le contrôle réel de vos médias, de votre monnaie, de vos
représentants, de vos institutions, de votre politique. »
Aujourdhui, sil arrive à déjouer les manipulations des
partisans, fussent-ils "dissidents", qui ne manqueront pas de
s'approcher de lui, et sil reste bien à lécoute des sans partis, José
Bové semble bien capable de nous sortir de ce que jappelle la préhistoire
de la démocratie.
PS : je trouve
très troublante l'observation qu'aucun syndicat ne réclame le RIC, alors qu'ils
devraient évidemment tous marteler cette revendication décisive tous les
jours ! C'est consternant, je ne comprends pas : ces gens qui prétendent
faire le métier de nous défendre ne réclament pas fortement l'arme suprême,
larme absolue, le RIC, qui nous permettrait de vaincre à tout propos.
De la part des
partis de droite, je le comprends, c'est cohérent : les riches dominent les
pauvres et les institutions sont un verrou parfait, OK.
Mais de la part
des partis de gauche (y compris les partis d'extrême gauche !) et même des
syndicats, je trouve cette impasse consternante. Si vous avez une explication,
ce serait intéressant de nous la faire connaître.
Vos réactions : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/02/08/56-jose-bove-homme-libre-sans-parti-peut-nous-aider-a-sortir-de-la-prehistoire-de-la-democratie
Quand j'entends Nicolas Sarkozy, ce soi-disant "représentant"
des Français, en plus de détruire le droit du travail (avec un CNE qui
deviendrait la règle générale, à vie), promettre de nous imposer la partie 1 du TCE par voie parlementaire sans
référendum ! sil est élu Président, au motif que ce serait une
partie faisant consensus, je fais des bonds au plafond :
La partie 1 du TCE est la plus dangereuse de
toutes
: cest la partie 1 qui programme lirresponsabilité de tous les acteurs
politiques (aucun mécanisme de destitution du Parlement, du Conseil des
Ministres, du Conseil européen, de la Banque centrale, etc.), cest la partie 1
qui scelle limpuissance des citoyens pour décider de leur sort ou
contrôler leurs élus, cest la partie 1 qui nous fait prendre des vessies pour
des lanternes avec son misérable droit de pétition (1-47-4), cest la partie 1
qui prévoit la dépendance des juges européens (hyper puissants) envers les
exécutifs qui les nomment et quils auront pourtant à juger (1-29-2), cest
la partie 1 qui fait de notre Parlement national un assemblée sans pouvoirs
(1-33), cest la partie 1 qui nous impose lindépendance de la Banque
centrale et nous prive du droit de battre monnaie au profit des voleurs,
des faux monnayeurs que sont les banquiers privés (1-30-3), etc. etc. etc. Je
métrangle de tant de félonie impunie.
Cest la partie 1 du
TCE qui scelle lassassinat de la démocratie au profit des banquiers.
Consensus ? Tu
parles
Menteur !
Vos réactions : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/01/26/52-c-est-la-partie-1-du-tce-qui-est-la-plus-dangereuse-c-est-elle-qui-scelle-la-mort-de-la-democratie
Je viens de recevoir copie dun message bouleversant.
Je le reproduis ici pour quon en parle ensemble, que vous me
disiez ce que ça vous inspire.
|
Mais quattend ATTAC
France ?
par Alain Vidal
Même Benjamin Franklin,
même Abraham Lincoln, même Sir Josiah Stamp, gouverneur de la Banque
d'Angleterre
Mêmes eux lont dit. Mêmes eux
Tous ont dénoncé
limposture des intérêts, le vol des richesses commis par les banques
privées.
ATTAC France qui
prétend sattaquer à la finance internationale, ne dit toujours rien
publiquement
ne lance toujours pas de campagne nationale sur la monnaie,
nincite pas, nationalement, à un travail
déducation populaire qui expliquerait simplement, comme beaucoup le
font depuis 250 ans que :
les intérêts bancaires sont la première cause dexclusion, de
chômage, de misère, de malnutrition, de maladies, de famine... et de
guerre dans le monde.
Documentation extraite de « Vers
Demain » (http://www.michaeljournal.org/accueil.htm)
« Dans les colonies, nous émettons notre propre
papier-monnaie, nous lappelons Colo Script, et nous en émettons assez
pour faire passer facilement tous les produits des producteurs aux consommateurs.
Créant ainsi notre propre papier-monnaie, nous contrôlons notre pouvoir
dachat et nous navons aucun intérêt à payer à personne. » (Benjamin
Franklin 1750).
Les banquiers anglais, mis au courant, firent adopter par le
Parlement anglais une loi défendant aux colonies de se servir de leur monnaie
script et leur ordonnant de se servir uniquement de la monnaie-dette dor et
dargent des banquiers qui était fournie en quantité insuffisante. La
circulation monétaire dans les colonies se trouva ainsi diminuée de moitié.
« En un an, dit Franklin, les conditions changèrent
tellement que lère de prospérité se termina, et une dépression sinstalla, à
tel point que les rues des colonies étaient remplies de chômeurs. »
Alors advint la guerre contre lAngleterre et la déclaration
dindépendance des États-Unis, en 1776.
Les manuels dhistoire enseignent faussement que la Révolution
Américaine était due à la taxe sur le thé. Franklin déclara: « Les colonies auraient volontiers supporté
linsignifiante taxe sur le thé et autres articles, sans la pauvreté causée
par la mauvaise influence des banquiers anglais sur le Parlement: ce qui a
créé dans les colonies la haine de lAngleterre et causé la guerre de la
Révolution. »
Les Pères Fondateurs des États-Unis, ayant tous ces faits en
mémoire, et pour se protéger de lexploitation des banquiers internationaux,
prirent bien soin de stipuler clairement dans la Constitution américaine, signée à Philadelphie en 1787, dans larticle 1, section 8,
paragraphe 5 : « Cest au Congrès
quappartiendra le droit de frapper largent et den régler la valeur. »
Abraham
Lincoln , Président des États-Unis étant à court dargent pour financer
les armées du Nord, partit voir les banquiers de New-York, qui lui offrirent
de largent à des taux allant de 24 à 36 %. Lincoln refusa, sachant
parfaitement que cétait de lusure et que cela mènerait les États-Unis à la
ruine. Son ami de Chicago, le Colonel Dick Taylor, vint à la rescousse et lui
suggéra la solution: « Que le Congrès passe une loi
autorisant lémission de billets du Trésor ayant plein cours légal, payez vos
soldats avec ces billets, allez de lavant et gagnez votre guerre. »
Cest ce que Lincoln
fit, et il gagna la guerre: de 1862 à 1863, Lincoln fit émettre 450 millions
$ de « greenbacks ».
Lincoln appela ces greenbacks « la
plus grande bénédiction que le peuple américain ait jamais eue. » Bénédiction
pour tous, sauf pour les banquiers, puisque cela mettait fin à leur
« racket » du vol du crédit de la nation et de création dargent
avec intérêt. Ils mirent donc tout en oeuvre pour saboter loeuvre de
Lincoln. Lord Goschen, porte-parole des Financiers, écrivit dans le London
Times :
«Si cette malveillante politique financière provenant de la
République nord-américaine devait sinstaller pour de bon, alors, ce
gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. Il sacquittera de ses
dettes et sera sans aucune dette. Il aura tout largent nécessaire pour mener
son commerce. Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute
lhistoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit, ou il
détruira toute monarchie sur ce globe.» (La monarchie des contrôleurs du
crédit.)
Lincoln déclara tout
de même:
«Jai deux grands
ennemis: larmée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce
sont les banquiers qui sont mes pires ennemis.»
Lincoln fut réélu Président en 1864 et fit clairement savoir
quil sattaquerait au pouvoir des banquiers une fois la guerre terminée. La
guerre se termina le 9 avril 1865, mais Lincoln fut assassiné cinq jours plus
tard, le 14 avril.
Une formidable restriction du crédit sensuivit, organisée par
les banques. Largent en circulation dans le pays, qui était de 1907 millions
de $ en 1866, soit 50,46 $ pour chaque Américain, tomba à 605 millions de $
en 1876, soit 14,60 $ par Américain. Résultat: en dix ans, 54 446 faillites,
pertes de 2 milliards de $. Cela ne suffisant pas, on alla jusquà réduire la
circulation dargent à 6,67 $ par tête en 1867 !
En 1896, le candidat
démocrate à la présidence était William Jennings Bryan déclare, (et encore
une fois, les livres dhistoire nous disent que ce fut une bonne chose quil
ne fut pas élu président, car il était contre la monnaie « saine »
des banquiers, largent créé sous forme de dette, et contre
létalon-or) :
« Nous disons
dans notre programme que nous croyons que le droit de frapper et démettre la
monnaie est une fonction du gouvernement. Nous le croyons. Et ceux qui y sont
opposés nous disent que lémission de papier-monnaie est une fonction de la
banque, et que le gouvernement doit se retirer des affaires de la banque. Eh
bien ! moi je leur dis que lémission de largent est une fonction du
gouvernement, et que les banques doivent se retirer des affaires du
gouvernement... Lorsque nous aurons rétabli la monnaie de la
Constitution, toutes les autres réformes nécessaires seront possibles, mais
avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne peut être
accomplie. »
Et finalement, le 23
décembre 1913, le Congrès américain votait la loi de la Réserve Fédérale ,
qui enlevait au Congrès lui-même le pouvoir de créer largent, et remettait
ce pouvoir à la «Federal Reserve Corporation». Un des rares membres du
Congrès qui avait compris tout lenjeu de cette loi, Charles A. Lindbergh (le
père du célèbre aviateur), déclara:
« Cette loi
établit le plus gigantesque trust sur terre. Lorsque le Président (Wilson)
signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du Pouvoir Monétaire sera
légalisé... le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette
loi sur la banque et le numéraire. »
Quest-ce qui a permis aux banquiers dobtenir finalement le
monopole complet du contrôle du crédit aux États-Unis ? Lignorance
de la population sur la question monétaire. John Adams écrivait à
Thomas Jefferson, en 1787 :
« Toutes les perplexités, désordres et misères ne
proviennent pas tant de défauts de la Constitution, du manque dhonneur ou de
vertu, que dune ignorance complète de la nature de la monnaie, du crédit et
de la circulation. »
Salmon P. Chase,
Secrétaire du Trésor sous Lincoln, déclara publiquement, peu après le passage
de la loi des Banques Nationales:
« Ma contribution au passage de la loi des Banques
Nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi
un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. Cette loi doit être révoquée, mais avant que
cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger dun côté, et les banques
de lautre, dans une lutte telle que nous navons jamais vue dans ce pays. »
Et lindustriel Henry Ford: «Si la
population comprenait le système bancaire, je crois quil y aurait une révolution
avant demain matin.»
(Fin dextraits)
« Fondée en
1998, Attac (Association pour la Taxation des Transactions pour lAide aux
Citoyens) promeut et mène des actions de tous ordres en vue de la reconquête,
par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les
aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle dans
lensemble du monde. Mouvement déducation populaire, lassociation
produit analyses et expertises, organise des conférences, des réunions
publiques, participe à des manifestations
»
Alors quil
ny a pas de travail déducation populaire permanent sur cette arme
de domination massive que sont les intérêts de la monnaie marchandise,
ATTAC France affirme participer à
« la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière
exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et
culturelle dans lensemble du monde. »
Mais quattend ATTAC
France ??????????????
Alain Vidal, groupe monnaie, ATTAC 44 (17 janvier 2007).
|
Alain
Vidal, instituteur
de son état, semble bien être un grand homme. Lisez aussi cette histoire :
« Pour un colloque sur l'enseignement de
l'Histoire » :
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2002-10-06%2021:12:01&log=lautrehistoire
Superbe
lettre, vraiment !
On peut débattre de tout ça là : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2344#p2344
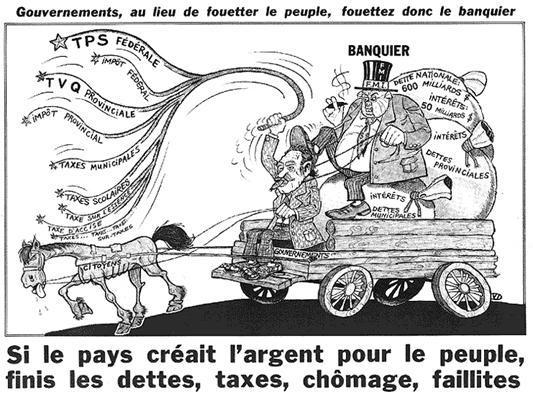
Source : http://www.michaeljournal.org/galerie.htm
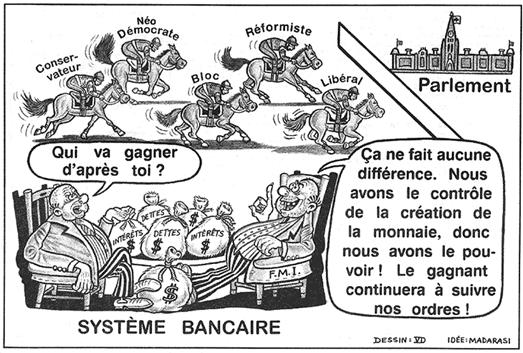
Source : http://www.michaeljournal.org/galerie.htm
Mes
amis, je lis des livres enthousiasmants et je manque de temps pour vous en
parler. Parmi ceux-ci, vient de paraître un éloge vibrant, excitant,
passionnant, de la clérocratie :
« Pour en finir
avec la démocratie », par François Amanrich (éd. Papyrus),
candidat à la présidentielle 2007 et animateur du site www.clerocratie.com.
Je reproduis
ici le sommaire, très détaillé, qui montre la richesse, linventivité, la
pertinence et la rigueur de ce citoyen pétillant. Je vous recommande
chaleureusement ce livre, il est ex-ce-llent.
Chaque chapitre se termine avec un exemplaire choisi de La
lettre clérocratique, à laquelle je vous recommande de vous abonner (http://www.clerocratie.com/index.php?page=29&lg=1),
cest savoureux :o)
|
« Pour en finir avec
la démocratie », un livre de François Amanrich
Sommaire :
Chapitre 1 : En finir avec la démocratie ?
Peut-on remplacer la
démocratie par un autre système politique ?
Est-ce vraiment réaliste
?
Pourquoi les intellectuels,
les politiques, répètent quil ny a rien de mieux que la démocratie, et
quhors delle il nexiste que le chaos et la dictature ?
La démocratie actuelle
est-elle bien consciente des difficultés qui la mine et les politiques se
rendent-ils bien compte du mécontentement populaire ?
Quelle a été la
principale erreur de la démocratie ?
Que proposer à sa place ?
Le conte de la
marionnette (La « Lettre clérocratique » de juin 2006)
Chapitre 2 : Allons voir chez les Grecs !
Définition globale du
système clérocratique
Que signifie le mot
"clérocratie" ?
Dans la démocratie
athénienne, le hasard servait à désigner les élus
Pourquoi ont-ils
choisi le hasard ?
Un boulanger pouvait-il
représenter les architectes ?
Qui pouvait accéder à un
poste de responsabilité ?
À part Athènes, y a t-il
eu dautres pays qui adoptèrent le tirage au sort pour désigner leurs représentants
?
Quest-ce que la
clérocratie veut prendre des expériences du passé ?
Y a-t-il, aujourdhui en
France, des exemples où des organismes se servent du hasard dans leur fonctionnement
?
Le CSFM, un des plus
importants syndicats de France, désigne ses représentants par tirage au sort
!
S'il vous plaît
dessine-moi une démocratie ! (La « Lettre clérocratique » de mai 2006)
Chapitre 3 : La clérocratie, comment ça marche ?
En quoi le système
clérocratique peut être une alternative crédible à un système démocratique
actuel
Le parcours d'une personne
désirant participer à la vie politique dans un tel système
En clérocratie
cest la "base" qui choisit ses élus
Comment se faire élire ?
De lintérêt dune
présentation individuelle
Des
"filtres" pour sélectionner les candidats.
Quel est lintérêt de
limiter les mandats locaux ?
Quadviendra-t-il des
" désignés "qui ne seront pas élus par le sort ?
En quoi le mode de
désignation clérocratique est un mieux par rapport au système démocratique
actuel ?
En quoi le
citoyen pourra t-il avoir plus confiance dans le "désigné"
clérocrate que dans lélu démocrate ?
Combien dannées faudra
t-il pour quun ou une "désigné" clérocrate devienne président de
la république ?
Si la démocratie était
une entreprise (La « Lettre clérocratique » de septembre 2005)
Chapitre 4 : L'impossible choix.
Le vote populaire na été
quun prétexte pour permettre à la classe dirigeante de prendre le pouvoir.
Toutes les personnes
composant une démocratie sont-elles capables de voter ?
Pourquoi la classe dirigeante
finit-elle par donner le droit de vote à tous les citoyens ?
Le droit de vote implique
aussi des devoirs. Comme de voter, par exemple.
Il est indispensable de
savoir exactement pour quoi ou pour qui lon vote avant de se prononcer
Le résultat des élections
est surtout fonction des personnes qui ne connaissent pas ou peu la
politique.
Les programmes politiques
sont de vrais fourre-tout ayant pour but de ratisser le plus large possible.
Les référendums sont trop souvent incompréhensibles.
Un vote n'a aucun
sens, aucune valeur, lorsquil repose sur un choix fait en non connaissance
de cause
Les consultations
électorales où une décision est prise par une toute petite minorité de
votants.
Dans le système
clérocratique les électeurs se prononcent par référendum.
Alors, à quelles
occasions les citoyens clérocrates votent-ils ?
Si lélecteur ne peut pas
réellement choisir, que lui reste-t-il ?
Voter à coté de ses
urnes (La « Lettre clérocratique » de janvier 2005)
Chapitre 5 : Un coup de pied dans les urnes
Le désintérêt de la
"chose" politique atteint à la crédibilité même de la démocratie.
Quand, dans un système
participatif comme la démocratie, ceux qui le constituent refusent de jouer
le jeu, il est urgent de se poser la question de savoir qui des joueurs ou du
jeu n'est plus adapté à l'autre ?
Que se passera-t-il en
démocratie le jour où les non-joueurs dépasseront le nombre des joueurs ?
Lors des résultats dune
élection ou dun référendum les chiffres sont biaisés.
Le manque dintérêt pour
lélection explique le taux élevé dabstention.
Les citoyens sont les
spectateurs dune comédie qui les dépasse.
Labstention est la
conséquence directe du système actuel.
Ne pas changer un système
qui génère plus dabstention que de participation est très risqué.
Une démocratie peut se
transformer en dictature.
Il faut revoir toute la
notion du droit de vote.
La clérocratie fait donc
appel à la responsabilité populaire basée sur la connaissance, et non sur le
credo démocratique qui veut que tout citoyen, par le seul fait de sa
citoyenneté, est capable du bon choix.
La clérocratie ne
supprime pas le suffrage universel.
Supprimer ces élections
où lon doit choisir un homme ou un parti, ce qui revient à élire un maître
ou un groupe de maîtres qui vont décider ce qui est bon ou mauvais pour la
nation.
Un coup de pied dans
les urnes (La « Lettre clérocratique » de juillet 2006)
Chapitre 6 : La démocratie impopulaire
Outre les dangers liés à labstention
le désintérêt des citoyens mène à une perte de confiance envers les élus.
Les pouvoirs de gestion
sont confiés aux élus par un faible pourcentage d'électeurs. Que représentent
véritablement aujourd'hui ces élus ?
Il arrivera un moment où
les élus de la nation ne devront leur poste qu'à une poignée d'électeurs. Faudra-t-il
attendre ce jour pour se poser des questions sur la pérennité de ce système ?
En démocratie, le dogme
donne la primauté du légal sur le légitime, même si cela va à contresens de
la raison.
À quelques voix près, il
y aura deux vainqueurs.
Le peuple na pas de
mémoire et oublie très vite ?
Ce que propose la
clérocratie pour faire face à ces difficultés.
Le peuple
souverain, le gouvernement du peuple par le peuple, toutes ces grandes
phrases, ne sont que des mots creux.
Dans le système
clérocratique, les "désignés" sont légitimes.
Contrairement aux
politiciens démocrates, les "désignés" nexercent pas de mandat
politique. Ils remplissent une mission. Quelle est la différence ?
En démocratie le mieux du
mandataire se confond avec le mieux de ses propres intérêts.
La clérocratie
est une garantie contre la corruption de la classe politique.
Le système clérocratique
instaure une véritable répartition des postes, en fonction de la
représentativité réelle de toutes les composantes de la nation.
Tout est fait aujourd'hui
pour que les femmes qui désirent s'investir dans la vie politique aient
toutes les chances de perdre.
Voici venu le temps
des politocrates (La « Lettre clérocratique » davril 2005)
Chapitre 7 : Professionnels de la politique
Les politiques
doivent-ils être de véritables professionnels ?
Le système démocratique
n'échappe pas à la professionnalisation.
Dans le système clérocratique,
les désignés seront des professionnels
Comment seront-ils formés
?
Dans le système
démocratique, les hommes politiques ont tendance à aller du haut vers le très
haut en faisant abstraction du bas.
En démocratie, les
politiques sont plus animés par la recherche du pouvoir que par un véritable
travail de professionnels dont le but devrait être daccomplir pleinement
leur métier
Dans le système
démocratique actuel, la professionnalisation présente de tels handicaps
qu'elle va à l'encontre de l'idée même de la démocratie.
Le fameux recyclage des
politiques battus lors délections
En démocratie, l'électeur
est impuissant, et pire, conscient de son impuissance.
Dans le système politique
actuel, le peuple est gouverné par une "élitocratie", forme moderne
de "l'aristocratie.
Comment concilier la
nécessité d'une professionnalisation du personnel politique tout en
l'empêchant de se regrouper en caste ?
Aujourdhui le
recrutement des politiques est basé sur lappartenance à un même milieu
socioéconomique.
Plus de 60 % des députés
sont des fonctionnaires
Le déséquilibre de la
représentation de la société.
Lémergence de
fonctionnaires politiques est un avatar de la professionnalisation du monde
politique dans le système démocratique.
Actuellement, pour se
lancer dans la carrière politique, il faut être fonctionnaire d'état.
La mainmise sur la
politique par les fonctionnaires. En clérocratie, l'ensemble des
"désignés" répond aux critères indispensables à une véritable
représentation populaire.
Le système clérocratique
rend donc possible une professionnalisation de la fonction politique, tout en
sauvegardant les intérêts de l'ensemble de la population et non ceux d'une
caste minoritaire comme actuellement.
La première étude sur la
démographie démocratique (La « Lettre clérocratique » davril 2004)
Chapitre 8 : Menteur professionnel ?
Comment concilier le
professionnalisme qui oblige à des anticipations qui vont à l'encontre des
souhaits populaires, et l'obligation de recueillir un maximum de suffrages
pour être élu ?
Comment agir
lorsque la déraison majoritaire l'emporte sur la raison minoritaire.
Les décisions prises
qu'en temps "opportuniste"
pour le politique.
Dans le système démocratique,
l'homme politique ne peut pas agir autrement.
Les
"acrobaties" démocratiques, indispensables et nécessaires, ne
peuvent que ternir la classe politique et le régime qu'elle représente.
En démocratie, le
politique ne peut que favoriser le superficiel.
Le système démocratique
oblige ses dirigeants à avoir une vision à court terme.
En clérocratie, il n'y a
pas d'hommes politiques comme en démocratie, il n'y a que des hommes d'état.
En clérocratie, le
"désigné" a les mains libres.
Du rififi chez les
Pères Noël (La « Lettre clérocratique » de décembre 2005)
Chapitre 9 : La démocratie des petits copains
Le suffrage universel
suppose que la masse des citoyens aura la volonté du bien général, plutôt que
de ses intérêts particuliers.
L'intérêt personnel
lemporte toujours sur l'intérêt du plus grand nombre.
Le bien général cède la
pas au bien particulier, comme légalité au privilège.
Que reste-t-il de
l'électeur éclairé qui vote dans l'intérêt du plus grand nombre ?
En démocratie, une
tirelire bien garnie vaut mieux qu'une urne bien pleine.
Tous les Français ont-ils
vraiment le droit de grève ?
Actuellement, seuls les
employés du secteur public ou parapublic peuvent se permettre ce luxe, inaccessible
à la majorité des Français.
Quand tout le monde a les
mêmes droits, mais que certains peuvent sen servir et dautres non, où est
le droit ?
Lorsqu'un droit n'est
réservé qu'à certaines catégories sociales, il se transforme en un privilège
!
Le triptyque
révolutionnaire "Liberté, Égalité, Fraternité" a du plomb dans
laile !
Dans le système
démocratique, le peuple est donc devenu un moyen alors qu'il devrait être un
but ?
Peut-on légitiment
considérer quactuellement certains électeurs possèdent plusieurs bulletins de
vote ?
Soyons sacrilège
(La « Lettre clérocratique » de mars 2004)
Chapitre 10 : 1789, cest pour quand !
Les classes sociales ont
elles été supprimées ?
Avant, le pouvoir
monarchique était absolu. Aujourd'hui il y a un labsolutisme présidentiel.
Avant, il y avait la noblesse, aujourd'hui il y a les politiques.
Avant, il y avait le
clergé, aujourd'hui, il y a la fonction publique. Avant il y avait le Tiers
état, aujourd'hui aussi.
Le système
démocratique a laissé se recréer les trois ordres monarchiques.
Les leçons de lHistoire
ne servent à rien !
L'Ancien régime sest
appuyé sur le clergé, comme la démocratie daujourdhui sur la fonction
publique ?
Les fonctionnaires,
champions du civisme.
La classe politique, na
plus l'indépendance nécessaire à l'exercice du pouvoir.
Quelle solution permet de
sortir de cette ornière ?
Seul un système comme la
clérocratie peut y réussir.
Ce que la noblesse de
l'ancien régime parvint à réaliser, c'est-à-dire à garder entre ses mains les
rênes du pouvoir, les hommes politiques modernes ont fait pareil.
La manière dont sont
"choisis" les élus dans notre système actuel.
Le "droit du
sang" de l'Ancien régime s'est transformé en "droit de
l'école".
La place et le rôle de la
fonction publique en clérocratie ?
Le mode de fonctionnement
du système clérocratique empêche la prise du pouvoir et sa confiscation par
une minorité au détriment de la majorité.
Cest pour quand 1789
? (La « Lettre clérocratique » de janvier 2005)
Chapitre 11 : Démocratie : attention danger !
Les dangers que le
système démocratique actuel présente pour lensemble de notre pays.
Il faut mettre en place
une nouvelle approche politique.
Le pouvoir doit être
fort, car un contrepoids doit avoir la même importance que ce à quoi il
s'oppose s'il veut servir d'équilibre.
Les groupes les mieux
organisés accentuent leurs privilèges.
Le pouvoir politique doit
imposer le respect des règles et des lois.
La force, indispensable
au pouvoir politique pour gouverner, n'est acceptable que lorsqu'elle est
légitime.
Ce pouvoir, la démocratie
ne l'a plus.
Dans le système
clérocratique, ces écueils sur lesquels sabîme la démocratie n'existent pas.
Le contrôle de
l'exécution des missions confiées aux "désignés" renforce leur
légitimité.
Par son mode de
sélection, la clérocratie offre aux "désignés" une indépendance
indispensable à la bonne gestion d'un pays.
Larbitrage sous
influence qu'impose le système démocratique aux élus actuellement n'est plus
supportable.
Le saumon démocratique
(La « Lettre clérocratique » daoût 2004)
|
Ce livre est littéralement passionnant !
On peut en parler sur le forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2341#p2341

Klérotérion, machine à tirer au sort les jurys
(source : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_ath%C3%A9nienne
(Résumé)
Dans un contexte de méfiance
générale à lencontre des responsables politiques, qui semblent défendre de
plus en plus les personnes "morales", les géants économiques, contre
les personnes "physiques", Ségolène Royal a eu le courage de
proposer que laction des élus soit évaluée par des jurys citoyens tirés au
sort. Cette idée doublement formidable met en cause à la fois lélection et
lirresponsabilité politique entre deux élections ; elle a évidemment
déclenché une bronca chez les élus et leurs sponsors.
Cest
une occasion pour nous tous de débattre publiquement (enfin !) du mode de
désignation de nos représentants : élection ou tirage au sort ? Et
pour quel mandat ? Quand on étudie la question, on saperçoit avec surprise
que lélection nest pas licône idéale quon nous présente tous les jours de
façon un peu mystique et quelle est même, peut-être, un outil parfait pour
nous manipuler, via nos représentants rendus vulnérables par le coût de leur
campagne électorale. On saperçoit aussi que le tirage au sort a été trop vite
jeté aux orties alors quil présente des qualités inestimables pour le plus
grand nombre. On saperçoit enfin que le choix de lélection, il y a deux cents
ans, a été imposé
par des élus
et na plus jamais été débattu depuis.
On
présente souvent le "gouvernement représentatif" comme "le
moins mauvais système". Résignation trop rapide ; on pourrait
concevoir de bien meilleurs systèmes, qui associeraient élection et tirage au
sort, par exemple, à condition toutefois de faire attention à ceux qui les
écrivent : le plus important nest pas qui vote la constitution,
mais qui la propose ; selon le choix des auteurs des
institutions, on peut bloquer lévolution démocratique.
Et si on
osait sapproprier les choix confisqués par des experts et faire nous-mêmes le
point ?
1. Dun côté, chacun
constate que le suffrage universel ne tient pas ses promesses
démancipation : lélection induit mécaniquement une aristocratie
élective, avec son cortège de malhonnêtetés et dabus de pouvoir.
Vers le
XVIIIe siècle, une grande idée est venue soutenir lélection : toute
autorité nest légitime que par le consentement de ceux sur qui elle sexerce (consentement
que ne permet pas le tirage au sort, ce qui explique sa mise à lécart).
Mais
après deux siècles de pratique, on constate que lélection :
·
pousse au mensonge, avant lélection et
avant la réélection,
·
impose la corruption : campagnes
électorales ruineuses ; "ascenseurs à renvoyer",
·
étouffe les résistances contre les abus de pouvoir :
droit de parole réduit à un vote épisodique, déformé par un bipartisme de
façade,
·
et finalement savère naturellement élitiste,
verrouille lexclusion du grand nombre de laccès au pouvoir, et crée des
surhommes qui se croient tout permis, jusquà imposer eux-mêmes les
institutions
Hum
Et
cest censé être le meilleur système ? Peut-être, mais pour qui ?...
2. Dun autre côté,
chacun devrait apprendre (à lécole ?) que le tirage au sort a
longtemps été reconnu, dAthènes à Montesquieu, dAristote à Rousseau, comme la
modalité principale, incontournable, des valeurs dégalité et de liberté. Il a
sombré dans loubli sous dinjustes critiques : il ne pose aucun problème
insurmontable.
Le
tirage au sort respecte fidèlement la règle démocratique de légalité :
arbitre idéal, impartial et incorruptible, il protège la liberté de
parole et daction de chacun, il facilite la rotation des charges (qui empêche
la formation de castes et qui rend les gouvernants sensibles au sort des
gouvernés car ils reviendront bientôt à la condition ordinaire) et il dissuade
les parties dêtre malhonnêtes au lieu de les inciter à tricher.
Par
ailleurs, le tirage au sort ne présente aucun danger de désigner des personnes
incompétentes ou malhonnêtes si on lui associe des mécanismes
complémentaires, établis dans le souci de lintérêt général et non de
lintérêt personnel des élus :
·
on ne confie pas le pouvoir à un homme seul mais à des
groupes,
·
ne sont tirés au sort que les volontaires
(chacun se comporte ainsi comme un filtre),
·
les tirés au sort sont soumis à un examen
daptitude,
·
ils sont surveillés en cours de mandat et révocables
à tout moment,
·
ils sont évalués en fin de mandat, et
éventuellement sanctionnés ou récompensés.
Montesquieu
fait remarquer que cest la combinaison des contrôles et du
volontariat qui donne la garantie de la meilleure motivation.
Une
telle organisation protègerait mieux lintérêt général que les institutions
actuelles.
3. Concrètement, on
pourrait imaginer des systèmes mixtes, prenant le meilleur des
deux idées en les combinant astucieusement.
·
Pour la sélection des représentants, les
citoyens devraient pouvoir proposer librement les représentants quils
préfèrent. Par exemple, un tirage au sort de quinze personnes serait effectué
parmi les 5% des citoyens les plus soutenus, volontaires, et la sélection
pourrait se terminer par un vote parmi ces quinze : le principe du
consentement préalable des citoyens serait ainsi maintenu et même renforcé. La
corruption serait efficacement combattue.
·
Pour lorganisation des débats au Parlement, on
pourrait prévoir une Assemblée Nationale élue, qui serait chargée
décrire les lois mais qui, avant dimposer ces lois, devrait convaincre
de leur utilité une Assemblée des Citoyens tirée au sort (une assemblée
qui nous ressemble aurait ainsi un droit de veto, en plus dun droit
dinitiative et de contrôle). Plus démocratiques, ces institutions imposeraient
aux professionnels de lAN découter et de respecter le peuple quils
représentent, tous les jours et pas tous les cinq ans, à travers un débat
permanent et honnête.
Les
Athéniens faisait de lisègorié le droit de parole égal pour
tous à lassemblée le pilier fondamental de toutes leurs libertés.
Mais aujourdhui,
qui pose les questions dans
notre prétendue démocratie ?
En
France comme ailleurs, ce nest pas aux hommes au pouvoir décrire eux-mêmes
les limites de leurs propres pouvoirs (la constitution). Ce nest pas
aux élus de décider à notre place si lélection vaut mieux que le tirage au
sort : ce choix de société ne peut être tranché que par référendum.
(Fin du résumé)
Vous pouvez lire ici larticle intégral (8 pages, format rtf ou format pdf).
Jaimerais que vous me donniez votre
avis sur cette mise au point, un peu longue, pardonnez-moi, mais importante
pour nous tous, je crois.
Ce sujet me semble décisif et
pourtant, il est occulté, maltraité, déformé, bâclé
(interdit ?)
Jaimerais savoir si vous voyez
des failles graves dans le raisonnement que jessaie de synthétiser ici.
Je vous
propose deux lieux de débat,
cette fois : sur le site de Marianne2007.info où jai publié ce texte : http://www.marianne2007.info/Etienne_Chouard_r80.html
et sur la partie du forum que jai dédiée au choix
entre élection et tirage au sort : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2261#p2261.
La « synthèse » dun demi-débat (13
octobre 2006) (Lien)
Le Monde a publié une « synthèse » sur papier des échanges du 9 octobre où jétais invité à débattre. Je suis
peu coutumier du fait et je suis un peu long à analyser les événements, mais ça
vient doucement.
Dabord, je dois être reconnaissant aux journalistes qui
mont ainsi gentiment offert une tribune très inhabituelle. Leur accueil fut
chaleureux et sympathique et je les remercie.
Je reste pourtant un peu sur ma
faim sur le fond de ce qui occupe désormais mes jours et mes nuits :
dabord parce que la « synthèse » papier ne garde presque aucune
trace de ce que jai pu dire ce soir-là.
Mais surtout parce que nous étions
trop nombreux pour quun vrai débat sinstaure, une échange argumenté qui
aurait pu permettre aux points de vue de se rapprocher : en effet, sur
chaque point, où jexposais une thèse, on formulait ensuite des objections, que
je trouvais faibles ou inadaptées, mais je ne pouvais pas leur répondre (alors
que cétait facile) car il fallait bien sûr laisser la parole aux autres et
quil y avait beaucoup de sujets graves à évoquer
Il valait donc mieux, ce
soir-là, parler en dernier, car on ne parlait quune fois de chaque sujet. Un
demi-débat ou même un fragment de micro-débat, en quelque sorte. Cest
frustrant.
Ceci dit, les interventions des
uns et des autres étaient très intéressantes.
Pour savoir ce qui sest vraiment
dit, je vous conseille découter
la bande son car la « synthèse » papier nest pas très fidèle. Et
pour mexprimer librement et complètement, décidément, il ny a pas de meilleur
moyen que lInternet (voir ci-dessous) J
Voilà, je viens de participer au débat
organisé par Le Monde au théâtre du Rond-Point, à Paris, sur le
thème Démocratie.fr :
comment Internet bouscule la politique, sa communication et sa pratique.
Je mattendais à avoir trop peu de
temps (nous étions une dizaine et navions que deux heures devant nous) et jai
noté par écrit ce que javais à dire pour publier ici une version complète de
ce que pense du sujet, au calme.
Voici donc le texte (prévu mais
pas bien respecté J),
et je vais me coucher (il est 3 heures du matin et jai cours demain ;o)
|
Bonsoir, merci pour cette tribune.
Je nai que 5 minutes, ce qui est un espace minuscule pour
résumer un sujet qui a pris toute la place dans ma vie depuis deux ans, mais
cest un espace suffisant pour semer les graines qui germeront ensuite comme
elles peuvent.
Pour détailler un peu ce qui mérite vraiment de lêtre, je
publierai sur mon site une version écrite de ce que jai à dire ici à propos
du thème de ce soir : démocratie.fr, quest-ce quon peut espérer, et
redouter, dInternet à propos de notre démocratie ?
Je suis un simple citoyen et, par là même, sans tribune et sans
moyen de résister aux abus de pouvoir. Pour moi, Internet est donc une
lumière au bout du tunnel, un tunnel dobéissance entre deux élections où
nous ont enfermés nos propres élus.
Jai pris conscience de cet enfermement au moment de la campagne
référendaire sur le TCE : jai réalisé que, dans les institutions de
lUnion européenne, il ny avait, pour les personnes physiques, AUCUN moyen
de résister aux abus de pouvoir de la part dorganes qui se sont placés
eux-mêmes hors du contrôle des citoyens.
Jai aussi découvert, à lopposé et comme par effet de miroir,
que les personnes morales (lobbies) dictent le droit dans lombre,
loin des procédures démocratiques.
La situation est à peu près la même en France et je me bats
depuis pour rendre honnêtes les institutions, aussi bien nationales
quinternationales.
Cest Internet qui ma servi de tribune. Cest Internet qui nous
a servi dAgora. Faute de mieux.
Un an après le « non » des électeurs au projet de
« traité constitutionnel » (sic) de leurs représentants, il est
utile de faire le point de ce quInternet représente, en espoir et en
menaces, pour la démocratie.
1. Internet est dabord un espoir quand il offre à tous une tribune libre
contre les abus de pouvoir.
Abus de pouvoir en provenance dinstitutions dévoyées par nos propres élus qui
sécrivent pour eux-mêmes des institutions sur mesure où les citoyens, entre
deux élections, ne comptent pour RIEN.
Je prétends que ce nest pas aux hommes au pouvoir décrire les
règles du pouvoir. Ce nest pas aux parlementaires, aux présidents, aux
ministres, aux juges
décrire eux-mêmes la Constitution, car ils sont à la
fois juges et parties dans le processus constituant et quils ont un
intérêt personnel à limpuissance politique des citoyens, un intérêt
personnel qui soppose frontalement à lintérêt général.
Ce nest même pas leur faute sils trichent en écrivant la
Constitution : nimporte qui ferait de même, sans doute ; ce nest
donc pas du tout un complot ou une maffia, je ne dis pas du tout « tous
pourris » : mais comme Aristote et Montesquieu, je dis « tous
dangereux » ; on a besoin deux, mais ce nest simplement
pas à eux décrire la Constitution et cest bien notre faute à nous,
les autres, ceux qui acceptent de navoir jamais le pouvoir et de le
déléguer, cest notre négligence quand nous laissons nimporte qui
écrire la Constitution, nous sommes fous : tout est là, ce qui compte, ce nest pas qui VOTE la Constitution, ce qui
compte, cest qui ÉCRIT la Constitution.
Abus de pouvoir à travers des médias achetés et vendus comme des
savonnettes par les plus riches et qui fonctionnent à sens unique comme des
instruments de propagande, sans donner la parole aux citoyens. Je ne développe pas, tout le monde en parle, mais les médias devraient
devenir très largement interactifs pour satisfaire le besoin des citoyens de
devenir ACTIFS.
Internet et des sites comme celui dACRIMED jouent donc un rôle essentiel
de surveillance et dalerte.
2. Internet est une menace pour le débat et pour lélaboration dun monde commun car
il radicalise les opinions (mais attention, il nest pas le seul :
mal organisé, mal composé, le Parlement peut présenter le même défaut).
Sur Internet on choisit ses interlocuteurs et, par confort, nous
avons tous tendance à éviter les forums qui nous sont hostiles et à
fréquenter plutôt les forums qui sont du même avis que nous. Or quand des
semblables parlent à leurs semblables, mécaniquement, ils se radicalisent.
Bernard Manin, penseur politique dune exceptionnelle clarté, a
formidablement souligné cette faiblesse importante dans un document que je
signale et commente sur ma page Liens.
Mais il faut comprendre que si nous nutilisons
quInternet, cest faute de mieux, car nous navons, pour linstant,
que cet outil pour participer vraiment au débat public.
Il faut signaler aussi que les radios et la télévisions ne font
pas mieux, elles qui invitent sans cesse les mêmes éditorialistes, les
mêmes prêtres de la pensée unique, sans contradicteur le plus souvent, ce
qui, là aussi, radicalise les opinions.
La démocratie, comme lexplique fort bien
Pierre Rosanvallon, cest beaucoup plus que le droit de sexprimer
librement : cest la discussion obligatoire avec nos adversaires avant
de décider : le rôle majeur des institutions démocratiques, cest de
nous forcer, tous, à entendre et à réfuter les opinions contraires aux nôtres
pour bâtir un monde commun en connaissance de cause.
De ce point de vue, avec un mode de scrutin inique qui exclut
carrément du débat des millions délecteurs, qui écrase les minorités en
amplifiant le fait majoritaire ou qui nous impose des « têtes de
listes » choisies sans nous, nos institutions ne sont pas démocratiques
et le Parlement lui-même norganise pas toujours comme il faut la
contradiction publique indispensable avant de décider : il existe bien
trop de moyen de tricher et de passer en force sans débattre.
Donc, lInternet ne peut pas se substituer à des institutions
démocratiques, mais celles-ci restent à imaginer car les nôtres ne le sont
pas du tout.
3. Internet est un espoir historique, inédit, enthousiasmant, pour connaître enfin la volonté
générale, la vraie !
Depuis toujours, on butte sur laporie, la difficulté
insurmontable, de limpossible démocratie directe à cause de notre grand
nombre. La volonté
générale est une sorte de Graal jusquici inaccessible et la
représentation électorale est un pis-aller, faute de pouvoir, matériellement,
consulter tout le monde à tout propos.
La difficulté du nombre nous oblige depuis toujours à déléguer, à
nous faire représenter, malgré tous les risques de confiscation du pouvoir
par les élus que lon constate tous les jours. On voit bien que les élus
substituent souvent leur volonté personnelle à la volonté générale en se
gardant bien, le plus souvent, de nous consulter sur les grands
dossiers : OGM, OMC, AGCS, privatisations, etc.
Aujourdhui, on a enfin le moyen de consulter
tout le monde, à tout propos et à tout moment : on peut même poser
nous-mêmes les questions qui nous semblent essentielles. Il faut absolument
découvrir le site de lExpérience
démocratique, cest peut-être la meilleure idée du monde pour nous
sortir de lâge de la pierre démocratique.
Ce que nous offre ici la technique de lInternet est absolument
historique, nouveau et tout à fait enthousiasmant et cela devrait
révolutionner les principes mêmes du droit constitutionnel.
Mais cela risque de mettre nos représentants
politiques au chômage partiel, et donc, il ne faut attendre deux aucune
proposition honnête sur ce point (vous allez voir
quil vont vous expliquer, eux et leurs amis intellectuels et journalistes du
bon côté du manche, que tout le monde sait depuis longtemps que la volonté
générale nécessite absolument, oui Monsieur, absolument, une intermédiation,
une représentation, qui permet à cette volonté générale de prendre forme, de
se cristalliser, de sorganiser) : cest donc à nous de leur imposer,
à travers une Constitution dorigine citoyenne, notre participation directe à
tous les grands débats, puisque cest aujourdhui possible mais que nos élus
ne nous la rendront jamais de leur plein gré. Et cest précisément le
sens de mon dernier point :
4. Internet est un espoir historique pour écrire nous-même une Constitution dorigine citoyenne
Jai expliqué pourquoi ceux qui ont écrit un
aussi mauvais plan A que le TCE ne peuvent pas écrire un bon plan B : ce
nest pas au ministres ou aux parlementaires décrire la constitution. Le
seul plan qui vaille est le Plan C, C comme Constitution Citoyenne dont les
auteurs ne sont pas à la fois juges et parties.
Je ne partage pas le pessimisme de Pierre Rosanvallon, (dont je
dévore les livres les uns après les autres même si ses conclusions me font
souvent grimper aux rideaux), quand il renonce à institutionnaliser les
pouvoirs de surveillance.
Jamais nous navons eu à notre disposition un outil de
communication comme Internet, jamais nous navons pu disposer dun outil de
travail collaboratif comme les sites WIKI. Pensez à lencyclopédie Wikipédia,
le plus grand recueil de savoir humain bâti à partir de la générosité et la
collaboration des hommes, sans compétition, sans profit, sans rentabilité
financière
Nous pourrions mettre au point non pas un mais quelques projets
constituants innovants sur cet espace de liberté inouï.
Après huit mois passés sur le forum à débattre des principes à
respecter dans une Constitution honnête, jai créé au mois daoût une partie
wiki pour enfin écrire de vrais articles. Cest un bébé, ça commence à peine,
mais je vous invite à nous rejoindre et à écrire vous-mêmes la constitution
idéale, à vos yeux.
Il me semble que chaque citoyen devrait faire
cet effort décrire lui-même les quelques articles de constitution qui lui
semblent prioritaires : dites-vous pendant une heure (et plus si ça vous
intéresse) que cest vous qui avez le pouvoir dorganiser les pouvoirs, la
participation des citoyens, les contrôles des organes et des médias, etc.
Vous verrez que cest passionnant (la constitution
nest pas ce texte ennuyeux et poussiéreux dont on voudrait nous
éloigner : le débat de lan passé montre bien lintérêt que tous peuvent
y porter, pour peu que notre réflexion ait une chance dêtre prise en compte
réellement, tout est là) et que vous lirez ensuite avec beaucoup plus
dacuité et de discernement les projets de constitution qui vous seront
soumis.
Quand nous aurons écrit ce projet, ce ne sera plus une
utopie : nous aurons montré 1) que cest possible (de simples citoyens
peuvent très bien écrire une bonne Constitution), et 2) que cest beaucoup
mieux (les contre-pouvoirs y sont effectif et pas factices).
Tout compte fait, je vois lInternet comme une technologie nouvelle et révolutionnaire
rendant les citoyens capables décrire eux-mêmes leur Constitution et faire
surgir la volonté générale, la vraie ! dans le débat public. Jappelle
cela « sortir nous-mêmes de la préhistoire de la démocratie ».
À bientôt sur le forum et le wiki J
(Projet dintervention au débat du Monde du lundi 9
octobre 2006, au Théâtre du Rond-Point, Paris.)
|
Le Monde a rédigé une « synthèse » des
débats : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-822246@51-822051,0.html.
Lenregistrement audio est là : http://www.lemonde.fr/web/son/0,54-0@2-3208,63-822031@51-822051,0.html
On peut en parler là,
si vous voulez : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/09/25/46-les-resistances-aux-pouvoirs-abusifs-sont-elles-une-contre-democratie&cos=1#c1258.
Bonne nuit J
Pierre Rosanvallon fustige souvent Marat en
dénonçant son "populisme".
Pourtant, en lisant Marat dans le texte, on trouve souvent
des réflexions plutôt censées et utiles, exprimées dans un style délicieux, et
pas tant les excès maladifs qu'on voit dénoncés partout.
Par exemple, j'attire votre attention sur un passage qui évoque
la difficulté à contrôler les pouvoirs, difficulté qui grandit avec la taille
des États :
|
De l'étendue de lÉtat.
C'est à la violence que les États
doivent leur origine ; presque toujours quelque heureux brigand en est le
fondateur, et presque partout les lois ne furent, dans leur principe, que des
règlements de police, propres à maintenir à chacun la tranquille jouissance
de ses rapines.
Quelqu'impure que soit l'origine des
États, dans quelques-uns l'équité sortit du sein des injustices, et la
liberté naquit de l'oppression.
Lorsque de sages lois forment le
gouvernement, la petite étendue de l'État ne contribue pas peu à y maintenir
le règne de la justice et de la liberté ; et toujours d'autant plus
efficacement qu'elle est moins considérable.
Le gouvernement populaire parait
naturel aux petits États, et la liberté la plus complète s'y trouve établie.
Dans un petit État, presque tout le
monde se connaît, chacun y a les mêmes intérêts ; de l'habitude de vivre
ensemble naît cette douce familiarité, cette franchise, cette confiance,
cette sûreté de commerce, ces relations intimes qui forment les douceurs de
la société, l'amour de la patrie. Avantages dont sont privés les grands
États, où presque personne ne se connaît, et dont les membres se regardent
toujours en étrangers.
Dans un petit État, les magistrats
ont les yeux sur le peuple, et le peuple a les yeux sur les magistrats.
Les sujets de plainte étant assez
rares, sont beaucoup mieux approfondis, plutôt réparés, plus facilement
prévenus.
L'ambition du gouvernement n'y
saurait prendre l'essor sans jeter l'alarme, sans trouver des obstacles
invincibles. Au premier signal du danger, chacun se réunit contre l'ennemi commun,
et l'arrête. Avantages dont sont privés les grands États : la multiplicité
des affaires y empêche d'observer la marche de l'autorité, d'en suivre les
progrès ; et dans ce tourbillon d'objets qui se renouvellent continuellement,
distrait des uns par les autres, on néglige de remarquer les atteintes
portées aux lois ou on oublie d'en poursuivre la réparation. Or, le prince
mal observé, y marche plus sûrement et plus rapidement au pouvoir absolu.
|
Extrait (page 22) de "Les
chaînes de l'esclavage" de Jean-Paul
Marat (1792) :
De quoi nous faire réfléchir avant de créer de nouveaux empires,
non ?
Moi, je trouve ce "dangereux populiste" bien humain et
bien séduisant :o)
Si vous
connaissez, vous aussi, d'autres "populistes" qui s'expriment si
finement, soyez gentils de me les faire connaître :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/09/28/47-reflexion-de-marat-sur-la-taille-limite-d-un-etat-democratique
Manifeste pour la vraie
démocratie (10 juin 2006) (Lien)
Chers amis,
Vous vous souvenez peut-être de ce livre de Pierre, « Manifeste
pour la vraie démocratie », dont je vous avais parlé juste avant Noël
(voir plus bas, le 23 décembre) parce quil avait enclenché chez moi une vraie
mutation.
On pourrait écrire cette quatrième de couverture :
« Lauteur nous fait une démonstration implacable de
labsurdité et des dangers de la course au pouvoir organisée par nos
institutions politiques prétendument démocratiques.
Pour ce faire, il sattaque à un tabou politique : les
élections au suffrage universel ! Il nous montre quelles mènent à un
résultat inverse de lidéal démocratique. Mais il ne se contente pas de
condamner le système : il nous en offre un autre, sur un plateau, à la portée
immédiate de tout un chacun. Un système qui libère les citoyens den bas de
lemprise des pouvoirs den haut.
Le Manifeste pour la vraie démocratie est peut-être la
bombe politique du 21ème siècle : une bombe non-violente
capable de neutraliser les principales sources de violences. Un pavé jeté par
un simple citoyen dans le marigot fangeux des politiciens professionnels. Il
remet à plat les principes fondateurs de la démocratie pour la reconstruire sur
des bases incontestables. Au probable grand dam des notables de tous bords.
Dès lors, des perspectives formidables souvrent aux citoyens
de bonne volonté avec ce projet généreux et désintéressé. »
Pierre, que je nai jamais rencontré,
écrit sous le pseudo dAndré Tolmère et il a du mal à trouver un
éditeur. Je ne comprends pas cette situation car je trouve son livre original,
important et détonnant : il ma remué en profondeur et ce séisme intérieur
ma conduit à lire bien dautres livres importants consacrés, eux aussi, à ce choix
décisif (ou équilibre) entre élection et tirage au sort (Bernard Manin,
Philippe Braud, Mogens H. Hansen, Pierre Rosanvallon
). Écrit au vitriol
dans un style vif et rapide, solidement argumenté (sa bibliographie est passionnante),
illustré dexemples concrets, astucieux, cest un outil politique écrit par
un simple citoyen, cest captivant, on se sent directement concerné à
toutes les pages, on parle de choses essentielles.
Je suis sûr que des éditeurs militants
comme Raisons dagir, Agone, La Découverte ou LÉclat (en lyber,
gratuit sur le net et payant sur papier) seraient intéressés sils
connaissaient son existence. Fayard ou Albin Michel pourraient
également publier ce livre de résistance, il me semble. Si lun dentre vous
connaît quelquun chez ces éditeurs, il faudrait leur signaler ce manuscrit
décapant.
Dépité par le silence des éditeurs,
Pierre me permet de publier son livre. Cest une chance pour nous tous. Imprimez
ce texte, mes amis, (jai réglé la mise en page pour permettre le recto
verso), et lisez-le, cest un document considérable. Vous y passerez une
après-midi ou deux qui, directement ou indirectement, peuvent changer votre
vie.
Vous pouvez télécharger cet
étonnant manifeste ici :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Manifeste_pour_la_vraie_democratie.rtf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Manifeste_pour_la_vraie_democratie.pdf
Et, comme dhabitude,
vous pouvez réagir ici :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/06/10/43-manifeste-pour-la-vraie-democratie
Gérard Filoche, un inspecteur du travail qui fait
honneur à sa profession, un authentique défenseur des salariés (80% de la
population active, nest-ce pas ?), ma envoyé ce matin un message que je
trouve important et que je vous livre ici, puisquil est probable quaucun
"média dinformation" ne vous en parlera jamais
(Attention pourtant :
ces journalistes, si discrets sur la véritable tyrannie des élus qui règne
souvent au sein des partis politiques, sont des pros de linformation fiable,
alors que nous, simples citoyens, ne sommes, bien sûr, que des charlots) :
|
De : Démocratie et socialisme democratie.et.socialisme@wanadoo.fr
Date : Wed, 07 Jun 2006 02:48:34 +0200
Objet : BREF COMPTE RENDU DU BN DU PS DU 6 JUIN 2006
Le Bureau National s'est tenu de 16 h à 1 h 30 du matin.
Nous y étions invités, Marc Dolez et Gérard Filoche pour défendre
notre point de vue.
Dés le début François Hollande a voulu interdire Marc
Dolez de parole. Présent oui, mais sans droit d'expression.
Personne ne s'est opposé à cet interdit, personne.
Il a fallu attendre une vingtaine de minutes pour que lors
de son tour de parole, Dsk en profite pour préciser que si nous étions
invités nous devions pouvoir parler.
Cela a fait reculer François Hollande qui nous alors
laissé parler ensuite.
Ce que Marc Dolez a fait en expliquant le sens de notre
démarche, un contre projet, mais puisque il nous était refusé de le
soumettre au vote des militants, nous avions fait dix amendements.
François Hollande a dit "pas de contre projet"
Personne n'a rien dit.
Ensuite on est passé à l'examen des 34 pages du projet une
à une. Nous découvrions le projet au fur et a mesure, les autres l'avaient eu
la veille.
Nos amendements écrits nont pas été distribués aux 100
camarades présents. Pas plus que aucun autre amendement de quiconque na été
communiqué par écrit a lassemblée de ce BN pendant les 9 h 30 de débat.
Nous sommes intervenus les premiers pour dire
- qu'il fallait rejeter la "retraite à la carte"
mot d'ordre du medef
- qu'il fallait défendre la retraite à 60 ans
- refuser le temps partiel dit choisi mais subi,
- rapprocher la durée réelle du travail des 35 h en
abaissant la durée maxima de 48 à 44 h, en majorant le taux des heures
supplémentaires et en diminuant le nombre, le contingent, le compte épargne
temps, les deux jours de repos consécutifs, etc.
- contrôler les licenciements abusifs et boursiers.
On a sauvé le parti (et le peuple français) de la
retraite à la carte,
... et fait réintroduire le chiffre de 60 ans dans la
partie retraite, mais pas l'indexation sur les salaires, ni les 10 meilleures
années, ni le taux de remplacement à
75 %, ni fait revenir le nombre d'annuités de cotisations au nombre moyen
réel d'années travaillées par les salariés français (37 annuités).
On a fait quelques amendements de sauvegarde (la date des
élections prud'hommes, le doublement des effectifs de l'inspection du
travail... etc.)
À la fin, il n'y a toujours pas les modalités de la
retraite à 60 ans, rien sur le droit du licenciement, rien de correct sur les
35 h, (on a fait revenir faiblement le mot "loi"), rien de
substantiel sur les salaires...
Bon voilà...
À la fin, vers 1 h,
François Hollande a encore refusé que nos amendements non intégrés
soient soumis au vote des militants pour le 22 juin...
Personne n'a rien dit... Aucun courant, aucune
sensibilité, aucune personnalité présente na demandé la démocratie...
À la fin, il y eu trois abstentions (François Delapierre,
Mariane Louis, Arnaud Montebourg) et
nous étions deux à voter contre : mais François Hollande a déclaré que nos
voix ne comptaient pas...
Pas de démocratie, pas de liberté
de choix, pas de droit de décider, pas de possibilité de proposer des
amendements aux militants... Ce, en dépit des
statuts et traditions de ce parti, il avait toujours été possible de déposer
des amendements au projet,
différents, aussi bien en 1980 quen 1988...
Le projet qui nous est soumis là sera le projet de tout
le parti sil est voté par les militants...
Il est un des textes les plus modérés que le parti ait
voté depuis plus de dix ans...
Pas de mesure phare, que des demies mesures !
Pas de transformation sociale pour redistribuer les
richesses, pas question de reprendre aux profits les 10 points quils
ont pris aux salaires, donc pas de financement, donc peu davancées in
fine...
Tous les artisans de la synthèse
du Mans se sont donc retrouvés sur un texte en retrait même de ladite
synthèse, non seulement rien na avancé vers la gauche, mais cest plutôt de
façon droitière que des mois de discussion, détats généraux internes, se
concluent !
Nous allons attirer lattention de tous les militants,
anciens et nouveaux, par tous les moyens possibles de communication, certes
limités par la volonté de François
Hollande et de tous les membres présents qui nont pas levé le petit doigt
pour défendre le droit de déposer et de faire voter des amendements...
Nous allons demander partout ou cest possible à nos
camarades de faire circuler les amendements et de le soumettre au vote de
leurs fédérations, des militants et appeler a rejeter le projet en létat.
Gérard Filoche
|
Il se trouve que je suis en train de lire un livre décapant que ma
spontanément envoyé un lecteur canadien (merci François :o) qui sintitule
« Abolir les
partis politiques » de Jacques Lazure (édition Libre
pensée, 2006). Le plan de ce livre donne une idée forte de ses thèses qui
résonneront dans toutes vos têtes avec des exemples infinis puisés dans la vie
politique française :
|
Abolir les partis politiques, de Jacques Lazure
(Libre pensée, 2006)
Introduction
I - Les méfaits des
partis politiques
Chapitre
1 : la quête de pouvoir
Les partis stratégiques
Les partis idéologiques
Course à la direction dun parti
Le chef de parti en campagne
électorale
Le chef de parti au pouvoir
Les nominations partisanes
Le bâillon gouvernemental
Un gouvernement minoritaire
Chapitre 2 la
quête de la belle image
Les sondages
Le vedettariat
Les partis politiques en
spectacle
Agents de publicité et
conseillers en communication
Chapitre
3 : la quête de largent
Avant la loi électorale du
gouvernement Lévesque
La loi électorale du
gouvernement Lévesque
Le gouvernement fédéral et le
financement des partis
Chapitre
4 : la dépersonnalisation
Les candidats bidon et les
exclus
Le chef et son cabinet
ministériel
La ligne de parti
Les votes libres
II - Par quoi
remplacer les partis politiques ?
Chapitre 5 : préalables au
nouveau régime gouvernemental
Chapitre 6 : esprit du
nouveau régime
Foin de la partisanerie !
La personnalisation
Le service du bien commun
Le dialogue et la coopération
entre les députés
Une démocratie plus forte pour
les citoyens
Chapitre 7 : élection des
députés
Présentation dun curriculum
vitae public
Le problème de la représentation
proportionnelle
Des élections à date fixe
Un nombre important de
signatures
Dépenses électorales à payer par
lÉtat
Des élections à deux tours de
scrutin
Le droit de démettre les députés
Chapitre 8 : le
fonctionnement de lAssemblée nationale
Lexercice dun plein pouvoir
législatif
Premières séances de lassemblée
nationale
Information
mutuelle
Décisions
préalables
Choix
politiques et budgétaires
Nominations
importantes
Commissions parlementaires
Chapitre 9 : le pouvoir
exécutif et les ministres
Chapitre 10 : le premier
ministre
Chapitre 11 : mouvements politiques
et sociaux
Conclusion
|
En cherchant des infos sur ce livre, jai trouvé ce blog canadien : http://steveproulx.typepad.com/steve_proulx/2006/05/abolir_les_part.html
Je tiens évidemment aux partis
comme un moyen important de se regrouper pour résister à loppression, et je
pencherais plutôt, pour linstant, pour un tirage au sort au sein des partis pour
désigner des porte-parole temporaires plutôt que des élections
qui désignent des chefs indéboulonnables : on se heurte au sein même
des partis au même problème, exactement, de la confiscation de la démocratie
par les élus quon observe dans la Cité.
Comment nous débarrasser des
arapèdes cratocrates ?
Je vous recommande le site www.democratie-socialisme.org/, un lieu de résistance réelle.
Un plan B démocratique (5 juin 2006) (Lien)
Je viens de recevoir un message très intéressant et je voudrais,
avec laccord de son auteur, vous le faire connaître :
|
De : Troy Davis <troydavis@post.harvard.edu>
Date : 29 mai 2006 09:45:08 HAE
(ÉUA)
À : Etienne Chouard <etienne.chouard@free.fr>
Objet : Un Plan B démocratique
Bonjour Étienne,
vous serez peut-être intéressé par
mon travail :
- Le concept d'ingéniérie démocratique
rationnelle (sans le savoir et sans théorie pré-établie, vous êtes ce que
j'appelle un "ingénieur en démocratie", qui sera je l'espère un des
grands nouveaux métiers du XXI siècle).
- Le projet de l'École de la démocratie, la première de ce type au monde,
basé à l'origine sur la notion philosophique de dignité égale de tous et de
citoyenneté mondiale : http://www.ecoledelademocratie.org, de niveau universitaire,
recherche et formation inter- et supradisciplinaire, pour former des
politiques, des hauts fonctionnaires et des conseillers indépendants en
démocratie.
- L'application de la théorie de
l'ingéniérie démocratique au processus européen, qui m'a mené même
avant le 29 mai à théoriser un Plan B démocratique et INTRINSÈQUEMENT participatif, en trois étapes fondamentales:
1. Référendum européen sur les questions
fondamentales et le cadre politique fondamental :
- Voulez-vous une constitution
européenne ?
- Une telle constitution
devrait-elle définir une citoyenneté européenne et des droits
fondamentaux ?
Si oui, on continue ; si non,
on arrête les frais. Si oui, on
a un mandat politique clair qui court-circuite les interférences de politique
nationale, et qui "sépare" ceux qui ont voté Non contre l'Europe en
tant que telle, ou Non contre UNE Europe spécifique, trop libérale etc. Donc fini de l'amalgame droite anti-européenne
et gauche pro-Europe anti-libérale.
2. L'élaboration par les grands
groupes politiques européens de projets de constitution, pendant un an par exemple.
Parlements nationaux + Parlement Européen
(cela rapprocherait aussi les deux niveaux ce qui aurait des avantages
connexes non négligeables)
On peut imaginer d'autres
constellations mais l'idée non négociable est que les Européens doivent avoir le CHOIX entre
plusieurs versions de l'Europe. Après
tout, imposer une constitution fourre-tout n'est ce pas aussi démocratique
que d'imposer un parti unique à des élections ? Où
alors est la démocratie ?
3. Référendum européen sur les
diverses propositions constitutionnelles mises en lice.
Si une proposition retient 65% des
voix (quasiment impossible si on a 4 ou 5 propositions de constitution), elle
passe, sinon les deux avec le plus grand pourcentage de vote sont mis en
panachage un mois plus tard. Pourquoi
un mois et pas une semaine ? Pour,
encore une fois, permettre une vrai discussion en Europe sur les mérites
respectifs de ces propositions pendant plusieurs semaines. Une semaine ne suffit pas.
Résultat : un processus possible, plausible,
qui maximalise la participation citoyenne de manière naturelle et non forçée
ou non dépendante du civisme supposé de 500 millions d'Européens.
Voyez sur ce blog aussi: http://www.europeus.org/troy_davis/ (mais là, je n'avais pas encore mis
les parlements nationaux dans le coup).
Le plus inédit,
c'est la mise en concurrence démocratique de plusieurs projets, qui est à l'opposé
de la "tyrannie de l'unité", à laquelle malheureusement presque
tous se soumettent en voulant faire UNE constitution quasiment idéale par une
démarche participative maximale. Ce qui intrinsèquement amènera
beaucoup moins de gens à participer que dans l'approche que je propose, car
des millions de gens se diront que "puisqu'on concocte de toute façon
une grosse soupe, que ma contribution ne sera pas décisive, j'y vais
pas". Tandis qu'en
permettant aux grandes formations de chacune créer sa recette et de la
défendre, les gens auront plus de chances de faire passer leurs idées, et
surtout, le fait que les versions différentes seront soumises au vote
souverain des Européens, fera que NATURELLEMENT, les groupes politiques
feront des tas de consultations dans toute l'Europe pour, d'une part, écouter
les citoyens et augmenter leurs chances de gagner la compétition
constitutionnelle et, d'autre part, juste psychologiquement pour pouvoir dire
qu'ils les ont écoutées, et là aussi, augmenter leur chances.
Ma proposition met également dans
le coup les politiques et les partis, qui, quoi qu'on en pense, sont
impossibles à évacuer de la scène politique.
Ceux qui ne
proposent pas d'alternative plausible (en évacuant les partis) ne rendent pas
service à notre cause commune d'une europe démocratique, car on ne fait
qu'augmenter le cynisme des gens qui verront dans ces propositions qu'un
idéalisme impossible et une sorte de méthode coué, seulement réalisable si la
nature humaine était meilleure qu'elle ne l'est.
Amicalement,
Troy Davis
Consulting democracy engineer / ingénieur-conseil en démocratie
Président, Association de soutien à l'Ecole de la Démocratie
http://www.ecoledelademocratie.org
|
Comme je le disais dans ma page Liens
quand je vous en ai parlé la demaine dernière :
« Troy Davis envisage de faire
rédiger ces projets par des parlementaires (nationaux et européens), ce qui
revient à continuer à faire écrire les règles du pouvoir par les hommes au
pouvoir, ce qui constitue, pour moi, on le sait, un sabordage en bonne
et due forme (du point de vue de ceux qui tiennent à se protéger contre les
abus de pouvoir, cest vrai, pas pour les autres). Cela ne fait rien, débattons : cet homme
est intéressant :o) »
Jai répondu à Troy, bien sûr, et
je lui ai dit combien je trouvais séduisante cette belle idée dune École de
la démocratie, même si je trouve le site un petit peu "sec"
Je
lui ai suggéré dy proposer :
- Des
exemples étrangers commentés dinstitutions vraiment démocratiques (la Constitution
du Venezuela, par exemple, que je trouve tout à fait surprenante et
enthousiasmante),
- Des
propositions inédites, jamais essayées à ce jour,
- Des
expériences historiques notables (avec des hypothèses pour expliquer les
éventuels échecs, et des suggestions d'améliorations
),
- Des outils
pédagogiques pour illustrer l'essentiel de qui constitue une démocratie
: BD, schémas, graphiques, tableaux comparatifs
- Un forum
de discussion
pour échanger des arguments sur vos idées,
- Des
outils de vote
pour évaluer (en première approche) la popularité de vos idées,
- Un rappel
des arguments qui enrichissent lidée démocratique avec lidée
républicaine,
- Etc.
Ce qui m'intéresse, vous l'avez
compris, ce sont des outils pour aider les gens normaux à s'approprier
l'acte constituant et se passer des experts. J'ai été profondément marqué
par cette thèse d'Aristote selon laquelle un vrai citoyen est
capable de gouverner comme d'être gouverné et la politique ne doit surtout pas
être un métier.
Si vous avez, chers lecteurs, dautres
idées pour enrichir son projet et préparer notre réappropriation du fait
démocratique, faites-le savoir sur le blog où je vais créer un billet
correspondant à cet article de journal :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/06/05/42-un-plan-b-democratique .
Chômage, dividendes et
Constitution dorigine citoyenne :
la seule vraie solution contre le chômage de masse est, pour les citoyens,
décrire eux-mêmes une Constitution qui impose la démocratie dans
lentreprise, rendant enfin possible une juste répartition des richesses. (14 mai)
Ce combat-là devrait, logiquement, être prioritaire sur tous les autres. (Lien)
Chers amis,
J'ai besoin de votre esprit critique.
En marge de ma bagarre pour faire valoir que, pour bâtir une
juste démocratie, "ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les
règles du pouvoir", (nous devrions rendre parfaitement distincts et
incompatibles le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués), je cherche à
vérifier (avec vous, si vous le voulez bien) une thèse économique, plutôt mal
vue par la pensée unique du moment, et pourtant fort séduisante pour nous tous
:
Ce ne serait pas, comme on nous le serine tous les jours, le
coût du travail (des actifs) qui est trop important pour que le moteur
économique tourne correctement, ni la rigidité des employés devant la
nécessaire flexibilité, mais bien le coût
de l'actionnariat (des oisifs) qui serait confiscatoire :
l'inquiétante panne économique que nous vivons depuis plus de vingt ans serait due
à un assèchement des richesses par des
"parasites", exactement comme à l'époque de Keynes qui
avait déjà bien identifié le poison mortel de la rente au centre de son
analyse en préconisant
finalement d"euthanasier le rentier".
Pour étayer cette thèse, je cherche les chiffres exacts
de la ponction exercée chaque année sur la richesse nationale au profit des
actionnaires.
J'ai trouvé
sur le site de l'INSEE un tableau que j'ai peur de mal utiliser
et je vous sollicite pour me corriger si je me trompe :
1 Lien : http://www.insee.fr/fr/indicateur/cnat_annu/base_2000/cnat_annu_2000.htm,
2 cliquer sur Tableau économique d'ensemble
(TEE), lien en bas à gauche,
3 puis, sur la ligne 4.30, "Comptes
courants
", choisir l'année 2004 (car on n'a pas encore les
chiffres d'ensemble pour 2005),
Le tableau s'appelle "Tableau Économique d'Ensemble :
comptes courants de l'année 2004 base 2000".
Il y a là beaucoup de chiffres, mais justement : seuls
quelques chiffres sont importants et vous allez voir que vous allez comprendre
parce que vous êtes tous directement et personnellement concernés.
D'abord,
est-il correct de considérer que la
référence des richesses à distribuer (à répartir entre le facteur
travail et le facteur capital qui ont tous deux contribué à la
créer) se trouve à l'intersection de la ligne 14 nommée "B1 /PIB Valeur
ajoutée brute", et des colonnes D et E "Sociétés
financières" (les banques, etc.) et "Sociétés non
financières" ?
Si vous
êtes d'accord, on pourrait mettre en jaune les cellules D14 et E14 :
828,5 +
67,2 = soit 895,7 milliards d'euros de valeur ajoutée
(VA) pour la France en 2004.
Ensuite,
est-ce qu'il est juste de lire ces chiffres en disant que la part de VA affectée aux salaires en 2004
est sur la ligne 19 intitulée "D1 Rémunération des salariés"
?
Encore un peu de jaune sur D19 et E19
?
539,2 + 40,5 = soit 579,7 milliards d'euros
de salaires versés en 2004 (prélevés sur la VA).
Enfin,
est-ce qu'on peut dire que le prélèvement
des actionnaires sur cette richesse est sur la ligne 35 intitulée
"D42 Revenus distribués des sociétés" ?
Si cela
vous semble correct, on mettrait en jaune les cellules D35 et E35 :
145,7 + 31.8 = soit 177,6 milliards d'euros de
dividendes versés en 2004 (prélevés sur la VA).
Si ces
coups de projecteur jaune sont pertinents, ce grand tableau de chiffres imbuvables
gagne en lisibilité et devient une clef importante pour comprendre, non ?
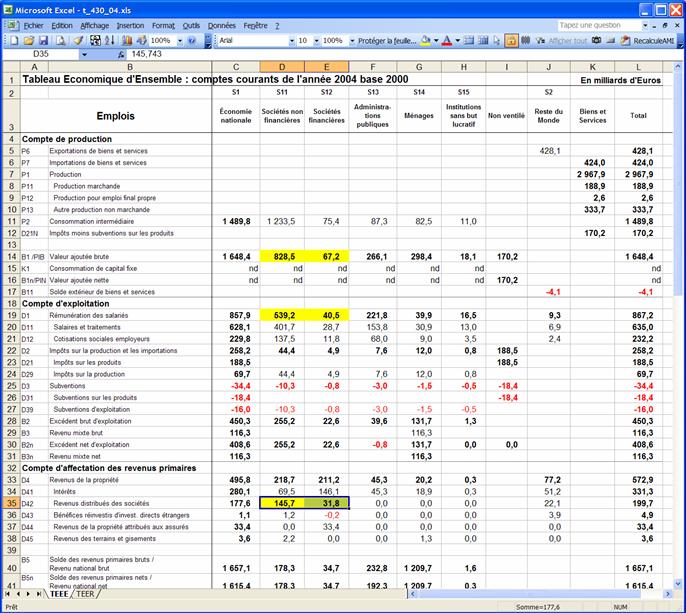
En
pourcentage, en 2004 :
la part des salaires serait donc de 64,72 % (579,7 / 895,7)
et celle des actionnaires serait de 19,82
% (177,6 / 895,7)
Est-ce que ce sont ces pourcentages qui se sont
déplacés de 10 points depuis vingt ans ? (On lit souvent que 10 points de richesse ont
été perdus pour les salaires en vingt ans, et 10 gagnés par les actionnaires.)
Pour le vérifier, j'ai fait les mêmes calculs
avec les chiffres de 1993 (chiffres les plus anciens disponibles sur la
page de l'INSEE ci-dessus), et j'ai trouvé deux pourcentages étonnants : 65,16%
pour les salaires (en 93), soit sensiblement le même qu'aujourd'hui, et 11,43%
pour les dividendes (70 Mds sur 600 de VA en 1993), soit une augmentation de
74% en 10 ans. Si ce n'est pas sur les salaires, sur quel(s) poste(s) les
dividendes ont-ils été conquis en 10 ans ? Sur les impôts ?
Et est-ce que vous savez où trouver les chiffres
d'il y a vingt ans, pour observer ce prétendu déplacement dans la répartition des
richesses entre les actifs et les oisifs ?
De mon côté, jai trouvé ce
passionnant graphique, publié par lOCDE (qui nest pas vraiment une officine
révolutionnaire) :
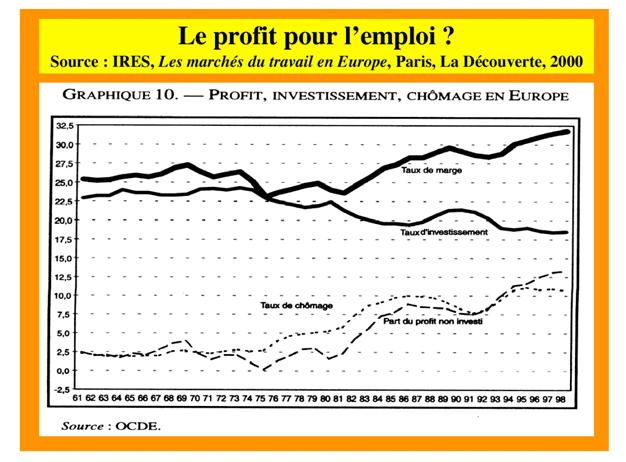
Jobserve ici deux phénomènes qui passionneront tout le
monde, y compris les damnés de la terre non formés à léconomie :
·
Les profits augmentent depuis trente ans, mais linvestissement baisse
sur la même période ! Ce qui tord le cou à un gros mensonge "gros
profits=gros investissements=enrichissement de tous".
·
La courbe du chômage évolue depuis trente ans exactement comme celle
des profits non investis (distribués), ce qui accuse les profiteurs à qui sert directement le
chômage de masse.
|
En tout cas, 180 milliards d'euros par an de richesses siphonnées (20%... un
cinquième de la richesse créée !) (passez-moi les décimales), ça
représente combien de SMIC annuels ?
Le coût d'un SMIC annuel tout compris (sans réduction de
charges) avoisine les 22 000 par an, n'est-ce pas ?
Le paiement de la rente aux actionnaires
nous coûterait donc chaque année
plus de 8 millions de SMIC annuels !
Chers amis, est-ce que j'ai commis une erreur quelque part ?
Est-il farfelu de rapprocher ce chiffre de celui des
chômeurs, officiels et officieux ?
Est-ce que tout cet argent ne manque
pas aux grandes entreprises, très simplement, pour investir et pour embaucher ?
Est-ce que ces 180 milliards par an ne
leur font pas défaut pour payer convenablement (au lieu d'étrangler par les
prix) les PME qui sont leurs fournisseurs ? La pénurie de richesse qui naît de
cette incroyable ponction ne se propage-t-elle pas dans toute l'économie
jusqu'aux plus petites PME en rendant tous les acteurs pingres parce
qu'appauvris ?
Je pense, par exemple, à
l'étranglement des PME par la grande distribution, sociétés cotées en
bourse et extrêmement profitables, mais pour qui ?
Est-ce qu'on ne se moque pas de nous
quand on prétend combattre le chômage avec de la précarisation des salariés, des aides aux
entreprises, de la "flexibilité" des salariés, des diminutions des
impôts des plus riches, des efforts des salariés dans tous les sens pour se
serrer la ceinture depuis des décennies, alors qu'un véritable racket
s'enracine et s'amplifie impunément de l'autre côté des (soi-disant)
"facteurs de production", le "facteur" qui décide,
pas celui qui travaille ?
Est-ce que vous avez entendu parler du NAIRU (Non-Accelerating-Inflation Rate
of Unemployment : "taux de chômage non accélérateur de
l'inflation"), et qu'est-ce que vous en pensez ?
(Voyez http://web.upmf-grenoble.fr/espace-europe/publication/cah_e_e/9/eisner.pdf et http://lenairu.blogspot.com/)
Est-ce qu'on peut accepter un cynisme pareil ? (un
taux de chômage minimum pour protéger le tas d'or des rentiers du
danger de l'inflation !)
Vous sentez probablement comme moi qu'il est tentant de se
déplacer alors sur des considérations juridiques, totalement intriquées
avec les données économiques :
Qui décide de cette répartition de la valeur
ajoutée ? De quel droit ?
Les dirigeants des entreprises cotées ? Par qui sont payés
ces dirigeants ? Qui contrôle leur rémunération ? Les
actionnaires ? Tiens, tiens
Y a-t-il un lien entre le niveau de rémunération des
dirigeants et leur choix de répartition des richesses ?
Qui vote aux assemblées d'actionnaires ? Y a-t-il des salariés
représentés dans ces assemblées où se décide (confirme) la répartition des
richesses créées par tous ? Tiens
et pourquoi pas ?
Pour créer des richesses, il faut
deux facteurs de production : le travail et le capital. Comment se
fait-il quun seul facteur, le capital, dispose de 100% du pouvoir ? Qui a
écrit ce droit-là ?
Quel pourrait être, quel devrait être, le rôle du droit
pour permettre enfin une certaine démocratie dans l'entreprise et, plus
largement, dans toute la société tant les choix évoqués ont de répercussions
sur la vie de tous les hommes ?
Où sont les verrous qui interdisent aux citoyens de
reprendre la barre sur
les sujets qui leur paraissent essentiels et sur lesquels leurs
"représentants" déméritent gravement ? Quelle est la réalité que
nous avons su donner, aujourd'hui, au précieux droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes ? Qui
écrit les Constitutions ? Qui devrait écrire la Constitution ?
Est-ce que vous trouvez aberrante l'idée d'imposer un
droit de vote des salariés, aux côtés des actionnaires et à part égale,
dans ces assemblées générales où des décisions essentielles (pour toute
la Cité) sont prises (ou validées) ?
Est-ce
qu'on peut attendre de la loi qu'elle limite le droit à distribuer
des dividendes ?
Selon quelle référence, quelle quotité ?
Est-ce qu'il est souhaitable d'interdire de payer les dirigeants
en actions ?
Est-ce qu'on peut imposer une
limite à l'amplitude de l'échelle des salaires dans une entreprise ? Un
revenu maximum ?
Est-ce qu'on peut revenir à un
mode de financement classique des entreprises (par prêts bancaires et
la liberté après remboursement, plutôt que l'impôt à vie que sont les
dividendes), moins dangereux que la Bourse Casino ? Est-ce
qu'on peut se débarrasser carrément des Bourses ?
Comment décontaminer tous ceux qu'on a déjà empoisonnés
en les payant avec de gros paquets d'actions ?
Est-ce qu'on peut sortir du piège qui a consisté à
embarquer de nombreux retraités qui sont bien obligés aujourd'hui de
vivre avec cette technique de financement "casino roulette black
jack" que, souvent, ils n'ont pas choisie ? Est-il concevable de
revenir du mode de financement des retraites par fonds de pension à un
financement par répartition ?
Bon, je pose trop de questions, pardon.
Surtout, que pensez-vous des chiffres que j'ai relevés
sur le TEE de l'INSEE ?
Est-ce comme ça que vous les lisez de votre côté aussi ?
C'est bien 180 milliards ?
Remarques : jai vérifié auprès de lINSEE, on ne peut
pas invalider ce chiffre en précisant qu'une (parfois large) partie de la VA
de ces entreprises cotées est créée à l'étranger : cet argument
ne vaut rien car les chiffres de lINSEE en question ont déjà été corrigés des
opérations réalisées à létranger (les chiffres de lactivité dans le reste
du monde sont isolés dans une colonne à part).
De toutes façons, la richesse créée à l'étranger, si elle
peut, malgré cette externalité de la source, profiter aux actionnaires, elle
pourrait tout aussi bien profiter aux salariés, ou à la recherche, ou aux
fournisseurs, non ?
Jai également consulté quelques éminents économistes qui
valident ma lecture des chiffres de lINSEE.
Rejoignez le débat qui est lancé sur cette question de la démocratie dans
lentreprise imposée par une Constitution citoyenne, pour éradiquer le chômage,
sur ces discussions de mon forum :
·
"Limiter le droit de propriété avec un droit des salariés sur
l'entreprise où ils travaillent" :
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=25
·
"Rendre certains services publics indépendants du pouvoir
exécutif" (les
médias, les instituts de sondage et ceux de statistiques, notamment) :
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=45
J'ai hâte de vous lire :o)
Vous pouvez réagir à cette adresse :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/05/14/40-chomage-dividendes-et-constitution-d-origine-citoyenne
Vous pouvez aussi réagir sur
Agoravox, où jai également mis cette hypothèse en débat, suscitant de très
nombreuses réactions, assez virulentes parfois, mais lensemble est intéressant :
http://www.agoravox.fr/auteur.php3?id_auteur=5765
Voici le texte intégral de la leçon de Pierre Rosanvallon
au Collège de France diffusée le vendredi 14 avril 2006 sur France Culture
(dans lémission "Éloge du savoir", de 6 h à 7 h le
matin).
La retranscription et le contrôle dune seule heure (sur
quatorze) ma demandé plus de dix heures de travail, mais je tenais à vous
faire connaître ce travail important dhistorien car je lai trouvé
proprement passionnant : on est là au cur de toutes nos difficultés
modernes. Jai hâte que Pierre Rosanvallon publie le livre correspondant à
tous ses cours intitulés « La démocratie du 21ème siècle Les voies nouvelles
de la souveraineté du peuple », et je ne manquerai pas de vous
le faire connaître dès que je le saurai moi-même.
Sa culture et son esprit de synthèse sont une arme pour nous
aider tous à défendre la démocratie : il ramène à la surface des penseurs
oubliés et il articule leurs arguments de façon éclairante.
Dabord, la présentatrice introduit la leçon, toujours de
façon très synthétique :
« Nous sommes à peu près tous daccord pour penser que nous
vivons une crise de la démocratie. Si certains pessimistes en prophétisent le
déclin, Pierre Rosanvallon, au contraire, nous propose, lui, de remettre en
mouvement une réflexion vivante sur les possibilités que cette crise offre
à la démocratie.
On pourrait résumer grossièrement ses
cours en disant que la démocratie est un régime toujours en crise qui ne
peut régler ces crises quen devenant plus démocratique, faute de
quoi
on connaît la suite.
Il sagit donc pour le peuple, auquel le
pouvoir appartient, de rompre avec le comportement du spectateur passif, de
réveiller sa liberté et son esprit critique.
Pour Pierre Rosanvallon en effet, la démocratie est indissociable
dun travail dexploration et dexpérimentation, de compréhension et
délaboration delle-même. Elle doit donc être sans cesse réinventée.
Et par exemple, dans les cours que nous écoutons cette semaine,
Pierre Rosanvallon réfléchit avec nous sur les
pouvoirs de surveillance que le peuple exerce sur les gouvernants et
sur les conditions qui pourraient faire en sorte que ces pouvoirs de
surveillance échappent à une simple délégation et donc à une récupération de la
part du Parlement.
Pierre Rosanvallon a interrogé cette semaine plusieurs formes de
lexercice de cette surveillance, celles produites notamment par de nouveaux
militantismes qui sélèvent contre les abus de pouvoir et interpellent le
gouvernement, on peut penser par exemple à lObservatoire sur les prisons,
certaines de ces formes très efficaces remontent parfois historiquement bien
avant le suffrage universel.
Ce matin, Pierre Rosanvallon se propose de penser les conditions
qui rendraient possible linstitutionnalisation dorganes de contrôle du
pouvoir. »
Puis, Pierre
Rosanvallon commence :
« Dans lAthènes de lâge classique, on le sait, cest
essentiellement le tirage au sort des magistratures, beaucoup plus fréquemment
que lélection, qui est considéré comme le propre de la démocratie.
La première procédure, le tirage au sort, est en effet regardée
comme la plus radicalement égalitaire puisquelle présuppose que tous
les citoyens ont une capacité équivalente dexercer les charges publiques. Ce
point a été très largement documenté et discuté par les historiens. On peut se
reporter à louvrage classique sur la démocratie athénienne de Hansen,
ainsi que pour faire le lien avec les travaux de sciences politiques, à
louvrage de Bernard Manin publié en 1995 "Principes du gouvernement
représentatif" qui a eu pour mérite important de redonner toute
son importance à cette procédure du tirage au sort.
Mais si on a parlé du tirage au sort, on
a par contre, oublié ce qui était pour les contemporains, un autre caractéristique,
toute aussi essentielle, de la démocratie. Cette autre caractéristique, cest linstitution
de procédures systématiques de contrôle de laction de ceux qui exerçaient une
fonction publique ou de ceux qui géraient des fonds publics.
Dans son enquête, Hérodote est le premier à souligner cette
dimension. "Dans un régime populaire, écrit-il, le sort distribue les
charges, le magistrat rend compte de ses actes, toute décision y est portée
devant le public." La reddition de comptes en fin de mandat était
la forme principale de ce type de contrôle. Même sil se démarque des
prudences aristocratiques et, pourrait-on dire, presque technocratiques de
Platon, concernant la nomination des gouvernants, ce nest significativement
pas sur ce dernier point quAristote met laccent pour appréhender la
définition de la démocratie : la surveillance étroite des magistrats
par les citoyens est, pour Aristote, lélément clef de la démocratie.
Si la politique propose des approches différentes de la démocratie,
et si Aristote semble parfois lui-même hésiter dans sa définition du bon
régime, ce principe du contrôle populaire reste toujours affirmé avec force
chez lui.
Même dans les cas où il ne confie au citoyen que des pouvoirs restreints,
Aristote ne limite jamais leur pouvoir dinspection sur les magistrats. Cest
ce pouvoir qui constitue, en fin de compte, le véritable pivot des différentes
catégories de constitutions mixtes quil appelle de ses vux.
Si la démocratie est au premier chef le règne de lisonomie [égalité devant
la loi (ÉC)], la souveraineté des citoyens dérive ainsi de leurs qualités
(
) de redresseur et de surveillant. Je mappuie là sur un ouvrage
récent publié chez Droz (?) de Pierre Fröhlich : "les cités
grecques et le contrôle des magistrats du 4ème au premier siècle
avant JC" qui présente létat le plus avancé de la recherche sur ces
modalité de redressement et de surveillance, cet ouvrage ayant en outre lavantage
considérable de ne pas simplement se fonder sur une étude du cas athénien, mais
davoir pris en compte dans son investigation lensemble des matériaux
épigraphiques concernant les autres cités grecques, ce qui est très rarement le
cas dans la plupart des travaux sur la Grèce antique qui se cantonnent le plus
souvent à Athènes et en outre, à Athènes de lâge classique.
Il y a bien des façons denvisager en Grèce les modalités de ce
contrôle. Dans lAthènes classique dont parle Aristote, il y a même
plusieurs catégories de magistrats, qui sont tirés au sort, chargés de
contrôler les agents, eux-mêmes tirés au sort ou parfois élus, de lexécutif.
Sont ainsi distingués les "redresseurs", (
) les
auditeurs de comptes (
), les contrôleurs (
) ou encore les avocats publics
(
).
La plupart des autres cités grecques connaîtront aussi, jusquà la
fin de la période hellénistique, des mécanismes équivalents, quil sagisse de reddition
de comptes en fin de mandat ou de contrôle des magistrats en cours de
charge.
Les modalités de ces procédures et la
part prise par les citoyens ordinaires dans leur mise en uvre ont constitué le
meilleur indicateur du degré de démocratie des différentes cités, et cest
leur affaiblissement, puis leur disparition, qui marquera de la façon la plus
tangible le déclin de la démocratie.
Cette vision originaire du peuple
surveillant permet également de comprendre pourquoi le mode de sélection
des magistrats par tirage au sort avait pu aussi facilement simposer. Si les
gouvernants ne sont que de simples exécutants, soumis à des contrôles aussi
stricts que réguliers, leurs qualités personnelles peuvent en effet être
considérées comme des variables relativement secondaires.
Lexistence dun bon gouvernement ne dépend pas seulement de leur
vertu ou de leur talent : cest lefficacité des procédure de surveillance
qui doit jouer le rôle moteur.
Il y a ainsi un système qui allie une légitimation faible par le
tirage au sort et un pouvoir fort de surveillance.
Légitimation faible par le tirage au sort et pouvoir fort de
surveillance ont composé à Athènes un dispositif institutionnel cohérent, de la
même façon que dans dautres cités.
On pourrait paraphraser sur ce point Adam Smith en disant que ce
nest pas de la bienveillance et de la vertu du gouvernement que les grecs
attendaient la réalisation du bien commun, mais plutôt de lintérêt des
gouvernants à ne pas être redressés, les sanctions pouvant être très lourdes,
parfois même la mort.
On ne dispose pas déléments pour apprécier comment sest
précisément forgée cette vision liant légitimation faible par le tirage au sort
et pouvoir fort de surveillance, mais il nest pas déraisonnable destimer que cest
lexpérience historique de lexposition des régimes politiques aux phénomènes
de corruption qui a progressivement conduit à faire de la mise à lépreuve de
la responsabilité des gouvernants linstrument dintervention le plus efficace.
Il semble dailleurs bien que ce soit lopinion dAristote :
lorsquil critique la corruptibilité des gérontes de Sparte, il impute
ainsi essentiellement le phénomène à labsence de contrôle de ses magistrats.
« il est notoire, écrit-il ainsi, que ceux qui détiennent
collectivement cette charge se laissent corrompre pas des cadeaux et sacrifient
au favoritisme dans bien des affaires communes. Cest pourquoi, conclut-il, il
aurait mieux valu quils ne soient pas irresponsables, or ils le sont
actuellement. »
Dans cette perspective, cest
donc le contrôle citoyen, bien plus que la simple désignation populaire des dirigeants
qui définit la démocratie. Mais cette dualité est progressivement devenue illisible
à nos yeux modernes tant lélection a fini par simposer comme une sorte
dinstitution démocratique totale, censée superposer une technique de
sélection des gouvernants, un mode dorganisation de la confiance
entre les citoyens et le pouvoir, en même temps quun système de régulation
de laction publique.
Il est décisif, à mes yeux, de bien
prendre la mesure de ce fait pour réinterpréter lhistoire de la
démocratie et comprendre aussi de cette façon les racines les plus
profondes du malaise contemporain.
Le regard du XVIIIè sur Athènes nétait pas le nôtre. La centralité
de la question des pouvoirs de surveillance à Athènes restait alors fortement
perçue. Lépoque, on le sait, est nourrie par la lecture de Plutarque et les
institution de lantiquité sont familières pour tous ceux qui fréquentent alors
un collège.
La référence aux censeurs romains et aux éphores de Sparte se
trouve ainsi sous toutes les plumes : Montesquieu fait grand cas de
ces "éphoroi" [prononcer éphoroye, ÉC], cest-à-dire étymologiquement de ceux
qui regardent, ceux qui observent, ceux qui surveillent, les pouvoirs en place.
Rousseau apprécie aussi leur rôle et consacre un chapitre entier du "Contrat
social" aux censeurs romains qui étaient chargés de contrôler les comptes
publics et qui jouissaient dune certaine juridiction propre dans les affaires
judiciaires.
Des auteurs très importants de lépoque, comme Delolme, le grand
historien de la Constitution britannique, ou Filangieri, le grand
juriste italien, soulignent aussi limportance dun pouvoir censorial.
Lencyclopédie,
de Diderot et dAlembert, consacre de son côté des articles informés à ces
institutions chargées, selon son expression, de "contrebalancer les
autorités gouvernantes".
Tous ces auteurs appellent à la fois de
leurs vux le développement dinstitutions représentatives et linstauration de
pouvoirs de surveillance inspirés de ces modèles anciens.
La perspective de la mise en uvre de contrepouvoirs de cette
nature est alors, il est vrai, libérale autant que démocratique.
Elle est dessence libérale car elle
conduit à encadrer laction des gouvernements suspectés de tendre naturellement
au despotisme. Cest ce qui a fait dire à Montesquieu, je lai déjà cité
en exprimant lesprit de lépoque, que : "tout homme qui a du
pouvoir est porté à en abuser, et quil va jusquà ce quil trouve des limites.
Et donc, pour quon ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la
disposition des choses, écrit-il, le pouvoir arrête le pouvoir."
Si le pouvoir du Monarque est visé, lauteur de "Lesprit des
lois" se préoccupe aussi de canaliser les débordements dun éventuel
pouvoir populaire : il se félicite ainsi que les éphores aient
été capables à Sparte de "mortifier, je le cite, les faiblesses
des rois mais aussi celles des grands et celles du peuple."
Cette approche libérale de la surveillance se retrouve aussi bien
en Angleterre, on la retrouve formulée tout au long du XVIIIè siècle, et un des
grands esprits de lépoque, une des grandes voix républicaines de lépoque, je
veux parler de Tranchard et de Thomas Gordon qui écrivent dans lIndependant
Wigg (?), font de lexercice de surveillance et dune censure
protectrice la raison dêtre essentielle de la liberté.
Mais cette surveillance est parallèlement bien appréhendée par
dautres comme étant dessence franchement démocratique, conduisant à
étendre les modalités de lintervention populaire. Cest la conception dun
Rousseau. Mais cest aussi celle dun Richard Price qui en parle avec
des accents empruntés au genevois autant quà Montesquieu : voir ses
observations sur la nature de la liberté civile de 1776.
"Le sommeil dans un État, dit-il, est
toujours suivi par lesclavage."
La liberté implique donc que les citoyens restent
éveillés en permanence.
Mais avec ces auteurs, nous en sommes resté à des considérations
générales sur lutilité ou limportance de pouvoirs de surveillance.
Cela va être surtout ladoption dune Constitution, celle de
Pennsylvanie, en 1776, qui va donner un corps sensible, qui va donner un
visage organisé, à ce pouvoir de surveillance.
Cette Constitution de Pennsylvanie, elle a joué un rôle
intellectuel extrêmement important dans toute lEurope. Ce texte avait alors
été reconnu, en effet, comme établissant le régime le plus démocratique de
toutes les provinces américaines. Un certain nombre de ses modalités
méritent, à cet égard dêtre rappelées : il y a une assemblée unique, il y
a un droit de suffrage qui est accordé à tous ceux qui payaient un impôt, quel
quen soit le montant, il y même un système de rotation qui est organisé pour
les membres de la Chambre des Représentants.
On a donc, avec toutes ces mesures, tout un ensemble de textes qui
vont même beaucoup plus loin que ce que définira la Constitution de
Philadelphie, et qui va beaucoup plus loin que ce que prévoira, en France,
la Constitution de 1791.
Mais la disposition la plus singulière, et la plus remarquée à
lépoque, de cette Constitution résidait dans son article 47 : cet article
47 mettait en place un Conseil des Censeurs. Ce Conseil était composé
délus populaires, choisis dans les différentes villes et comtés, et il
était chargé de vérifier que les pouvoirs exécutifs et législatifs remplissaient
correctement ou non leurs fonction de gardiens du peuple.
Larticle 47 note : "le Conseil des censeurs doit être
le gardien des intérêts du peuple."
Ce Conseil des Censeurs avait pour
caractéristique de délibérer en public, et il avait autorité pour faire des
remontrances au Gouvernement. Il pouvait engager des poursuites judiciaires,
renvoyer les agents jugés fautifs, recommander labrogation de lois qui étaient
jugées contraires à la Constitution.
Il pouvait même décider de convoquer une
Convention pour modifier, voire pour établir une nouvelle Constitution.
Les Américains de lépoque avaient été abreuvés, comme les
Européens, de références à Rome, à Sparte et à Athènes. Les "Roman
antiquities" de Kenneth étaient alors lues dans lAmérique du
nord-est dans tous les collèges. Éditorialiste et pamphlétaires, peut-être
encore plus volontiers en Amérique quen Europe, étaient alors fiers de signer Cato,
Cassandra ou Spartacus.
Mais ces américains, férus dantiquité,
et peut-être encore plus que les Européens, étaient, eux, passés à lacte,
avec la Constitution de Pennsylvanie.
Il faut signaler, en outre, que lÉtat du Vermont adoptera peu
après un Conseil des Censeurs de même nature.
Avec laide de Benjamin Franklin, le duc de La Rochefoucauld
traduira en français le texte de la Constitution dès le début de 1777.
Lencyclopédie méthodique lui consacrera immédiatement un très long
article.
Brissot rédigera de son côté un ouvrage quasi militant sur le code
pennsylvanien. Ses réflexions sur le code de Pennsylvanie se trouvent dans "la
bibliothèque philosophique du législateur, du politique et du
jurisconsulte" quil fait publier à Berlin en 1783. Dans ce texte, qui
a joué un rôle très important dans la prérévolution française, il approuve
chaleureusement la constitution du Conseil des Censeurs.
Condorcet, Mably (qui consacrera un ouvrage consacré à lAmérique), Mirabeau
et Turgot prendront de leur côté également la plume pour en commenter et en
discuter longuement la fonction.
La mise en uvre du principe représentatif et la perspective dune
institutionnalisation de la surveillance sont alors bien également célébrés.
Moins de vingt ans plus tard, des projets
dinstitutionnalisation dune telle fonction de surveillance des gouvernants
seront formulés dans les débats constitutionnels français. On trouve ainsi
dès 1791 plusieurs propositions de cette nature élaborées dans les milieux du
Cercle social ou du Club des Cordeliers. Lavicomterie va
ainsi consacrer un long chapitre de son ouvrage programmatique, "Du
peuple et des rois", à exposer lutilité de la création dun groupe
de Censeurs.
Dans "La Bouche
de fer", Bonneville suggère de son côté de faire élire dans
les départements 12 tribuns du peuple chargés de surveiller les pouvoirs
publics. Il est également question, dans la même publication, dun projet
détablissement dun projet dune "Censure nationale".
Rappelons dailleurs
que le nom de cette publication influente, "La Bouche de fer",
est directement emprunté à lancien exemple vénitien dune bouche de pierre
dans laquelle les citoyens pouvaient glisser un billet indiquant leurs
dénonciations ou leurs récriminations à légard des pouvoirs.
Au printemps 1793, les
idées de censorat, ou déphorat, reviennent en force dans la masse des projets
constitutionnels qui sont discutés à la Convention. On y parle dinstaurer une
surveillance du souverain harmoniquement organisée, cest une proposition de
Daunou ; une adresse des citoyens de la Section de LUnité à Paris
invite à créer un Tribunal dÉphores ; on voit de son côté la
demande faite par Poultier de mise en place dun "Orateur du
Peuple", qui serait chargé de "dénoncer les négligences,
écrit-il, les omissions, les infidélités, les intrigues des gouvernants" ;
Prunelle de Lierre appelle à ériger un Tribunal de cette conscience du
peuple ; dautres appellent de leurs vux un Jury national qui ferait face
à la représentation et qui aurait pour objet, cest une formule de Hérault de Séchelle,
de "venger le citoyen opprimé dans sa personne des vexations du Corps
Législatif et du Conseil Exécutif."
En même temps, pour Hérault de Séchelle, que serait ainsi
mis en place un pouvoir élu et représentatif, serait parallèlement mise en
place une instance chargée de venger le citoyen du mal que pourrait commettre
ce même pouvoir élu.
On parle encore de
"troisième pouvoir régulateur", de Collège dÉphores, de Tribunal des
Censeurs.
Les volumes 63 à 67 des
archives parlementaires, les cinq volumes des archives parlementaires qui sont
consacrés à cette période du début de 1793 et des débats constitutionnels de
cette période, sont remplis de brochures reproduisant des propositions de cette
nature.
Limagination de
conventionnels, on le voit, est particulièrement fertile en la matière :
sous des appellations aussi diverses, et selon des modalités fort variables, il
y a une
même préoccupation dinstitutionnaliser une fonction de vigilance sociale et
comprendre la souveraineté comme larticulation dynamique et éventuellement
conflictuelle dun pouvoir représentatif et dun pouvoir de surveillance,
tous deux ayant une même origine populaire.
Fait significatif, des
projets similaires seront à nouveau formulés en France, sous la plume de Daunou
ou de Cabanis, je vais y revenir. Et à la même époque, au moment de la formation
des fameuses "Républiques surs", on en trouvera encore nettement la
place.
Dans la République
parthénopéenne qui est, vous le savez, le nom que la République que les
Français avaient mise en place à Naples et qui aura six mois dexistence, de
janvier à juin 1799, cette question sera au centre du débat constitutionnel
interrompu par les combats militaires. Et le grand juriste napolitain de
lépoque, Mario Pagano, qui est un disciple de Filangieri, proposera lui aussi
linstitution de cette surveillance dans la Constitution.
La France de lan VIII,
on le sait, en portera la marque, je vais y revenir tout de suite, avec
linstitution du Tribunat. Mais cette institution du Tribunat fera long feu.
Quant aux Constitutions
de Pennsylvanie et du Vermont, elles seront révisées et leur Conseil de
Censeurs sera ultérieurement supprimé.
Si lon se tourne du
côté de la Grande Bretagne, le débat ny a même pas été engagé dans ces termes.
Il faut donc à la fois
comprendre ces échecs, en France, aux États-Unis, et cette absence en Grande
Bretagne. Comprendre donc pourquoi linstitutionnalisation des pouvoirs de
surveillance sest révélée impossible après avoir été si ardemment désirée et
même si précisément préparée.
Commençons par
lexpérience Pennsylvanienne : mis en place en 1776, le Conseil des
Censeurs de Pennsylvanie se réunit pour la première fois en 1783. Il était en
effet prévu quil tienne tous les sept ans une très longue session. Mais il ny
aura pas ensuite dautres réunions. Une nouvelle Constitution, adoptée peu de
temps après, en 1790, le supprimant.
Comment comprendre
cette suppression du Conseil des Censeurs en Pennsylvanie ?
Il y a certes des
motifs que lon pourrait qualifier de directement politiques à cet
effacement : les sentiments révolutionnaires de la période de
lindépendance étaient en effet largement émoussés. Lors du processus de
ratification de la Convention fédérale, à lhiver 1787-1788, la Convention rassemblée
dans lÉtat de Pennsylvanie avait dailleurs rallié le point de vue des
fédéralistes modérés. Poursuivant ce mouvement, le monocamérisme avait, lui
aussi, été supprimé en Pennsylvanie, suspecté, ce monocamérisme de nopposer
aucune digue à lirruption déventuelles passions populaires.
Labolition du Conseil
des Censeurs va donc sinscrire dans un contexte politique de réaction,
qui va être dominé par lexpression dun libéralisme prudentiel.
Mais on ne peut pas, me
semble-t-il, en rester à ce constat : il y a également une raison
dordre proprement institutionnel à ce retrait du projet du Conseil des
Censeurs en Pennsylvanie. Le rôle imparti au Conseil, faire exister un
contrepouvoir de type fonctionnel, avait en effet été paralysé par de nombreux
conflits internes entre radicaux et modérés.
Or, le propre dune
instance de surveillance, telle quelle était prévue par la Constitution de
Pennsylvanie, le propre de cette instance et son efficacité, présuppose une
certaine unité de linstitution, présuppose que linstitution puisse
justement exister comme pleine institution.
Mais dès lors que le
Conseil des Censeurs sétait lui-même transformé en une arène politique,
traversée par les mêmes conflits que ceux qui existaient dans la Chambre
des Représentants, dès lors quil était traversé par les mêmes conflits, sa
mission devenait illisible et, effectivement, impossible.
Doù le sentiment majoritaire en Pennsylvanie, au-delà même du
contexte politique immédiat, quil était finalement plus simple, pour
surveiller le pouvoir, de faire confiance au jeu direct des rapports opposition
majorité, plutôt que dassurer cette tâche de surveillance par des
institutions spécialisées
Que cest donc à lintérieur même du jeu politique
que se trouveraient les ressources, dune part. Et dautre part, que les
ressources de surveillance pouvaient se trouver avec le fonctionnement dune
balance interne des pouvoirs, et pour cela, on va mettre en place dans la Pennsylvanie
de cette période, un bicamérisme. Cest la raison pour laquelle aussi on va
faire confiance davantage au rôle dune Cour Constitutionnelle.
Mais, du même coup, une
certaine dimension démocratique était évacuée et lhistoire de cet échec
est pour cela exemplaire, me semble-t-il. Il montre, en effet, de façon
extrêmement précise que lidée de la
surveillance ne peut pas se confondre avec lidée dopposition, que la surveillance
est un mécanisme civique et civil, pourrait-on dire, mais quelle na
pas simplement son moteur dans la division politique. Elle doit avoir un
fondement directement fonctionnel.
Lexamen dun autre
cas, celui du Tribunat français de 1800, permet de prolonger et de
confirmer lanalyse. La Constitution de lan VIII, on le sait, reposait sur une
architecture extrêmement complexe, architecture qui tenait à la fois,
pourrait-on dire, à limagination de Sieyès et aux impatiences de Bonaparte.
Pour Sieyès, elle était
la façon de mettre enfin en ordre lensemble des réflexions qui avaient été les
siennes depuis lan II. Cette Constitution prévoyait trois assemblées : un
Sénat, un Corps Législatif et un Tribunat.
Le Sénat avait pour
fonction principale dassurer le contrôle de la constitutionnalité de lois.
Le Corps Législatif,
quant à lui, votait et les lois et le budget. Mais il ne délibérait pas et il
navait pas le droit damendement. Cétait, selon une formule célèbre de
lépoque, "un simple corps de muets qui exerçait en fait un simple
pouvoir de jugement".
Bonaparte avait, en
effet, marqué sur ce point le texte de son empreinte en donnant au Gouvernement
un pouvoir très large. Linitiative des projets de lois revenant, par exemple,
entièrement au Gouvernement.
Le Tribunat,
quant à lui, remplissait une fonction très particulière : il était dabord
chargé de discuter les projets de lois. Il y avait là la trace, pourrait-on
dire, de la vieille idée de Condorcet qui avait aussi séduit Sieyès, de distinguer assemblée délection et assemblée
de délibération ; que les deux fonctions, décision et
délibération, ne soient pas simplement séparées dans le temps, mais soient
fonctionnellement et institutionnellement distinguées.
Mais le Tribunat avait
une autre fonction que de discuter les projets de loi : il avait le
droit démettre des vux sur les initiatives à prendre.
Il pouvait en outre se
prononcer sur les abus à corriger et les améliorations à entreprendre dans
toutes les parties de ladministration publique.
Il avait également à
traiter des pétitions et il pouvait encore dénoncer les Ministres
auprès du Corps Législatif, le Corps Législatif étant, dans ce cas, chargé
de voter leur mise en accusation devant une Haute Cour.
Il avait enfin pour
fonction, ce Tribunat, de discuter les cas où la Constitution pouvait être
suspendue.
Linstitution, on le
voit, reprenait ainsi, même si cest en les édulcorant et en sen démarquant,
un certain nombre didées émises en 1791 et 1793 sur lorganisation dun
pouvoir de surveillance.
On a dailleurs, dans
les archives, dans les manuscrits de Sieyès, la trace très nette et très ferme
de cette intention. Mais on a aussi, puisque jai fait référence à la seconde
influence à la base de la rédaction de cette Constitution, celle de Bonaparte,
tout un ensemble de lettres extrêmement intéressantes de cette période de
préparation constitutionnelle, envoyées par Bonaparte ; notamment une lettre
fondamentale que Bonaparte envoie à Talleyrand le 21 septembre 1797 et dans
laquelle il parle de lutilité dune "magistrature de
surveillance". On notera, dans cette lettre fondamentale, que
Bonaparte notait juste avant de signer que Talleyrand devrait montrer cette
lettre à Sieyès pour que Sieyès réfléchisse aux propositions qui y étaient
faites.
Donc, même lhistoire
méticuleuse et technique de la préparation de cette mise en place du Tribunat
montre bien que lesprit dans lequel il a été constitué était un esprit très
largement hérité des dispositifs qui avaient été imaginés dans la période
précédente.
La dénomination de
"Tribunat" faisait dailleurs elle-même directement écho à ces
projets antérieurs inspirés par le monde antique, et notamment à linstitution
particulièrement distinguée par Rousseau dans "Le contrat social".
Elle avcait aussi, pour
lépoque, une connotation démocratique en renvoyant à limage de ces Tribuns du
Peuple dont le rôle avait été si souvent exalté depuis 1789. "Le Tribun du
Peuple", cest dailleurs le titre quavaient pris successivement les
journaux prestigieux et novateurs de Bonneville et de Babeuf.
Mais, là encore,
lexpérience avorte. Pourquoi lexpérience du Tribunat français a-t-elle
avorté ?
Il y a, là encore, des motifs
politiques et historiques évidents. Lavènement du premier Empire et, dès lan
X, linstauration du Consulat à vie, qui modifiait donc complètement la notion
même de Constitution telle quelle avait été prévue.
Mais léchec du
Tribunat est déjà lisible bien avant lan X : il est déjà, pourrait-on
dire, consacré avant même de succomber aux appétits du Premier Consul. Léchec
du tribunat sexplique en effet, dabord, par la difficulté de linstitution à
trouver son assise et son bon registre de fonctionnement. Les interrogations et
les débats qui ont été suscités dès la tenue de la première session du Tribunat
permettent de prendre la mesure de la question :
La Constitution était à
peine votée, et on sait que Bonaparte avait tenu à ce quun plébiscite soit
organisé, que le Général Consul avait
résolu de museler lassemblée : il avait tout de suite redouté quelle ne
se transforme mécaniquement en une sorte de foyer dopposition organisée.
Et le premier projet de
loi quil fera porter devant le Tribunat propose ainsi, immédiatement après son
installation, pourrait-on dire, une réforme de la formation de la loi qui
revenait à encadrer de façon si contraignante les termes et les délais de la
délibération quil mentionnait expressément que lassemblée était censée avoir
donné son consentement même si elle ne sétait pas exprimée car elle était
censée le faire au jour indiqué par le Gouvernement. Cétait la
proposition de loi de Bonaparte : lassemblée doit se prononcer au jour
indiqué par le Gouvernement, cest-à-dire généralement laprès-midi pour le
lendemain matin.
Cétait rendre, de
fait, le Gouvernement maître de réduire le débat à une simple lecture, annulant
matériellement tout véritable examen.
Mais ce coup de force
initial, pourrait-on dire, de Bonaparte a été loccasion dune réflexion
extrêmement intéressante sur la nature de linstitution : articles et
discours se sont multipliés alors pour en discuter lesprit et le
fonctionnement.
La question décisive soulevée par Bonaparte était celle du
rapport entre sa fonction de surveillance et lidée dopposition. Nous
voyons que nous retrouvons la question qui était déjà celle du Conseil des
Censeurs en Pennsylvanie. Bonaparte accusait linstitution, en effet, de tendre
à être un foyer dopposition beaucoup plus quune institution autonome de
surveillance.
Roederer, lancien constituant, un de ceux qui
avaient vivement approuvé le coup dÉtat du 18 brumaire, défendra lassemblée
dans un vigoureux article quil publie dans son "Journal de Paris" :
"sait-on bien, écrit Roederer, ce quest le Tribunat ? Est-il vrai
que cest lopposition organisée ? Est-il vrai quun tribun soit condamné
toujours à sopposer sans raison et sans mesure au Gouvernement ? Est-il
vrai quun tribun soit condamné à sattaquer à tout ce que fait et à tout ce
que propose ce Gouvernement ? À déclamer contre lui quand il approuve le
plus sa conduite et à le calomnier quand il na que du bien à en
dire ?" Et Roederer poursuit : "Si cétait là ce
quest le tribun, ce serait le plus vil et le plus odieux des métiers. Pour
moi, jen ai une plus noble et une plus haute idée : je regarde, dit-il,
le Tribunat comme une assemblée dhommes dÉtat chargés de contrôler, de
réviser, dépurer, de perfectionner louvrage du Conseil dÉtat et de concourir
avec lui au bonheur public. Un vrai Conseiller dÉtat, écrit Roederer,
est un tribun placé près de lautorité suprême. Le vrai tribun est un
Conseiller dÉtat placé au milieu du peuple."
Pour Roederer, les
choses étaient donc claires : lexercice fonctionnel dune activité
de surveillance ne pouvait pas être assimilé à la manifestation de nature plus politique
dune opposition organisée au pouvoir. Les deux étaient franchement dissociés.
Et si Roederer pose la
distinction, il ne la construit pas.
Benjamin Constant, qui est membre de cette première
assemblée, de ce Tribunat, va aussi intervenir dans le débat : il va
prononcer devant le Tribunat un important discours sur ce thème. Ces discours
au Tribunat de Benjamin Constant viennent dêtre édités dans "les
uvres complètes" qui sont publiées par Max Nimeyeur Werlag (?) en
Allemagne. Lensemble de ce recueil constitue un ensemble de textes qui étaient
jusquà maintenant là peu connus, disponibles simplement par la lecture dans Le
Moniteur Universel, et qui enrichissent considérablement la compréhension de
luvre de Benjamin Constant, que ce soit en termes constitutionnels ou même en
termes économiques.
Il participe à de très
nombreuses discussions déconomie politique au Tribunat et quil y a là une
contribution de premier plan à la compréhension dun Benjamin Constant,
pourrait-on dire, doublement libéral : politiquement et économiquement.
Benjamin Constant, sans
ce premier grand discours au Tribunat, se défend, lui aussi, de considérer le
Tribunat comme un corps dopposition permanente. Il reconnaît que si le
Tribunat était un corps dopposition, cela reviendrait à le priver de son
crédit et de son influence.
Mais il est frappant de
constater que le jeune publiciste, qui commence alors à se faire un nom à la
mesure de lhostilité que lui voue rapidement le Premier Consul, échoue, comme
Roederer, à élaborer intellectuellement la différence entre opposition
politique et contrôle constitutionnel qui est sous-jacente à la
fonction même du Tribunat.
Benjamin Constant
multiplie ainsi dans son intervention les dénégations, il multiplie les
précautions : "lopposition est sans force alors quelle est sans
discernement" dit-il. "Le Tribunat, insiste-t-il par
ailleurs, nest point une assemblée de rhéteurs, il na pas pour occupation
une occupation de tribune." Et Benjamin Constant repousse vivement
lidée dune opposition perpétuelle et sans distinction dobjet.
Mais lui aussi peine à
définir positivement les ressorts de cette fonction : il se contente den
appeler, en des termes platement moraux, à la ténacité courageuse ou à
sa nécessaire indépendance.
Le problème vient du
fait que Constant est incapable dinscrire la notion de pouvoir de contrôle
dans une architecture démocratique.
Or, me semble-t-il, ce nest que dans une perspective de cette
nature quun tel pouvoir peut être pensé : en étant inscrit dans la visée
dune double souveraineté du peuple.
Il y donc là, chez
Constant, un point aveugle : il ne distingue pas entre les potentialités
démocratiques du Tribunat : accroître le pouvoir social en réduisant
lentropie représentative, et son usage libéral : préserver des
errements du Gouvernement. Il nest donc pas surprenant que le complice de
madame de Staël ait ultérieurement abandonné la référence à cette institution
qui était marquée par une indétermination de cette nature.
Benjamin Constant se
fera ensuite, beaucoup plus restrictivement, le théoricien dun pouvoir
neutre à la fonction clairement et exclusivement libérale. Ce pouvoir
neutre, encore qualifié par lui de troisième pouvoir entre le législatif
et lexécutif, ou qualifié de pouvoir préservateur, présentera, de fait,
pour lessentiel, les seuls attributs dune Cour Constitutionnelle.
Cette incapacité de
Constant à théoriser démocratiquement ce pouvoir aura pour pendant les
attaques, elles théoriques, de Bonaparte. Bonaparte dira rapidement : "à
quoi sert un corps de cent membres pour sonner le tocsin quand le Gouvernement
a été élu ?" Il ira jusquà dire : "conçoit-on une
opposition du Peuple souverain contre lui-même ? Conçoit-on des tribuns là
où il ny a pas de patriciens ? Donc, la fonction de surveillance, dit
Bonaparte, nest pas utile, dès lors que le régime est véritablement
démocratique. La fonction de surveillance nest pas utile dès lors quil
y a une unité du Gouvernement fondé sur lélection."
Si une page décisive
est tournée en France avec léchec du Tribunat à faire vivre un pouvoir de
surveillance, lidée est cependant loin dêtre abandonnée : elle va
être reprise avec insistance dans les milieux républicains radicaux des années
1830.
La Société des
Droits de lHomme et du Citoyen souligne ainsi, dans lexposé de ses
principes, que le plein exercice de la souveraineté du peuple requiert la
mise en place dun Conseil permanent denquête et damélioration qui aurait
notamment pour fonction la révision des institutions publiques.
La Tribune des
Départements, le journal montagnard de lépoque qui se réclame de
lhéritage de Robespierre, fait une suggestion analogue.
Des figures importantes
du socialisme naissant, comme Buchez ou comme Charles Teste, conçoivent aussi un
organe de contrôle et de proposition distinct des assemblées représentatives.
Dans son programme
démocratique de 1840, Charles François Chevais (?), un socialiste chrétien,
disons, pour faire vite, va détailler longuement les tâches qui pourraient être
dévolues sur cette base à un Comité de perfectionnement et denquête
qui, lui aussi, aurait une fonction de surveillance permanente.
On trouvera encore, en 1848, la trace de projets dune inspiration
voisine. Le socialiste Pierre Leroux suggère par exemple,
dinstitutionnaliser un Jury National de 300 citoyens, tirés au sort
dans les départements, qui auraient pour rôle de surveiller en
permanence et de juger la représentation nationale, complétant sur un
mode spécifique les fonctions dévolues à la presse pour la surveillance,
et aux élections pour le jugement de laction du pouvoir.
Un important publiciste républicain de lépoque, Billiard (?), propose
de son côté lorganisation de ce quil appelle une Inspection, élue au
suffrage universel, inspection qui aurait pour fonction davoir "les
yeux ouverts sur tout ce qui se fait et de veiller à ce que tout se fasse".
Le but est, là encore,
chez Billiard, de permettre lexercice dune surveillance continuelle,
surveillance jugée indispensable au régime républicain.
Dans son ouvrage très
important, "De lorganisation de la République", qui est
publié en 1848, il va ainsi rapprocher cette idée dinspection de celle de Ministère
Public. Le Ministère Public, on le sait, cest le corps des magistrats qui
est chargé de représenter lÉtat et les intérêts généraux de la société. Et
bien lInspection, cette Inspection générale, tirée au sort, serait, de
la même façon, chargée de représenter les intérêts généraux de la société,
face à la représentation élue.
Ces divers projets
montrent que la réflexion sur linstitutionnalisation dune forme de pouvoir de
surveillance est toujours présente en France dans la première moitié du XIXème
siècle, mais aucune ne sera vraiment sérieusement prise en compte au moment
décisif de la rédaction et du vote de la Constitution de 1848.
Monisme jacobin et
prudence libérale ou conservatrice se sont ainsi, de fait, alliés à partir de
1848 pour repousser les perspectives dune surveillance activement
démocratique. »
Vous pouvez réagir à ce texte ici :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/26/34-evolution-necessaire-de-notre-democratie-importance-cardinale-des-pouvoirs-de-surveillance
Je trouve cet historien
passionnant. Je suis en train de lire « le sacre du citoyen » (Folio
Histoire), mais il a aussi écrit un autre livre au titre alléchant, « la démocratie
inachevée » (NRF, Gallimard), que je vais commander et
dont je vous parlerai bientôt (voir ici un résumé).
Nota : jai
retranscrit une partie dun autre cours, "Les mises à lépreuve dun jugement",
sur ma page Liens et docs : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/05/08/39-mises-a-lepreuve-dun-jugement
Le 29 mai 2005, nous avons pu dire non au TCE parce que notre
"roi républicain" a bien voulu nous demander notre accord.
Or cest très exceptionnel et non reproductible
et, à mon avis, on ne reprendra pas de sitôt nos "représentants" à
nous demander notre avis sur quoi que ce soit : le droit dexpression
daccord, les élections sans doute, mais seulement si nous consentons à suivre
nos maîtres
Le CNE et le CPE sont, pour la France,
à leur tour, des révélateurs dune dérive tyrannique : nous
sommes à lévidence prisonniers de notre gouvernement qui, grâce à une
scandaleuse Constitution et à une propagande bien rôdée, peut fort bien marcher
sur la tête des parlementaires et de son propre peuple sans encourir la moindre
sanction.
Si vous regrettez votre impuissance chronique, haïssez cette
Constitution de 1958 qui nous prive du référendum
dinitiative populaire (RIP), protection décisive contre les abus de pouvoir et
déduction honnête du droit des peuples à disposer deux-mêmes.
Il ne tient quà nous de changer de régime et de bâtir nous-mêmes
notre Constitution capable de protéger tous les citoyens, quils soient
de gauche comme de droite ou du centre, riches ou pauvres, propriétaires ou
pas.
Mettons fin à notre servitude volontaire et passons enfin,
ensemble, de la 5ème République à la 1ère Démocratie.
Commentaires
là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/05/33-prisonniers-du-gouvernement.
Bonnes nouvelles
(1er avril 2006)
Bonjour. Bonnes
nouvelles !
Un lien étonnant
: www.european.research.utopia.dream.center.org. En substance :
La Commission
Européenne vient de publier une intéressante proposition de directive adoptant
quelques correctifs de détail au TCE pour faire droit aux revendications
émergentes des peuples européens, avant une nouvelle consultation populaire,
directe cette fois, dans tous les pays concernés :
Parmi les
nouveautés inscrites dans l'addendum au "traité constitutionnel",
l'annexe 311 du protocole 57-D, page 2133, on note que c'est désormais très classiquement
le Parlement qui a l'exclusivité à la fois de l'initiative, de la discussion et
du vote des lois, que le Conseil et la commission redeviennent un exécutif qui
se borne à exécuter et n'ont plus aucun pouvoir de création de normes autres
que rigoureusement subordonnées aux lois véritables (issues, elles, du seul
Parlement), que le Parlement européen est élu avec un scrutin majoritaire pour
l'essentiel et à la proportionnelle pour le reste (pour que tous les partis
soient représentés au PE), que le vote blanc est constitutionnellement reconnu
en tant que vote protestataire capable de récuser dun coup tous les candidats
à un scrutin sil est majoritaire, que le Président de l'Europe, élu lui aussi
au suffrage universel direct, est obligatoirement tantôt un homme tantôt une
femme, que l'on commencera par une femme, que le Président de l'Europe nomme un
Premier ministre en fonction de la couleur politique du Parlement, que ce
Premier ministre nomme les membres d'un Conseil des ministres, appelés ministres
européens, et qu'il présente son programme au Parlement qui peut le désavouer,
de la même manière qu'il peut censurer un Conseil des Ministres (gouvernement)
à la majorité simple, que le Conseil Européen (le club des chefs d'État
nationaux) est supprimé, que les ministres des États nationaux restent chez
eux, les chefs d'État aussi, que le Parlement européen peut exiger à tout moment
que les ministres européens lui rendent des comptes publiquement, qu'un
ministre européen qui refuserait de rendre des comptes peut être révoqué par le
Parlement, que toutes les délibérations des Conseils sont publiques, filmées et
publiées en continu sur les sous-canaux de la chaîne TV gratuite de l'Europe,
que les "ONG, acteurs de la société civile" (les lobbies)
peuvent parfaitement formuler des "recommandations" aux
parlementaires et aux commissaires à la stricte condition de publier tous ces
"conseils" sur le net sous peine de dissolution des personnes
morales contrevenantes, confiscation de leurs biens et de prison+amende pour
leurs dirigeants, que le huis clos en matière de création de normes
contraignantes est déclaré anticonstitutionnel, que les missions de la banque
centrale sont fixées tous les ans par le Parlement, en accord avec le
gouvernement, qu'un Conseil constitutionnel est mis en place, arbitre suprême
mais lui-même révocable car aucun pouvoir n'est absolument protégé des
contrôles, que le parapente devient enfin une discipline olympique, et les
reportages sur les compétitions et sur les histoires d'aventures de vol libre
doivent impérativement passer à la télé aux heures de grande écoute, à la place
de "radio-fais-moi-peur" ou
"fais-donc-pas-de-politique-regarde-plutôt-le-beau-ballon", quune
tranche horaire nommée « politique citoyenne » est banalisée
constitutionnellement entre 19 h 30 et 20 h sur toutes les chaînes radio et
télé européennes sans exception pour permettre une authentique et libre
expression citoyenne (droit de parole de 15 minutes par personne physique, 30
min. pour les débats, attribué par tirage au sort public sur des listes de
volontaires), que les 830 dernières pages des traités sur l'UE (Nice,
Amsterdam, etc.) sont abrogées au profit d'un feuillet de 5 pages, écrit gros
pour respecter l'arrivée du papy boom, et
dont tous les mots savants ont été retirés pour que tous puissent le
comprendre, qu'un référendum d'initiative populaire véritable est mis en place
très simplement : 500 000 citoyens peuvent exiger (en passant par un
site Internet sécurisé) qu'un référendum soit organisé par tous les États (qui
ne peuvent s'y soustraire sous aucun prétexte : tous les référendums
dorigine citoyenne sont regroupés sur un seul et même jour de lannée, déclaré
"jour de fête des citoyens européens", férié et chômé), sans
aucune limitation de thème ou de sujet, et si le référendum est accepté à la
majorité des suffrages européens exprimés, le texte du référendum, issu
directement de la volonté du peuple, s'impose à toute autre norme, nationale ou
internationale, qu'un tel référendum peut destituer n'importe quelle instance
du pouvoir, qu'aucune n'est à l'abri du contrôle des peuples, que la
Constitution impose que les organes de calculs statistiques (INSEE et
équivalents) et de sondages sont obligatoirement indépendants des pouvoirs
politiques et économiques, comme tous les médias dinformation, et que cette
indépendance est contrôlée publiquement et collégialement, que le Président de
l'Europe peut dissoudre le Parlement et que des élections ont lieu aussitôt
pour que le peuple joue son rôle d'arbitre entre les pouvoirs, que finalement
cest la partie I qui était, de loin, la plus dangereuse en instituant une extravagante
irresponsabilité de tous les acteurs politiques, que les grands principes
rappelés dans la partie II, au lieu d'être conditionnés et subordonnés à tous
les autres, sont déclarés supérieurs et impératifs, d'application immédiate
dans tous les pays qui s'engagent donc à faire progresser leur droit
systématiquement vers le haut c'est-à-dire vers plus de protection et de
respect des individus, au détriment des personnes morales (dont la taille est
rigoureusement limitée), que l'OMC, dont il est avéré qu'elle ne contraint que
les États et jamais les entreprises, devra se passer de l'Europe pour déréguler
la planète : toutes les négociations sur l'AGCS et l'ADPIC, ainsi que les
suivantes, sont obligatoirement publiées au fur et à mesure dans toutes les
langues de l'Union, ce qui les tue aussitôt puisqu'elles ne vivent que dans
l'ombre, et enfin qu'un échelon de démocratie locale est préservé de façon
constitutionnelle : ainsi, si une simple commune estime que les intérêts
supérieurs de sa population sont en danger, et si elle le décide à la majorité
des huit dixièmes, elle peut sortir de l'Union et protéger les humains qui la
composent de la course folle à la
"compétitivité-productivité-hamster-pour-quoi-faire", et que le droit
de déserter la guerre économique est ainsi constitutionnellement reconnu au
lieu d'être interdit
Ainsi rassuré, le peuple redevient
serein et peut enfin apprendre vraiment la pétanque.
Rasséréné, je peux aller voler dans les
thermiques parfumés du gai printemps
:o)
Vos commentaires et infos complémentaires : cliquez
ici.
Bonjour :o)
Je viens de reformuler ma thèse sur limportance pour les
citoyens décrire eux-mêmes leur Constitution, en tenant à lécart les hommes au pouvoir ainsi que les candidats
au pouvoir.
Cette thèse importante est en débat là : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=16.
Je lai proposée sous forme darticle à AgoraVox :
je souhaite en effet que des gens défavorables à notre conception de la
politique réappropriée par tous jusquà lécriture des règles
fondatrices, nous expliquent pourquoi, à leur avis, lidée est mauvaise. Et
le public dAgoraVox me semble à la fois varié et exigeant : nous devrions
donc trouver là de nouveaux
interlocuteurs à la fois incisifs et respectueux, pour nous stimuler
et nous inciter à progresser. Nous verrons si larticle est publié et quelles
réactions il suscite.
Si vous le pouvez, faites venir ici,
vous aussi, de nouveaux contradicteurs ou contributeurs, en sollicitant vos
forums préférés, vos listes de diffusion, vos contacts, etc. Vu le verrouillage des médias dès quon ose
les critiquer, nous navons pas dautre moyen de diffuser largement nos idées
que lInternet et le bouche à oreille. À vous de maider à donner vie à
cette liberté :o)
Cest la mise en scène des conflits
qui met le mieux en lumière les arguments en présence et permet le progrès
de tous.
Cest cette mise en scène des conflits,
cette contradiction équitable, qui manque tant à la télévision où certains
"journalistes" privilégiés (sans légitimité ni comptes à rendre à la
démocratie quils prétendent servir) nous imposent tous les jours soit une
pensée unique sans contradiction honnête, soit des émissions de divertissement,
idéales pour dépolitiser les citoyens et stériliser les résistances.
La semaine prochaine, je serai à Paris pour corriger des copies
dexamen. À cette occasion, je vais tâcher de rencontrer enfin quelques
« compagnons cybernétiques » :o)
Pendant
le débat référendaire, parce que jai tardé à répondre, Bastien François
a donné limpression à de nombreux citoyens favorables au TCE que le débat
était clos et leur cause entendue. Je trouve aujourdhui sur de nombreux sites
des débats qui sarrêtent sur cette affirmation lapidaire : « pour
la démonstration, allez voir le texte de Bastien François qui clôt le
débat »
Je démontre pourtant rigoureusement dans
ma réplique que BF se
trompe sur presque tout : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Reponse_Etienne_Chouard_a_Bastien_Francois.pdf.
Je les invite donc aujourdhui à lire enfin ma réponse qui
trouve ces temps-ci un regain dactualité avec la prétention extravagante des
politiciens de faire comme si nous navions pas dit non : VGE qui
demande une "seconde chance" au TCE, le Parlement européen où nos
soi-disant "représentants" votent quasiment à lunanimité la trahison
ouverte de leurs propres électeurs (le passage en force du TCE), etc.
Voilà qui donne de limportance et de la force aux arguments
que jai opposés à Bastien François, arguments minutieux restés depuis
sans même un début de réponse.
Le TCE et lEurope traîtreuse quil
révèle sont dangereux, juridiquement, politiquement, économiquement et
socialement. On attend toujours la démonstration du contraire.
Encore aujourdhui, cet échange darguments résume bien le
déséquilibre des affirmations juridiques en présence : les partisans du
TCE navaient et nont toujours dautres arguments que dautorité, ce qui
ninspire pas confiance.
Vous
pouvez réagir : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/03/04/30-actualite-de-ma-reponse-a-bastien-francois
Il faut écouter les auditions des acquittés dOutreau : http://www.publicsenat.fr/dossiers/dossier.asp?dossier=32
Avec ces auditions
intégrales, nous vivons sans doute une période historique :
Les juges sont
détenteurs dun immense pouvoir sur les citoyens et les contre pouvoirs des juges sont presque tous constitués ou
maîtrisés par les juges eux-mêmes, ce qui est uns vice de même nature que ceux
que nous dénonçons depuis des mois à propos des institutions politiques.
Or jamais les
juges nont été mis en accusation aussi publiquement et précisément que ces
jours-ci (malgré les nombreux scandales dénoncés par les plus grands avocats
depuis des décennies).
Ce qui se passe
est passionnant et porteur dun grand espoir : de longues auditions
parfaitement médiatisée où des parlementaires (le rapporteur est un excellent
avocat) peuvent enfin prendre longuement les juges face à face, devant tout le
monde, et régler précisément de fort vieux comptes particulièrement graves.
Tous les soirs,
au lieu de perdre mon temps à regarder les jeux du cirque à la télé, jécoute
sur Internet le témoignage dun
acquitté, dun avocat, dun juge ou dun procureur, je prends la mesure des
gouffres dinjustices que nos institutions permettent depuis longtemps, et je
prends conscience de ma part de responsabilité à être resté aussi longtemps
indifférent, moi aussi.
Je vous invite donc à partager ça, on ne perd pas son
temps : http://www.publicsenat.fr/dossiers/dossier.asp?dossier=32
Cest La Bruyère qui disait :
« La condamnation dun innocent est
laffaire de tous les honnêtes gens ».
Ceux qui contestent
laspect spectaculaire de la médiatisation nont pas compris (ou ne veulent pas
accepter) quelle est une immense opportunité pour la démocratie par
lémancipation des citoyens dun système encore trop oppressif.
Il est important
que les citoyens comprennent les rouages de leur système judiciaire pour
percevoir les enjeux et se forger une opinion éclairée : nous avons là une opportunité pédagogique inouïe.
Ces jours-ci,
nos parlementaires jouent un rôle immense.
Je lisais « Éloge de la barbarie judiciaire », de Thierry
Lévy (Odile Jacob, oct. 2004,
187 p.), avant que ne seffondre le jeune juge, et je découvrais déjà les
vices majeurs de nos institutions judiciaires que ce grand avocat, avec
dautres, pointe depuis longtemps. Résumé :
« Audience
jouée davance, poids du dossier, garde à vue renforcée, enquête viciée par la
garde à vue, experts et témoins sous influence, enquêteurs investis des
pouvoirs du juge : le procès pénal nest pas équitable. On fabrique lerreur sous les yeux dune défense
entravée.
Aujourdhui, linstitution judiciaire sest trouvée un
nouveau maître, plus aveugle, plus menaçant encore que lÉtat autoritaire. Le
plaignant aux mille récriminations, idolâtré, transfiguré en sainte victime.
Le duel des
âges barbares, arbitré entre égaux par
un juge indépendant et selon des règles acceptées, respectait bien davantage les acteurs du procès.
Ce nest pas lesprit dhumanité qui la banni de nos
lois. Cest larrogante prétention du prince à imposer à ses sujets la vérité quil
croyait détenir. Et nous nen sommes pas sortis. »
|
Plan du
livre « Éloge de la barbarie
judiciaire » :
Chapitre 1 - Les jeux sont faits
Faux
débat
Laudience
réelle nest pas laudience idéale
Le
dossier lécrase de tout son poids
Illusion
de lexpertise
La
comédie du procès
Et les
témoins ?
Un
théâtre de la cruauté
Garde à
vue
Pas de
droits pour les méchants
À quoi
sert la défense ?
Chapitre 2 - Qui sont les
barbares ?
Place à
la vengeance
Justice
et vérité
Vers la
justice dÉtat
Les
quatre piliers de lenquête
Lexclusion
progressive de la défense
La
fausse indépendance de la justice
Comment
on fabrique lerreur
Une
vérité autorisée
Que
faire ?
Chapitre 3 - Sacrées victimes
Naissance
de la victimologie
Le
culte de la victime
Dérive
Quand la
victime remplace le souverain
Dans
lombre du psychiatre
Plaignez-vous !
|
Nous sommes tous concernés, ça
narrive pas quaux autres, vraiment : il faut prendre le temps
découter intégralement les témoignages de laffaire dOutreau, cest édifiant.
Il faudra sans doute intégrer un certain nombre de ces
réflexions dans notre Constitution citoyenne.
Vous
pouvez réagir là :
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/02/10/21-il-faut-ecouter-les-auditions-des-acquittes-doutreau
Bonjour mes amis :o)
Je vous présente le nouvel outil d'échange que je vous avais annoncé
et que je prépare depuis des semaines : il est sensiblement plus puissant
pour présenter et structurer nos idées.
|
C'est un vrai forum (http://etienne.chouard.free.fr/forum/index.php),
au sens informatique, ce qui signifie que :
·
Vous pouvez modifier vous-même vos messages (pour
corriger une faute ou nuancer une pensée). Le commentaire envoyé n'est donc
plus irréversible.
·
La saisie
est plus agréable : les sauts à la ligne apparaissent comme à la saisie, sans
avoir besoin de saisir des sauts de ligne manuels avec un outil.
On a aussi plus de place à lécran pour voir le texte tapé.
·
La mise en forme est beaucoup plus
puissante : possibilité de surligner,
de barrer, de changer la couleur, la
taille, de tirer un trait, de dessiner facilement des smileys,
etc.
·
Les filtres
sont plus nombreux : possibilité de voir les réponses à vos messages, voir
les messages sans réponse, voir les derniers messages, etc.
·
Vous avez la possibilité de régler votre profil : votre signature, un
avatar (une sorte de logo :o), l'apparence du site que vous préférez, etc.
·
Vous pouvez vous abonner à une discussion, pour recevoir un mail dès qu'une nouvelle
réponse est postée.
·
Vous pouvez sauter d'un sujet à l'autre sans passer par le
sommaire (liste déroulante en bas).
·
On peut voir
tous les messages d'un auteur.
·
Laffichage des textes utilise
toute la largeur de l'écran et du papier.
·
Sur les forums ouverts, vous pouvez commencer vous-même une nouvelle discussion... Ça, ça
devrait vous plaire ;o)
Ne me
mettez pas en difficulté, s'il vous plaît, sur ces ouvertures : ne sortez pas de l'optique institutionnelle,
et respectez les autres, de droite comme de gauche : l'objectif est de nous rapprocher, pas de nous empailler.
Il me
semble que les citoyens "de gauche" et ceux "de droite"
(je crois que les différences sont moins réelles chez les électeurs quau
sein des partis, il y a beaucoup de malentendus) sont affaiblis par leur
division au moment denvisager la réflexion institutionnelle où
précisément leurs intérêts majeurs convergent et où il faudrait quils
soient nombreux.
:o)
|
Attention : sur un forum, on peut lire librement, mais il faut s'inscrire
pour avoir le droit de participer aux échanges. Souvent, les participants
s'attribuent un pseudo et donnent une adresse email créée pour l'occasion.
Je peux régler ce point et
permettre à quiconque, même non inscrit, d'écrire des commentaires, mais il me
semble préférable de nous inscrire, c'est ça qui vous permet de corriger vos
messages après-coup et de recevoir par mail des avertissements de réponse
(l'inscription est courante sur presque tous les forums). Je peux me tromper :
dites-moi ce que vous en pensez. Je voudrais éviter que de timides génies
soient éloignés par lappréhension de s'inscrire :o)
Passage du blog au
forum : nous venons
d'avoir des dizaines d'échanges, souvent très intéressants, sur un autre espace,
de type 'blog'. Comment récupérer
les messages du blog, pour que tout ce qui a été dit d'important soit,
finalement, au même endroit ?
Le plus malin, si vous en êtes
daccord, est que vous choisissiez et
transfériez vous-même, par Copier/Coller,
les messages que vous estimez importants : inscrivez-vous, puis ouvrez
le blog dans une fenêtre, ouvrez le forum
dans une autre, sélectionnez avec la souris dans une main, et copiez-collez (CTRL+C et CTRL+V) avec
l'autre main... Ça devrait aller assez vite si chacun prend
en charge ses propres messages. Si vous n'y arrivez pas, je vous aiderai.
Et surtout, ça vous permet de réorganiser et reformuler un peu
votre pensée, avec le recul des premiers échanges.
Dites-moi ce que vous en pensez
dans les commentaires de cet article.
De toutes façons, je ferme les commentaires du blog sur les grands
principes (ils resteront lisibles quelque temps), et on ne discute plus
sur les grands principes qu'avec le forum.
On garde la
partie 'blog' pour les billets du journal
et bientôt des liens.
Ça va comme ça ?
Quel boulot de mettre tout ça en place,
je perds un temps considérable en manips informatiques et, depuis le premier
janvier, je n'ai plus de temps pour lire mes précieux livres... C'est affreux.
Vivement que le forum tourne un peu tout seul ;o)
Au plaisir de vous lire :o)
« Quel sera le devenir de ces
débats ? Quelle ambition avons-nous (avez-vous Étienne) pour les résultats du
travail d'Étienne et de nos débats ? » demande Nanouche sur le blog (commentaire n° 11). Je lui
réponds ici, dans mon journal, parce que ça devrait intéresser aussi ceux qui
nont pas le temps de suivre toutes les conversations du blog.
Chère Nanouche :o)
La question de la mise en pratique
de nos idées est effectivement essentielle et difficile, mais elle nest pas insoluble.
La difficulté vient évidemment de
ce que toutes les commandes sont aux mains des professionnels de la politique
et quils ne vont pas se laisser faire : cest précisément à la fois le
problème et lobstacle à la solution du problème.
Heureusement, nos parents ont déjà
franchi deux premières "marches" vers la démocratie : la liberté
dexpression et le suffrage universel. Ces premières étapes permettent
davancer ensuite vers une meilleure démocratie, mais seulement si les citoyens
se servent de leurs outils.
On peut noter que ces "premières
marches" sont toutes les deux mises à mal en ce moment par ceux quelles
gênent (aidés en cela par notre propre négligence) :
·
La liberté dexpression est très limitée sur les thèmes
dont je parle : combien de débats contradictoires à la télévision sur le
contrôle des pouvoirs et sur la responsabilité des élus, aux heures de grande
écoute, depuis 20 ans ?
Est-ce quon nous présente souvent les
enjeux du vote blanc, du mandat impératif et du référendum dinitiative
citoyenne ?
Et surtout à qui donne-t-on la parole
si on évoque ces questions ? Aux hommes politiques de métier, ou à leurs
amis proches des médias, qui évitent, bien entendu, dévoquer honnêtement, face
à de solides contradicteurs et avec le temps nécessaire, les principes que je défends
ici.
·
Le suffrage universel, de son côté, est lui aussi
truqué, de façon à ce que nous ne puissions élire que des "notables"
sélectionnés par les appareils partisans, sans aucun moyen de sen
débarrasser : si on les désavoue en
élisant leurs adversaires, on les voit réapparaître dès le scrutin suivant.
Cest un
peu comme si la pire sanction quon puisse leur infliger était le mi-temps : une législature pour
ceux de "la droite", puis une législature pour ceux de "la
gauche" (avec des guillemets), etc.
Nous navons aucun moyen de dire "ça
suffit, partez tous, et renouvelons la classe politique" (vote blanc),
ni aucun moyen de chasser un éventuel affreux (RIC révocatoire).
Mais nous avons quand même
lInternet et les "petits" candidats à la présidentielle. Cest une
fragile opportunité. Si on devient nombreux, on peut transformer cette fragile
opportunité en mutation démocratique, en progrès.
Si nous sommes mille aujourdhui
et que chacun dentre nous arrive à convaincre cinq personnes, dabord du rôle
central de la Constitution dans notre vie quotidienne, du lien direct entre
les politiques réprouvées, la précarité qui se généralise, et linterdiction de résister directement
écrite dans nos propres institutions, si nous sommes capables aussi dexpliquer
à ces 5 personnes limportance dexpliquer à leur tour les principes protecteurs cachés et refusés,
on sera vite cinq mille. Et si on continue tous, sans se décourager, on peut
devenir assez forts.
Concrètement, donc : pour que
ce plan ait une chance de fonctionner, il faut que nos idées soient simples et
puissantes.
Il sagit prioritairement de dépasser le factice clivage
"droite"-"gauche" et de montrer que lenjeu est de protéger les citoyens, les
vrais humains plutôt que les personnes morales, concrètement et honnêtement.
Or, quand on se penche sur la
situation institutionnelle française et européenne pour comprendre et montrer
où se perd le pouvoir, ce nest pas simple demblée :o)
Doù limportance de notre débat
actuel pour affûter nos arguments et nous frotter à une vraie contradiction, de
façon à progresser et rendre nos idées, si possible, claires et irréfutables.
Sur les 50 principes que jai
décrits dans "Les grands
principes" et que jai résumés dans la feuille http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Evaluation_projet_constitution.xls, il faudrait que nous en
choisissions 10 ou 15 seulement,
universellement acceptables et convaincants.
Cest dans cet esprit que nous
devrions débattre :
1 - Quels principes garde-t-on
et quels principes laisse-t-on à lécart des discussions à venir, pour être
consensuels et décisifs auprès du plus grand nombre ?
2 - Et dautre part, sur ces principes auxquels tout le monde devrait
tenir comme à la prunelle de ses yeux, quelles sont les attaques qui seront
probablement formulées et comment
peut-on répliquer aux objections, simplement mais fortement ?
Si tout se passe bien, dans
quelques mois, on aura défini une dizaine de principes incontestables
constituant une exigence citoyenne solennelle, un groupe de revendications
fondamentales.
Et si on sest bien réveillés
entre nous, si on réussit à en réveiller beaucoup dautres, et mieux : à
faire de ces réveillés des réveilleurs
mieux encore : des réveilleurs de réveilleurs
on peut
devenir très nombreux (il faudrait que nous soyons des millions :o)
Tous ces citoyens enfin debout
finiraient par signer une pétition constituante géante qui
pourrait former un cadre de travail pour une Assemblée Constituante élue (par exemple).
Je suis sûr que nous avons des
hommes politiques honnêtes et dévoués au service public, capables daccepter ces exigences citoyennes de contrôle permanent
des pouvoirs (même si cest trop difficile pour eux dimaginer ces contrôles et
de les proposer eux-mêmes), et de relayer
ces exigences en déclenchant eux-mêmes ce programme constituant qui devrait se
dérouler ensuite sans eux.
On a besoin deux, mais pas au moment de fixer les limites de leur
pouvoir.
Bien sûr, je connais la fable de « Perrette, sur sa tête ayant un pot au
lait
» et je sais bien quil est facile de bâtir des "châteaux en Espagne", mais bon, je
décris ici une issue que je crois possible, tout en sachant bien que, pour
linstant, tout le monde dort et que les berceuse télévisuelles, sportives et
publicitaires tournent à fond.
Ce qui est sûr, cest que la
résignation ne change jamais rien : cest notre volonté qui est capable de
changer la vie, rien dautre.
Donc, on peut essayer, chacun à sa mesure et avec ses forces à lui,
de pousser tous dans cette direction-là, et on verra bien si on est assez forts
pour éloigner les voleurs de pouvoir :o)
Bonne année 2006 :o) - Premiers pas interactifs pour ce site (2-4
janvier 2006)
Bonjour à tous
et bonne année :o)
Ce site est en train de changer : il sagit d'abord
daméliorer votre confort dutilisation par la fin de la division de la fenêtre en cadres, ce qui devrait faciliter limpression.
Un clic sur un lien de len-tête (Sommaire) va désormais ouvrir
une page à la place du Sommaire (et non plus dans le cadre
placé en dessous du sommaire).
(Astuce : utilisez la touche BackSpace (Correction Arrière, au dessus de la touche Entrée) avec une main, pour revenir à la page précédente (Sommaire),
tout en gardant la souris dans l'autre main.)
Il sagit surtout de créer une
partie blog, qui donnera au site plus dinteractivité, et qui vous
permettra enfin de réagir ici
publiquement point par point.
Je vous demande pardon pour les quelques causes de
dérangement qui surviendront sans doute, dautant que jai très peu de temps
pour la technique, étant débordé par le travail de fond.
La présentation du blog sera sûrement miteuse les premiers
temps, mais vous me direz ce que vous souhaitez, et peut-être aussi
m'aiderez-vous :o)
Pendant quelques jours, ne rédigez pas de longues réponses,
car nous aurons peut-être à changer ensemble notre fusil dépaule et
recommencer à zéro pour que notre débat soit performant. Il va falloir choisir
entre des outils informatiques (DotClear, SPIP, PunBB
) aux qualités
différentes.
Pendant une
semaine, testez surtout lagrément du bébé blog :o)
Je vous présenterai ensuite un bébé forum :o)
Mise à jour importante du document « Grands
principes
» (29 décembre 2005)
Je viens de finir un
chantier important sur le document « Grands principes dune bonne
Constitution
» : il y avait des répétitions, quelques
incohérences de plan et des lacunes : jai intégré de bonnes idées venant
de vous :o)
Cest mieux maintenant, je crois, et jai
hâte de connaître vos réactions.
Je
mattelle aujourdhui à la partie BLOG du site qui va vous permettre de réagir publiquement point par point :o)
Jai
découvert un grand livre : « La démocratie athénienne
à lépoque de Démosthène », de Mogens Herman Hansen,
danois, professeur à Cambridge, (Les Belles Lettres, 2003, 490 p.).
Pour
découvrir Athènes, cest la
référence, vingt-cinq ans de travail, résumé de six volumes. Cest une
source importante pour la partie athénienne du livre de Bernard Manin. Lauteur souligne que sil est vrai que la démocratie
directe nexiste plus, ce constat napporte pas du tout la démonstration
quelle ne pourra plus jamais exister. Au contraire, il estime que la démocratie directe est rendue tout à
fait possible par les techniques modernes.
Cest
un livre rigoureux et limpide où la vie quotidienne et les débats de société,
décrits de façon très vivante, évoquent furieusement nos luttes politiques et
sociales modernes. Cest captivant.
On
y découvre que la philosophie est probablement née pour analyser la démocratie,
qui préexistait.
La démocratie athénienne apparaît comme une courte période, presque unique dans
lhistoire, où des hommes simples ont pu astucieusement
"voler" un siècle de contrôle des pouvoirs à la barbarie universelle,
juste le temps que les puissants inventent les stratagèmes solides pour voler à
nouveau le pouvoir au plus grand nombre, et pour longtemps cette fois.
Cest
un livre important.
Voici un
des documents repérés par Pierre. Cest fort, et ça résonne profondément avec
larrogance du FMI et de la Banque Mondiale, et avec les bouleversements
actuels en Amérique latine.
|
Exposé du
Chef Guaicaipuro Cuatemoc (Amérique
Latine) devant la réunion des Chefs dÉtat
de la Communauté Européenne, en Espagne, à Valence, en avril 2002.
Avec un langage
simple, retransmis en traduction simultanée à plus dune centaine de Chefs
dÉtats et de dignitaires de la communauté Européenne, le Chef Guaicaipuro Cuatemoc finit par
inquiéter son auditoire lorsquil déclare :
« Ainsi moi, Guaicaipuro Cuatemoc, je suis venu rencontrer ceux qui
célèbrent la rencontre. Ainsi moi, descendant de ceux qui peuplaient
lAmérique il y a quarante mille ans, je suis venu rencontrer ceux qui lont
rencontrée il y a seulement cinq cents ans.
Ainsi donc,
nous nous rencontrons tous. Nous savons qui nous sommes, et cela suffit.
Le frère
douanier européen me demande un papier écrit avec un visa pour que je puisse
découvrir ceux qui mont découvert.
Le frère
usurier européen me demande de payer une dette contractée par Judas à qui je
navais jamais permis de me vendre quoi que ce soit.
Le frère
avocaillon européen mexplique que toute dette se paie avec intérêt, même si
cest en vendant des êtres humains et des pays entiers sans leur demander
leur consentement.
Et je les
découvre peu à peu.
Moi aussi, je
peux réclamer des paiements, moi aussi je peux réclamer des intérêts.
Les Archives des Indes attestent, papier après papier,
reçu après reçu et signature après signature, que seulement entre 1503 et 1660, sont arrivés à
Sanlucar de Barrameda 185 tonnes dor
et 16.000 tonnes dargent en provenance dAmérique.
Pillage ?
Je ne le croirais pas ! Ce serait penser que les frères chrétiens ont
manqué à leur Septième Commandement.
Spoliation ?
Que Tanatzin me garde dimaginer
que les Européens, comme Cain,
tuent et nient le sang de leur frère !
Génocide ?
Ce serait accorder crédit aux calomniateurs tels Bartolomé de las Casas, qui qualifient la rencontre de
destruction des Indes ou dautres comme Arturo
Uslar Pietre qui affirment que le démarrage du capitalisme et de la
civilisation européenne actuelle se sont produits grâce à cette avalanche de
métaux précieux ! Non !
Ces 185 tonnes dor et ces 16.000 tonnes dargent doivent
être considérés comme le premier de
beaucoup dautres prêts amicaux de lAmérique, affectés au développement de
lEurope.
Le contraire
serait présumer de lexistence de crimes de guerre, ce qui ouvrirait droit
non seulement à exiger leur remboursement immédiat, mais également à des
dommages et intérêts.
Moi, Guaicaipuro Cuatemoc, je préfère
retenir la moins belliqueuse de ces hypothèses. Cette fabuleuse exportation
de capitaux ne fut que le début dun plan MARSHALLTEZUMA, destiné à assurer
la reconstruction de la barbare Europe, ruinée par ses guerres déplorables contre
des musulmans cultivés, inventeurs de lalgèbre, du bain quotidien et de bien
dautres progrès importants de la civilisation.
Donc, en célébrant le Cinquième Centenaire du Prêt, nous
pourrions nous demander : les frères européens ont-ils fait un usage
rationnel, responsable ou du moins productif des fonds si généreusement
avancés par le Fonds International Indo-américain ?
Nous
regrettons de devoir dire non.
En matière de
stratégie, ils lont dilapidé lors des batailles de Lépante, dans les invincibles armadas, dans des
troisièmes reichs et dans bien dautres formes dextermination mutuelle, sans
autre fin que de se retrouver occupés par les troupes gringas de lOTAN,
comme à Panama, le canal en moins.
En matière financière,
après un moratoire de 500 ans, ils ont été incapables, non seulement de liquider
le capital et ses intérêts mais également de se rendre indépendants vis-à-vis
des revenus en liquide, des matières premières et de lénergie bon marché que
leur exporte et leur fournit tout le Tiers Monde.
Ce tableau déplorable confirme laffirmation de Milton Friedman qui dit quune
économie subventionnée ne peut jamais fonctionner, ce qui nous oblige, dans
votre intérêt, à vous réclamer le paiement du capital et des intérêts dont
nous avons si généreusement différé le paiement ces derniers siècles.
Ceci étant,
nous devons préciser que nous ne nous abaisserons pas à faire payer à nos
frères européens les taux dintérêt vils et sanguinaires de 20 et même 30 %
quà loccasion certains frères européens font payer aux peuples du Tiers
Monde.
Nous nous limiterons à exiger le remboursement des métaux
précieux avancés, plus un intérêt modique fixe de 10 % lan, cumulé seulement
sur les 300 dernières années, soit 200 ans dexonération.
Sur cette
base, et si nous appliquons la formule européenne des intérêts composés, nous
informons nos découvreurs quils nous doivent, en premier paiement de leur
dette, un poids de 484 147 034 294 866 tonnes
dor et de 41 872 milliards
de tonnes dargent.
À savoir, des
volumes équivalant aujourdhui à 193 658 813 717 fois la
production dor annuelle mondiale (2 500
tonnes en 2003) et 2 733 170 753 199 fois celle
dargent (15 320 tonnes en 1996).
Ce total
équivaut également à 70 % de toute lécorce terrestre, soit 0,7 % de
lensemble de la planète.
Elles pèsent
lourd ces masses dor et dargent. Et combien pèseraient-elles si on les
comptait en sang ?
Ajouter que
lEurope, en un demi millénaire, na pas pu générer suffisamment de richesses
pour régler ce modique intérêt, serait admettre son échec financier absolu
et/ou lirrationalité démentielle des principes du capitalisme.
Bien entendu,
les indiens dAmérique ne se posent pas de telles questions métaphysiques.
Par contre
nous exigeons la signature dune Lettre dIntention engageant les peuples
débiteurs du Vieux Continent, les obligeant à respecter leur engagement par
une rapide privatisation ou reconversion de lEurope, leur permettant de nous
la remettre tout entière, à titre de premier versement de la dette
historique. »
Quand le Chef Guaicaipuro Cuatemoc a donné sa conférence devant la réunion des
Chefs dÉtat de la Communauté Européenne, il ne savait pas quil était en
train dexposer une thèse de Droit International destinée à déterminer la
VÉRITABLE DETTE EXTÉRIEURE.
Il ne
reste plus quà trouver un gouvernement latino-américain suffisamment
courageux pour porter laffaire devant les Tribunaux Internationaux.
|
Ce texte a tourné sur Internet et il sest enjolivé, mais pas
transformé fondamentalement. Il est paru en fait en 1992 (http://www.newint.org/issue312/plan.htm),
semble-t-il.
Sur le fond, il
donne des idées fortes pour réfléchir au-delà de la pensée unique néolibérale.
Jai élaboré une petite feuille pour contrôler soi-même les
calculs :
Dette_de_l_Europe_envers_l_Amerique_Latine.xls
Celui
qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème. (Gandhi) (Merci Dieudeschats
:o)
Par les
livres, par le temps que je vole à ma vie "moderne" pour les
lire, je suis en train de naître politiquement, avec la désagréable impression dêtre
en retard, mais aussi le plaisir de grandir.
Je
voudrais ici remercier Pierre, un des milliers dinternautes qui ont réagi à « Une mauvaise Constitution »,
car Pierre a déclenché chez moi un processus important et totalement imprévu,
le questionnement de lintouchable, la remise en cause de lévidence,
limpossible reniement dun principe quasi sacré pour tout le monde
Le dieu Suffrage Universel a pris un coup sévère
depuis que Pierre ma écrit (je vous dirai le nom de Pierre, plus tard).
Pierre lit et réfléchit sur la
démocratie depuis trente ans et sinsurge depuis longtemps contre les
impostures modernes. Il a écrit un vrai livre dans lequel il développe et
articule toutes ses idées. Il lintitule « Manifeste
pour la vraie démocratie » et il ne la pas encore publié (cest en
cours).
Pierre ma carrément envoyé par mail ce
document de plus de 200 pages
:o) Je souris parce que jai ainsi reçu
plus de cent documents considérables dont le volume a rapidement pris des
proportions inhumaines : je ne suis pas encore venu à bout de cette
montagne de réflexions citoyennes (hauteur de cette pile-là, sur mon
bureau : un mètre).
Relancé plusieurs fois cet été par
Pierre-le-patient-et-tenace, jai vraiment commencé la lecture de son livre au
mois de septembre
et je lai finalement dévoré comme un roman, plantant là
tous mes autres bouquins en cours
Ce livre est vraiment intelligent et
décapant, une mine à idées enthousiasmantes et
réalisables. Pierre est en
colère, il ne mâche pas vraiment ses mots et ça donne un style très vivant,
tonifiant.
Jai hâte quil soit publié pour que
vous puissiez le lire à votre tour. Pour linstant, Pierre mautorise à publier
son plan détaillé (dès que jai lu
ce plan, je me suis dit "il faut que
je lise ce livre") :
|
AVANT-PROPOS
:
La démocratie trahie par les politiciens. La
politique au coeur de tous les problèmes. Proposer un nouveau modèle
politique. Changer les règles du jeu. Restaurer une véritable démocratie.
PREMIÈRE PARTIE : La folie des hommes
Jusquoù va la folie des hommes. Toute forme
de pouvoir est dangereuse et engendre inégalités et violences. Les
politiciens et la lutte pour le pouvoir. La manipulation des masses.
CHAPITRE 1 : Questions
dérangeantes ? Pour qui ?
La folie de Sharon. Limpérialisme américain.
Une démocratie qui fabrique des dictatures. Bush élu par moins dun quart
des Américains avec un demi million de voix de moins que son concurrent
démocrate. Questions sur le 11 septembre 2001. Mensonges à la pelle.
Manipulations tous azimuts. Silence forcé sur un crime dÉtat absolu. Qui
sont les vrais terroristes ?
CHAPITRE II : Les racines du
mal. Le pouvoir et les hommes
Le pouvoir est une arme. Pouvoir de
largent. Le pouvoir crée de linégalité. Amplification de linégalité par
les élections au suffrage universel. Les effets pervers du pouvoir. Le
pouvoir oligarchique. Le principe de Peter. Lexpérience de Stanley Milgram.
Le pire des pouvoirs.
CHAPITRE III : La politique
et les politiciens
La politique et le politique. La classe
politique. Ses origines. Le comportement des politiciens. La dérive perverse.
La fausse communication.
CHAPITRE IV : Le suivisme
Les moutons de Panurge. Les dominés
contribuent à leur propre domination. La violence symbolique. Violence
dÉtat. La manipulation par la communication et par la mise en scène.
Fanatisation des masses. La peur du loup. Comportement du leader.
Paternalisme et infantilisation. Amplification du suivisme. Le fanatisme,
stade ultime du suivisme. Les six phases du fanatisme. Fanatisme et
sectarisme.
DEUXIÈME PARTIE : La démocratie trahie
Les
institutions actuelles ne respectent pas les principes les plus élémentaires
de la démocratie. La pratique démocratique actuelle ne respecte même pas ses
propres règles.
CHAPITRE I : Le déficit
démocratique
Les institutions renforcent le pouvoir
politique dune oligarchie au détriment du citoyen. La séduction politique.
Les leaders populistes. Dimension spirituelle ou organique de la
politique ? La perte des valeurs de la politique. Un minimum de
démocratie, un maximum de pouvoir aux mains des politiciens professionnels.
Lescroquerie à la démocratie.
CHAPITRE II : Lescroquerie
des élections
Lidéal de la justice électorale est
impossible à atteindre. Multitude de systèmes électoraux. Injustice de la
représentation : 550 % dinégalité ! Illégalité des élections
législatives de 2002. Le gerrymander. Améliorations possibles. Lénigme
Jospin.
CHAPITRE III : La mythologie
du suffrage universel
Suffrage censitaire et suffrage universel.
Historique. Référendums et plébiscites. Électeurs et élus. Lillusion du
vote. Le citoyen manipulé. Nature coercitive et oligarchique du pouvoir.
Limpossibilité des réformes structurelles. La montée de labstention.
TROISIÈME PARTIE : le
retour aux sources
Il faut
revenir aux origines de la démocratie pour la redéfinir et clarifier ses
principes fondamentaux. Faire table rase, et proposer un modèle de
fonctionnement dune vraie démocratie respectueuse de ses propres principes
et des attentes des citoyens. Cela débouche obligatoirement sur une stratégie
de reconquête du pouvoir politique.
CHAPITRE I : Les origines de
la démocratie
La démocratie à Athènes au V° siècle avant
Jésus-Christ. Lhistoire de la démocratie truquée et tronquée. Lescroquerie
intellectuelle. Démocratie directe et indirecte. Le refus du modèle
démocratique athénien. Égalité et suffrage censitaire. La procédure grecque.
Citoyens, métèques, esclaves, ostracisme. Hitler porté au pouvoir par la
démocratie. Responsabilité des femmes.
CHAPITRE II : Les principes
de la démocratie
Histoire grecque. Solon et Clisthène.
Ecclésia, agora, boulè, héliée, paideia. Le principe premier : légalité
politique. Le tour de passe-passe : un homme, une voix. Le principe second :
la liberté politique. Troisième et quatrième principes : deux procédures qui
respectent le principe du partage égalitaire du pouvoir. Les quatre piliers
de la démocratie.
CHAPITRE III : Légalité
politique, fondement des libertés
Priorité à la liberté politique depuis 1789.
La liberté économique conduit à lexploitation économique. Lanalyse marxiste
est insuffisante. La démocratie libérale fabrique des dictatures. La
démocratie est trahie par le suffrage universel.
CHAPITRE IV : Le tirage au
sort
1) Une
nouvelle procédure... vieille de 2500 ans.
Premier principe.
Deuxième principe. Conséquences.
2) La
réduction décimale.
Exemple simplifié. Un nouveau système pour désigner les
représentants. Précédents historiques. Rejet des moyens électroniques.
Justification de la réduction décimale.
3) La
nouvelle procédure.
4) La durée
du mandat.
5)
Fonctionnement des groupes-citoyens.
6) Le
problème des circonscriptions.
CHAPITRE V : Les enjeux du
tirage au sort
1)
Légalité politique;
2) La fin
de la violence dÉtat.
3) La
reconnaissance de lautorité.
4) La
représentation miroir.
5) La fin
dun système politique schizophrène.
6)
Lélimination des pervers dangereux.
7) La fin
de la corruption et du règne de largent.
8) La fin
du centralisme et de lirresponsabilité.
9) Moins de
gâchis des énergies.
10) La
transparence.
11) Sortir
du conflit psychologique et de laliénation.
12) La
reconquête démocratique.
13)
Linitiative citoyenne.
CHAPITRE VI : Oppositions et
critiques
Lopposition de loligarchie. Une utopie
politique ? Qui est le plus capable de gouverner ? La dictature de
léconomie. La bêtise absolue des experts. Ex. du FMI. Laccusation de
démagogie. Un nouveau poujadisme ?
CHAPITRE VII : La stratégie
Un projet politique. Un nouveau parti
politique : le MCVD. La deuxième voie : la mise en place des groupes-citoyens.
CHAPITRE VIII : Avant de
conclure
Une économie mécaniste. Droit de propriété
et pouvoir. Colonialisme, impérialisme, mondialisation, mêmes combats.
Conditionnement et langage. Lillusion démocratique. Lessence de la
démocratie. La dictature de la compétition. Universalité des valeurs de la
vraie démocratie. Linitiative citoyenne.
CONCLUSION
La pensée
démocratique méconnue et trahie. La démocratie agonisante. Le Meilleur des
mondes. Changer les règles du jeu politique. La folie de la compétition. La
tromperie des politiciens. Sortir de linfantilisme politique. Égalité,
liberté et fraternité. Paix, justice et dignité.
|
Lidée du tirage
au sort est dabord bizarre,
choquante même, bien sûr, et semble ne pas résister au simple bon sens. Mais si on donne une chance à lidée et si on écoute,
pour voir, largumentaire avantages/inconvénients des deux modes "sort
<--> élections", lappréhension se transforme vite en forte envie
dessayer, car lidée est très forte, très séduisante, et en fait pas du tout
nouvelle : testée et améliorée depuis des millénaires, mais dissimulée, va
savoir pourquoi, depuis 200 ans.
Le livre de
Pierre contient aussi une bibliographie fourmillante et des annexes tout à fait
étonnantes.
À mon avis, ce
livre est considérable et il aurait sa place chez Fayard, éditeur important pour les citoyens debout :o)
Depuis ce livre,
jen ai découvert bien dautres, lumineux, sur le mode de désignation et la responsabilité
des représentants politiques, sur les avantages déterminants du tirage au sort, thème majeur pour nous
tous, mais thème "oublié" pour on ne sait quelle raison.
Je vous ai déjà
parlé du livre vivifiant au possible de Bernard Manin, « Principes du
gouvernement représentatif » (Champs Flammarion) et aussi de
celui, bouleversant, de Pierre Clastres : « La société contre lÉtat » (Éditions de Minuit).
Mais il faut
aussi lire lexcellent livre de Philippe Braud (professeur de
sciences politiques à lUniversité de Rennes), « Le suffrage
universel contre la démocratie », (PUF). Je vous en reparlerai,
cest sûr : tout citoyen devrait avoir étudié ces livres (étudier, cest
plus que lire :o)
Jai aussi en cours,
très actifs car ils sont absolument passionnants, deux petits livres : « La haine de la démocratie » de Jacques
Rancière (éd. La Fabrique) et « La démocratie, textes
choisis » de Bruno Bernardi (Corpus Flammarion).
Jen ai bien
dautres sous le coude, essentiels, mais je vous en parlerai quand je serai
vraiment au cur de leur lecture :o)
Plus je lis, plus
je me radicalise, je le sens bien, mais est-ce un mal ? Cest quand même
choquant, ce que font nos "représentants" pendant que les simples
citoyens travaillent, confiants et distraits.
Pour lélection du roi républicain, puissant
irresponsable imposé par la Vème, jai dû voter Chirac sans
vouloir Chirac parce que des règles
électorales injustes mont forcé en 2002 à choisir entre la peste et le
choléra : la combinaison du scrutin majoritaire à 2 tours, de limpossibilité
de voter blanc, cest-à-dire daffirmer mauvais tous les candidats, et de limpossibilité
de dire en cours de mandat « ça suffit ! » par référendum
dinitiative citoyenne, cette combinaison
de règles iniques conduit à lincroyable violence politique que le plus
grand nombre doit supporter aujourdhui, tous les jours dans un tunnel dobéissance de cinq ans, sans
rien pouvoir y faire.
Cet homme élu par force devrait se comporter en
Président "de tous les français" et, au lieu de ça, sans scrupule, il
ne sert que les plus riches : il
abandonne la sécu, il vend carrément nos entreprises publiques à ses amis,
avides de marchés et de profits géants, en allégeant de surcroît leurs impôts,
il prépare la forfaiture de lAGCS,
il accepte un extravagant taux de
chômage minimum (NAIRU)
imposé discrètement et cyniquement par des économistes hors contrôle, il
légifère par ordonnances traîtreusement pendant les vacances, marchant ainsi
sur la tête à la fois des parlementaires et des citoyens, pour généraliser la
précarité la plus absolue (CNE), il
met en place progressivement un État policier, il fait reculer les libertés
publiques et il décrète même létat
durgence sous des prétextes fallacieux, sans
que nous ayons le moindre droit de résister entre deux élections
(élections dailleurs largement truquées par une opposition droite/gauche
factice)
Cet abus de pouvoir quotidien est un viol politique sous couverture
"démocratique", violence mise en pleine lumière en 2002, mais
habituelle et bien réelle depuis longtemps.
Tous
ces malheurs viennent du refus, depuis toujours, des politiciens professionnels
de reconnaître le vote blanc et le RIC, vote blanc qui nous aurait permis en
2002 de récuser en bloc les deux candidats, et RIC qui nous permettrait de
résister aux abus de pouvoir.
Ce sont les professionnels de la politique, qui ont
peur quon puisse dire quon les trouve tous nuls et qui redoutent quon puisse
les écarter en bloc en exigeant un renouvellement de la classe politique, ce sont ces politiciens de métier qui refusent aux
citoyens le décompte et limpact des votes blancs.
Mais à lévidence, ce nest pas à eux de décider de ça.
Cest
à nous, simples citoyens, de gauche comme de droite car nos intérêts sont
ici supérieurement communs, représentés en Assemblée Constituante sans aucun membre ou candidat des
pouvoirs institués (qui seraient juges
et parties dans cette assemblée), décrire et dimposer les véritables
outils démocratiques, connus depuis
toujours mais refusés au peuple par une
caste qui a pris goût au pouvoir en y restant trop longtemps : référendum
dinitiative citoyenne, vote blanc pleinement reconnu, stricte indépendance
financière des médias et tirage au sort dune partie au moins de nos représentants
parmi les citoyens volontaires, pour des mandats courts et non renouvelables.
Les Athéniens lavaient compris : la politique ne doit surtout pas devenir un
métier : rotation du pouvoir avant
tout. Montesquieu insistait sur lessentiel : "pour quon ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir".
Proposition :
si on pouvait formuler un vote complet, comprenant deux
bulletins : une adhésion et un rejet, un nom choisi et un
nom honni, cela permettrait de ne jamais élire quelquun qui suscite plus
de rejets que dadhésions. Ne serait-ce pas plus avantageux pour tous les
électeurs, de gauche comme de droite, ne serait-ce pas plus démocratique ?
Ce
serait une adaptation de lostracisme
antique qui permettait à Athènes de mettre à lécart un citoyen jugé trop
influent et donc potentiellement tyrannique.
Voyez http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ostracisme.
Cet article a été relayé sur Bellaciao, ce qui nous permet den débattre :
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21716
Incontestablement,
le rôle des médias est central dans
la formation de lopinion publique
et donc dans la réalité du droit des
peuples à disposer deux-mêmes.
Comme
en toute matière, la liberté totale conduit à la négation de la liberté pour
tous au profit de la seule liberté des plus forts.
Il est inquiétant de
constater comme les médias, lieux de
pouvoir bientôt plus importants que les scènes politiques, font lobjet de convoitise, dappropriation et finalement
de confiscation, comme ont été confisqués les pouvoirs politiques, par une caste de professionnels faisant dun
service public leur métier à vie, arguant dune prétendue technicité
et dune nécessaire spécialisation.
Ce métier autoproclamé par certains
citoyens interdit durablement à tous les autres citoyens de jouer leur
propre rôle.
Quel est le contrôle citoyen de lattribution de
la parole dans le débat public ?
Il
est des fonctions de la Cité qui ne devraient jamais être des métiers à vie, cest
ce quon découvre en lisant les réflexions politiques athéniennes
(2 500 ans dâge).
À cet égard, le journalisme, comme la représentation politique,
devrait sans doute, pour le bien de la Cité, à cause du pouvoir que confère cette fonction, être soumis à une forte rotation, la même que celle que
les Athéniens avaient mise au centre névralgique de la protection des individus.
Comme en politique, la professionnalisation du journalisme est
(pas toujours mais) souvent à la fois inutile et dangereuse.
Il me semble que le rôle des
journalistes devrait être, souvent, de donner
la parole aux citoyens, à tous les citoyens, pour que puisse vivre un vrai
débat démocratique, riche de ses contradictions, plutôt que dutiliser la tribune
que leur métier leur offre (injustement) pour diffuser unilatéralement et quotidiennement leur opinion personnelle
comme une propagande - pensée unique (voir les éditoriaux assénés tous les
jours sans contradicteur sur les radios, journaux ou télés).
Ce
rôle de donneur de parole nest pas
si technique que ça : tous les citoyens pourraient jouer ce rôle, sans
quils aient besoin daccaparer toute leur vie cette position.
Bien sûr, certains journalistes font un vrai métier qui ne prive
personne, bien au contraire : les grands reporters, par exemple, ou bien
les journalistes dinvestigation, ne nuisent pas aux autres en jouant toute
leur vie le rôle qui est le leur.
Bien sûr aussi, les citoyens actifs et engagés que sont les
éditorialistes doivent pouvoir rester actifs et intervenir souvent dans le
débat public. Il serait dommage dignorer leur analyse.
Mais il est des fonctions
essentielles pour le débat de la Cité, programmation
/animation des débats, et présentation des journaux notamment, (liste
à compléter), pour lesquelles on devrait imposer un tirage au sort, au moins
sur les médias de service public,
parmi les citoyens volontaires, pour
des mandats courts : une
semaine, six mois ou un an (?), payés
par lÉtat.
On
peut attendre de ce tirage au sort, en lieu et place du népotisme actuel, les
mêmes vertus impartialisantes quen matière politique : plus
besoin de quotas, plus besoin de discrimination positive : on va ainsi
retrouver, naturellement, à tous ces postes stratégiques de donneurs de
parole, tantôt des hommes, tantôt des femmes, tantôt des riches, tantôt
des pauvres, tantôt des beaux parleurs, tantôt des timides, des blancs, des
noirs, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des ouvriers, des
employés, des cadres, des patrons, des jeunes, des vieux, des beaux, des
moches, des artisans, des paysans, des étudiants, des savants, des chirurgiens,
des écrivains, des chômeurs (horreur !)...
Cet inventaire à la
Prévert laisse imaginer la richesse
des nouveaux débats rendus possibles par le tirage au sort, le seul mode
démocratique de désignation des responsables de la Cité.
La démocratie a besoin de médias libres (cest-à-dire pas
confiscables par les plus riches) pour véhiculer toutes les pensées citoyennes,
sans exclusive.
Il me semble que seul un journalisme déprofessionnalisé, au moins partiellement, le permet vraiment.
Cette entrée dans les médias de
citoyens volontaires tirés au sort serait complétée par la nécessaire prise en charge par la Nation des frais
actuellement financés par la publicité, gangrène idéologique, mortifère à
tous points de vue, dont les citoyens devraient se désintoxiquer par une
interdiction pure et simple.
Les citoyens, pour se protéger des méfaits de la publicité sur les médias et linformation, donc sur nos valeurs, sur les pouvoirs et
finalement sur la démocratie elle-même, devraient linterdire simplement en
assumant ce que ça coûte : « Nous autres citoyens, à travers notre
État, nous décidons de prendre en charge pour tous les médias la différence
entre les recettes des ventes et le coût de fabrication pour que survive leur
précieuse indépendance. Et la publicité est simplement interdite dans tous les
médias (de toute façon, on produit, on consomme et on travaille trop, et la
publicité pousse encore à la roue en créant des besoins inventés alors que
lhumanité doit les réduire pour simplement survivre) ».
Voilà de largent qui ne serait pas gaspillé. Un beau sujet de référendum :o)
Quelle valeur
donnez-vous à une opinion publique éclairée de façon complète et impartiale,
protégée des manipulations ? À
partir de combien est-ce que "cest trop cher" ?
Auriez-vous des idées, des modalités, des
objections ? :o)
Cet article a été relayé par
le site Bellaciao et fait lobjet dun débat
chaud :o)
Cest là : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=21460
Sur AgoraVox, je suis tombé sur le
message dun citoyen, Alexandre Santos, qui décrit très
bien une idée enthousiasmante dont je vous ai déjà un peu parlé et qui pourrait
bien être une grande opportunité pour
les hommes de reprendre en main leur destin, progressivement, en douceur.
Depuis
un an, je lis des milliers de pages sur lidée de démocratie, les contraintes et les coups tordus quelle subit
depuis la nuit des temps. Je crois que lidée de DemExp peut nous donner un
avantage décisif sur ceux, peu nombreux mais influents, qui méprisent la
démocratie (la vraie) et qui nous conduisent, une fois de plus, à la guerre
(quand on nous dit quil nous faut une Europe forte pour résister aux USA et à
la Chine, ça ne suggère pas demblée un projet pacificateur : on est
plutôt encore dans une logique nationaliste de compétition entre prédateurs).
Pour
que ce projet DemExp fonctionne, il
faut que nous soyons vraiment très nombreux à y croire, (je lis La Boétie en ce moment, et son
invitation à mettre fin à notre
servitude volontaire est vivifiante), nombreux à essayer le logiciel de
façon un peu opiniâtre, et nombreux à faire progresser rapidement cette
expérience qui était techniquement impossible il y a seulement quelques années.
Ce qui, hier
encore, était une utopie ne lest peut-être plus aujourdhui :o)
Mais lisez plutôt cet argumentaire
lumineux :
|
DemExp : vie démocratique à lâge de linformation.
Lapparition dInternet et des nouvelles
technologies de linformation ont encouragé lexpérimentation de nouvelles
pratiques démocratiques. La semaine dernière, lEstonie
est devenue le premier pays à permettre le vote électronique lors délections
nationales. Ces premiers essais ne sont quun avant-goût de ce que pourrait
être la démocratie à lâge de linformation.
Les Grecs
anciens considéraient que la démocratie nétait viable que pour une cité état
ou territoire restreint, car les citoyens devaient habiter près de
lassemblée, afin de pouvoir
participer aux débats. De plus, il aurait
été inconcevable de réunir en un seul endroit les populations dun territoire
trop vaste, de sorte que les démocraties anciennes (cités grecques, cantons
suisses, althing islandais) ne concernaient que des territoires réduits, et
un nombre de citoyens limité.
La fondation des EUA, et
ladoption par les grands États européens de régimes démocratiques, ont exigé
ladaptation des pratiques
démocratiques pour tenir compte des contraintes
géographiques et démographiques. Au lieu de réunir tous les citoyens en un même
lieu, il a été décidé de désigner des délégués,
qui auraient la charge de représenter les positions dun certain nombre de
citoyens. Ces représentants se sont graduellement organisés en partis, et sont devenus les hommes et
femmes politiques qui prennent des décisions au nom de leurs électeurs. Les
compromis nécessaires pour permettre le fonctionnement dune démocratie dans
un grand État ont néanmoins eu des effets pervers.
Ils ont conduit à lapparition dun nombre croissant dintermédiaires, qui
éloignent le citoyen de la prise de décisions.
Par ailleurs, lorganisation de la classe politique en partis,
et leur professionnalisation,
ont contribué à établir lidée que la vie
politique est trop complexe et technique pour la plupart des citoyens.
Ceux-ci ne comprennent souvent plus comment les décisions sont prises. Ils se
sentent déconnectés de la vie politique, et estiment leurs avis ignorés lors
de la prise de décisions. Pourtant, lavènement de linformatique et dInternet a brutalement éliminé les
obstacles géographiques et démographiques dans la communication entre les
citoyens.
Les
distances géographiques nempêchent plus les citoyens de communiquer en temps
réel, et les moyens informatiques actuels permettent à chacun de participer
au débat, quel que soit le nombre de participants. Il serait donc
théoriquement possible de revenir au système de démocratie ancien, où les
décisions ne sont plus prises par des intermédiaires, mais par chaque citoyen.
La question devient alors : comment construire un système informatique qui
permette le fonctionnement dune assemblée incluant tous les citoyens ?
Cest le but du projet DemExp (http://www.demexp.org/, expérience
démocratique), dirigé par Frédéric Lehobey et Félix
Henry, et programmé par David Mentré.
Pour comprendre le système
DemExp, on peut le voir comme un forum en ligne, dans lequel seraient posées les
questions qui doivent être adressées par lassemblée.
Prenons, par exemple, la
question de lavortement. « Est-ce que
lavortement doit être interdit ou permis, et suivant quelles
modalités ? » Chaque citoyen aurait la possibilité de proposer une réponse à cette
question, ou de voter pour une réponse
qui représente correctement son opinion.
On pourrait alors imaginer
que trois réponses principales se dégagent :
A - Lavortement doit être
interdit. B - Lavortement devrait
être permis pendant les trois premiers mois de la grossesse. C - Lavortement devrait être permis.
Imaginons que la réponse B
recueille le plus de votes. Elle sera donc considérée comme représentative de
lensemble des citoyens, et devient la position officielle de lassemblée.
Elle sera la référence suivant
laquelle les décisions doivent
être prises.
Deux remarques :
1 - La décision gagnante nest pas
simplement la majoritaire, mais la plus consensuelle parmi les citoyens. Pourquoi ? Parce que le système de vote nest pas à majorité simple,
mais suit la méthode de vote de Condorcet.
Dans ce système de vote, lélecteur
ne vote pas pour une seule réponse, mais peut voter pour un ensemble de
réponses qui le satisfont, en les ordonnant, par ordre de préférence.
Lavantage de cette méthode est déviter le vote stratégique (voter non
pas pour loption quon désire, mais contre celle quon veut éviter), et
permet de dégager loption la plus consensuelle au sein dun groupe.
Ainsi, par exemple, lors
des élections du 21 avril, les deux candidats retenus étaient Chirac et Le Pen, alors que leur nombre de votes additionnés natteignait
pas 50 %. Il est très possible que ces deux candidats aient donc été
loin de la préférence de la majorité des électeurs. Le problème du vote stratégique est que, à force de voter contre
quelque chose, on peut ne jamais avoir loccasion de voter pour les idées que
lon désire. Ainsi, par exemple, on pourrait imaginer que dans un système
avec deux partis majoritaires, tous les électeurs de gauche se sentent
obligés de voter PS, pour ne pas laisser gagner la droite, alors que le PS ne
défend pas vraiment leurs idées, et quils préfèreraient des partis comme les
verts, PC, etc. Avec le système de
Condorcet, chacun peut voter pour lidée qui lui tient à coeur, tout en
appuyant celles quil estime acceptables, si sa préférée nest pas retenue.
Il ny a donc plus de pénalité à voter pour les options qui nous sont
proches, mais qui restent minoritaires.
Dans notre exemple, une
majorité des électeurs de la réponse A donnerait comme préférence secondaire
la réponse B, de même que les défenseurs de la réponse C. La réponse B serait
confortablement désignée comme la plus consensuelle, alors que par la méthode
à majorité simple, et pour peu que lélectorat soit partagé, les réponses A
ou C pourraient gagner de quelques votes, bien que la majorité de lélectorat
y soit opposée.
2 - Le vote nest pas ponctuel mais
continu. Contrairement aux systèmes
démocratiques actuels, le vote na pas lieu pendant une période donnée, mais
se fait de façon continue. Il ny a donc pas délections dans le système DemExp. Chacun
est libre de changer à tout moment ses préférences, et la position la plus
consensuelle est continuellement recalculée. Cette particularité offre
plusieurs avantages :
- Il nest pas possible de faire pression sur un électeur, comme ce pourrait être le cas pendant les élections
classiques, car lélecteur peut changer à tout moment son vote. Pour forcer
une proposition, le groupe de pression devrait pouvoir contrôler
continuellement un nombre suffisant délecteurs, ce qui est en pratique peu
probable.
- La tenue délections nest plus un facteur dinstabilité
pour la société. Il ny a plus de paralysie
des institutions en attente dun éventuel changement de majorité, les
décisions ne sont plus soumises au diktat des échéances électorales.
- Lélectorat est moins facilement manipulé par les médias ou la classe politique.
Les décisions prises par
des élections et référendums sont souvent conditionnées par les circonstances
politiques présentes au moment des élections, alors que le long terme est
négligé. Les résultats peuvent être affectés par un événement médiatique
récent, tandis que les scandales ou événements plus anciens sont négligés par
lélectorat. Certains pourraient penser que le vote en continu pourrait être
source dinstabilité, si la position la plus consensuelle change au gré de
lactualité médiatique.
Mais en
réalité, combien de fois changeons-nous dopinion par jour ? Un jeune électeur pourrait varier ses opinions pendant
une certaine période, mais ses décisions deviendraient plus constantes avec
lexpérience.
Quelle serait la portée de
ce système de prise de décisions ? Le système DemExp est très flexible, et a vocation à être utilisé à tous les
niveaux, depuis lassociation locale, en passant par la ville, la région,
lÉtat ou même le monde. Quel type de décisions pourraient être prises ? DemExp
aurait pour objectif de remplacer toutes les prises de décision actuellement
effectuées par les politiciens.
Jimagine
que les questions se bousculent dans lesprit du lecteur : comment aurais-je
la compétence pour décider du système de transport de ma ville, ou de la
politique de santé ou budgétaire de lÉtat ? De toute façon, je
travaille, et je nai ni le temps, ni lenvie de suivre toutes les décisions
concernant le système local dégouts ou la réglementation du transport
fluvial ! Ces doutes sont
compréhensibles, mais il faut se rappeler quils sont tout aussi valables
pour les politiciens. Les politiciens ne sont pas plus compétents que
dautres pour connaître tous les domaines techniques, économiques,
scientifiques qui jouent dans une prise de décision.
En réalité, la seule compétence dont ait
fait preuve un politicien est sa capacité à recueillir un grand nombre de
votes pour lui ! De plus, un politicien
ministre ou premier ministre na absolument pas le temps ni les moyens de
comprendre complètement les rouages des ministères, des institutions sous ses
ordres, et le détail des questions auxquelles il est confronté. En réalité, il nexiste personne sur
Terre qui ait une compréhension complète de tous les rouages dune société
moderne, et certainement aucun premier ministre ou président. Les
politiciens prennent régulièrement des décisions sur lagriculture, le
système de santé sans avoir suivi aucune formation dagronomie ou médicale.
Ils dirigent les ministères des finances ou sont aux commandes de larmée
sans avoir suivi de formation économique ou militaire. Les doutes sur la
compétence des citoyens à prendre des décisions sur le fonctionnement de la
société renvoient aux doutes originels sur le bon sens de la démocratie.
Est ce
que le peuple a la capacité de prendre des décisions raisonnables, ou doit-il
être mené par une élite ? Lhistoire a
maintes fois montré que le peuple sen sort très bien, et que, au contraire
cétait un excès de pouvoir sans contrôle, accumulé par un petit groupe, qui
pouvait conduire aux pires catastrophes.
La
vérité est que le citoyen doit être capable de survivre dans la société. Il
doit être capable de gagner sa vie, gérer ses finances, éduquer ses enfants,
suivre les lois, payer les impôts. Aucun
citoyen ne peut clamer son ignorance de la loi en sa défense dans un
tribunal. Il est donc absurde de prétendre que le citoyen ne serait pas à
même de prendre des décisions sur les lois quil devra suivre.
En ce qui concerne le
problème du temps disponible pour participer
à tous les débats possibles, la solution est simple, il peut déléguer son vote à quelquun en qui
il a confiance pour gérer la question. On pourrait penser que cest une forme
détournée de recréation des politiciens, mais la situation est très
différente : on ne délègue son vote que pour des domaines bien précis.
Un citoyen peut déléguer son vote sur les questions de santé à une
personnalité (disons un médecin réputé) en qui il a confiance, sauf en ce qui
concerne la question de lavortement, pour laquelle leurs avis divergent. - Cette
délégation est temporaire et immédiatement révocable. Dès que le
citoyen ne se retrouve plus dans les positions de cette personnalité, elle
peut immédiatement lui retirer son appui. On évite ainsi limpression de
blanc-seing donnée aux politiciens pendant quatre ans suivant chaque
élection.
Comment
mettre en uvre le système DemExp
? Lidée des initiateurs de DemExp serait de tout simplement utiliser les structures actuelles
pour lancer les réformes nécessaires : chaque citoyen convaincu de lintérêt
du système DemExp voterait pour des
représentants DemExp. Ceux-ci deviendraient donc des politiciens, mais
prendraient lengagement dappuyer les décisions prises par le système
DemExp, quelle que soit leur opinion personnelle sur la question. Ils seraient ainsi les représentants et
exécutants des positions consensuelles prises au sein des citoyens soutenant
le système DemExp. Au fur et à mesure que le nombre de politiciens DemExp
augmente, ils pourront commencer à réformer les institutions de la ville, de
la région, de lÉtat, pour mettre en place le système DemExp. Il serait ainsi
possible de réformer les institutions de façon totalement démocratique, et en
douceur.
En conclusion, le système DemExp devrait placer chaque
citoyen fermement aux commandes du processus de décision de lÉtat, tout en
lui permettant de véritablement soutenir les idées qui lui tiennent à coeur.
Objections :
jimagine que beaucoup dinterrogations viendront à lesprit du lecteur. En
ce qui me concerne, je pense quil est
essentiel de garantir la sécurité du
système, non pas à cause de la manipulation du nombre de votes, mais pour
une question de confidentialité. En effet, le système doit maintenir en continu un
registre de lidentité de lélecteur et le profil complet de ses votes, et
donc de ses opinions. Ce serait une source dinformations formidable
sur chacun, et qui pourrait devenir
dangereuse pour un citoyen persécuté. Il faudra donc trouver des
méthodes de sécurité crédibles, qui empêchent ce genre de profilage. Est-ce
que cela fonctionne ? Le logiciel permettant de mettre en place un
système DemExp existe déjà, mais est encore trop imparfait pour être utilisé
par la société. En revanche, il serait possible à une organisation
(association) de le mettre en place comme système de décision.
|
Cest sur AgoraVox, un bon blog, où vous devriez aller lire lintéressant débat qui suit ce
texte :
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=4003.
Voyez
aussi : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=3870.
Cette
idée inédite na de chance de nous aider à prendre notre sort en main que si
nous sommes très nombreux. Il faut donc briser
une certaine habitude de spectateur en
retrait et agir :
Téléchargez
le logiciel DemExp, puis
installez-le, puis consultez le mode
opératoire (tutoriel), puis testez
et critiquez :o)
Il faut quon
additionne nos forces, et quon réveille ensuite les autres, à gauche
comme à droite.
On
pressent quelques problèmes stratégiques qui seront déterminants dans le succès
ou léchec :
·
La sécurité qui doit être totale et vérifiable par tous à tous moment. Ce ne sera
pas simple, mais les hommes sont ingénieux.
·
La surabondance prolifique des informations à consulter : des
questions, des réponses et des interventions
Tout
va se jouer sur la hiérarchisation
des infos qui, elle aussi, devrait rester démocratique et évolutive.
·
La motivation des citoyens, à la fois accaparés par les
soucis quotidiens et contre éduqués par des siècles de passivité politique
entre deux élections,de surcroît largement factices, ce qui renforce encore le
découragement.
Lexpérience
ne fait que commencer, mais je la trouve porteuse despoirs immenses.
Laurent
Mucchielli (http://laurent.mucchielli.free.fr/) est un
sociologue bien intéressant à qui nos journalistes ont souvent donné la parole ces
derniers jours, à propos des violences en banlieue :
Daniel Mermet à Là-bas si jy suis : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=779,
Laurence Luret à Parenthèses :
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/information/chroniques/chronique/index.php?chronique_id=15,
et dans Libération : http://www.liberation.fr/page.php?Article=337030.
Il développe un bon plaidoyer
pour quon lise la violence comme le résultat
dune exclusion extrême.
Je relie
sa réflexion à celle sur nos
institutions qui, elles aussi, excluent
les citoyens du fait politique entre
deux élections : pas de référendum dinitiative citoyenne et pouvoir
exécutif hors contrôle, aussi bien en France quen Europe.
Cette exclusion
quotidienne des affaires politiques est finalisée, verrouillée, par des élections qui, même elles ! ne
sont quune parodie, gravement truquées, profondément perverties, à la fois
par le scrutin majoritaire strict (des millions délecteurs sans aucun
représentant à lassemblée), par le refus du vote blanc (scandaleusement
assimilé au vote nul), par le cumul des mandats, et surtout par le fait
que les politiciens professionnels "de
gauche" et de droite conduisent
la même politique (le néolibéralisme, qui comble la petite caste des plus
forts et nous asservit tous progressivement).
Les
citoyens qui refusent absolument le libéralisme déchaîné, mortifère, ne sont
donc plus défendus par personne au
pouvoir.
Il est
très dangereux de laisser ces millions de personnes en colère sans voix (ni
voie) politique.
Cette
équivalence des politiques gauche droite est bien le comble du mensonge et
finalement du mépris du choix électoral, mais ce nest pas si surprenant :
cest cohérent avec la malhonnêteté
des institutions écrites par les hommes au pouvoir eux-mêmes,
évidemment juges et parties, et cest
bien là le nud de laffaire :
Cest à nous, citoyens, et pas aux "pros"
de la politique, décrire nos propres institutions, pour nous protéger, au plus
haut niveau du droit, contre ceux qui veulent le pouvoir.
Depuis au
moins 2 500 ans, on sait que ces hommes-là, candidats au pouvoir, sont, si on ne les contrôle pas parfaitement,
le plus grand danger pour la vraie démocratie qui, rappelons-le, est le pouvoir
partagé par tous.
Lexclusion
des humains de laction politique réelle conduit tôt ou tard à la violence, et
ce serait de bonne gestion de la Cité de rendre
parole et force aux citoyens, avant que ça barde.
Le 30 octobre, je
relayais une protestation de médecins contre la complicité évidente de nos
"représentants" politiques face à la production massive dOGM, en
secret et contre le gré des populations. Je vais encore vous parler de quelques
documents liés entre eux par la même idée force.
On
lira dabord avec intérêt Gilbert LAVAL dans
ce court article : « Isabelle Sommier, chercheuse, et les faucheurs dOGM : "La désobéissance vise à provoquer le
débat public" » :
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=19028
« Après les procès devant la cour dappel de Toulouse de
neuf élus et syndicalistes, dont le député Noël Mamère (Verts) et José
Bové, "faucheurs volontaires dOGM", Isabelle Sommier, maître de conférences en sciences politiques et
directrice du Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CNRS), analyse le
phénomène dit de désobéissance civile.
Elle effectue ses recherches sur la violence en politique et sur les mouvements
sociaux, dont les luttes animées par les altermondialistes. » La suite
Dans les cas graves, quand on na pas de RIP, on na que la
désobéissance civile.
Quand nous aurons enfin conquis le RIP, contre la
volonté de nos propres "représentants" (il faut se rendre compte que
ceux qui bloquent le RIP libérateur sont ceux-là mêmes qui sont élus et payés
pour nous représenter et nous protéger), la désobéissance civile disparaîtra
delle-même.
À ce
propos, on lira avec intérêt le bon livre de José Bové : « Pour la
désobéissance civique » (voir bibliographie), ainsi que la très
intéressante Charte des faucheurs volontaires :
http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=1342
On
restera dans le même esprit quand on lira cet article qui nous rappelle que le
RIP est loin dêtre une dangereuse utopie, évidemment : le peuple suisse, moins infantilisé que les Français, débat lui-même de ce qui lui semble
important. « Vers un
double "oui" le 27 novembre? » http://www.swissinfo.org/sfr/swissinfo.html?siteSect=106&sid=6181165&cKey=1129910465000.
On lira les arguments de part et dautre pour se convaincre que le débat est
réel et permanent chez nos amis Suisses.
Pour revenir aux OGM, on ne compte
plus les articles inquiétants issus de médecins et de chercheurs indépendants,
lopposition populaire aux OGM est massive depuis longtemps dans tous les
sondages, et pourtant
nos "représentants", ceux qui sont élus et
payés pour veiller sur nos intérêts, laissent (impunément) cultiver en secret
mais en plein champ des semences interdites : « Le
gouvernement a caché l'existence des cultures commerciales d'OGM » (Le Monde, 9/9/2005)
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3228,36-686454@51-683851,0.html.
Pour
se convaincre de la probité et du sens de lintérêt général des géants mondiaux
de la semence, on lira « Irak : les géants
américains des semences transgéniques ruinent lagriculture et rançonnent les
paysans », par F. William Engdahl :
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=19995.
Pour rester en veille
citoyenne : http://www.infogm.org/ et http://www.greenpeace.fr/detectivesOGM/index.php3...
Décidément,
quand on cherche linfo au lieu de se laisser mener en bateau par le PPA et la
PQM, on découvre des océans de turpitude
et on donne toute sa mesure à notre
servitude volontaire.
Jai
reçu ce texte effarant (merci Jacques), et jen ai retrouvé la trace sur le
net :
« OGM : Les aliments
génétiquement modifiés ne conviennent ni aux humains ni aux animaux » :
http://www.indsp.org/ManorBeastFR.php
« Le
Docteur Mae-Wan HO et le Professeur Joe CUMMINS passent en
revue quelques preuves scientifiques à
propos d'une série de scandales récents qui concernent les aliments
génétiquement modifiés destinés à l'alimentation des êtres humains et des
animaux.
Ils
exposent ici une carence majeure dans les procédures réglementaires [du
contrôle des semences et des aliments qui en dérivent] et ils soulignent comment l'Europe risque
d'autoriser des variétés de plantes génétiquement modifiées [OGM] qui sont
génétiquement instables, et donc illégales [au plan de la
réglementation de la mise en marché comme semences] et dangereuses [pour la
santé publique et l'environnement].
Ils
demandent une investigation approfondie sur les abus scientifiques qui ont permis que les plantes OGM, qui ne
conviennent ni aux humains ni aux
animaux, puissent entrer dans notre chaîne alimentaire. (
)
PLAN de larticle, très
technique :
- Des incidents récents qui jettent le trouble sur la sécurité
des OGM
- Les toxines Bt
sont connues pour être dangereuses
- L'imposture concernant la réglementation des plantes Bt
- Il existe une preuve que les toxines naturelles ne sont pas
les mêmes, ou pas "équivalentes en substance" aux toxines du matériel
végétal d'OGM
- Tous les gènes génétiquement modifiés diffèrent des gènes
naturels
- Les procédés de
transformation génétique ne sont ni fiables ni contrôlables
- Les lignées
transgéniques sont fondamentalement instables
- Dans chacun de ces cas [étudiés], les inserts transgéniques
ont été réarrangés, et non seulement à partir de la construction utilisée, mais
depuis leur caractérisation par la société [en question]
- L'instabilité des transgènes est la question
majeure en matière de sécurité
- Il est par ailleurs illégitime de tirer des conclusions sur
du matériel hybride à partir des données enregistrées sur les lignées
parentales génétiquement modifiées.
- Il y a des
incertitudes importantes quant à la sécurité de la transgénèse
- Il est grand temps que nous interdisions toute dissémination
de plantes génétiquement modifiées dans l'environnement, afin d'ouvrir la voie
à une véritable agriculture durable (32).
- Le plus grand obstacle à un
futur durable et avec une sécurité [alimentaire correcte], réside dans la
corruption et la science corrompue qui s'exercent sur ce que l'on peut définir
comme un "principe d'anti-précaution".
Il doit maintenant y avoir une
enquête approfondie portant :
* sur la sécurité des
aliments destinés aux êtres humains et aux animaux et provenant de plantes
génétiquement modifiés et
* sur les abus
systématiques de la science qui ont permis que de tels aliments issus d'OGM
soient autorisés, alors que nous avions tous les indices [nous indiquant]
qu'ils pouvaient ne pas offrir toutes les garanties en matière de sécurité
alimentaire.
Voir aussi : « OGM : Documents disponibles en français et accessibles par
Internet » :
http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2251
Ce refus des contrôles des produits chimiques
ressemble fort à une affaire « sang
contaminé » puissance 10
:o(
Voir sur ma page Liens des
extraits de « La haine de la démocratie »,
de Jacques
Rancière, et quelques
puissantes raisons dexiger le tirage au sort pour désigner nos représentants.
Jai encore reçu un document
passionnant. Cette fois, cest Claude qui explique de façon limpide
la cynique mécanique de la dette mondiale dans un contexte de laisser-faire, à
laide dune théorie des jeux très
intéressante. Il suggère aussi des solutions de bon sens.
|
CHRONIQUE
DUN DÉSASTRE ANNONCÉ
Laccroissement des inégalités
expliqué à ceux qui ne comprennent rien à léconomie.
Lorsquune société est régie par les
seules lois du marché, les riches senrichissent et les pauvres sappauvrissent. La raison en est simple.
Pour bien la comprendre, nul besoin douvrir de gros traités, dassimiler des
théorèmes compliqués : laissons un instant de côté Marx, Keynes et
autres Friedman. Beaucoup croient que cest dû simplement à ce que les riches
sont plus rapaces que les pauvres, mais la convoitise nest quun facteur
aggravant. La raison dépasse les « appétits » des uns ou la
« résignation » des autres. Elle ne dépend pas non plus du niveau
dinstruction, même si les diplômés ont plus de chances dentrer dans le
sérail et accéder au maniement des finances.
Pour comprendre cette
raison simple, le plus simple est plutôt daller dans quelque tripot et de
sasseoir à une table de jeu.
À un
jeu équitable, cest le plus riche qui gagne.
Prenons un jeu
simple : pile ou face. Vous choisissez pile ? Eh bien je choisis
face ! Sortons une pièce : vous allez évidemment demander à voir si
la pièce nest pas truquée, si le côté pile existe bien. Car les jeux ne
manquent pas, où cette vérification est impossible, comme par exemple les
jeux de grattage, où il nest pas possible de vérifier le nombre de tickets
gagnants sur le nombre total de tickets. Ce sont là des jeux de dupes, ce qui
explique peut-être leur succès énorme.
Les deux joueurs
vous et moi misent chacun un euro. Celui qui gagne remporte les mises. Le
jeu de pile ou face est un jeu de hasard : aucun des joueurs nest
capable de prédire le côté sur lequel la pièce va tomber. Chaque joueur a une
chance sur deux de gagner deux fois sa mise : on dit que lespérance
est de 0,5 x 2 = 1. Lorsque lespérance vaut 1, le jeu est dit équitable.
Les jeux de casino
sont plus ou moins équitables : la roulette, où lon a une chance sur 36
de gagner 35 fois sa mise, est le moins inéquitable, avec une espérance de 35
/ 36 = 0,97. Les 3% restant permettent au casino de vivre.
Il
existe un moyen simple, décrit il y a plus de deux siècles par dAlembert,
de gagner à coup sûr à un jeu équitable : quand le joueur perd, il
double sa mise. Sil perd, il va miser 2, puis 4, puis 8, 16, 32. Sil gagne
à ce coup-là, il ramasse 64. Comme il a misé 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63, il
empoche UN. À chaque coup gagnant, il gagne une mise de base.
La
difficulté vient de ce que pour doubler ainsi sa mise, il faut avoir beaucoup
dargent : sinon, si le joueur na plus de quoi doubler sa mise sur un
coup perdant, il perd TOUT. La méthode de dAlembert
est, dans ce cas-là, le moyen le plus rapide de se ruiner. À un jeu
équitable, cest le plus riche qui gagne.
On comprend pourquoi
les casinos plafonnent les mises : ce nest évidemment pas par quelque
scrupule moral, pour éviter aux malheureux clients de se ruiner, mais bien au
contraire pour éviter quen appliquant cette montante géométrique
un joueur (lensemble des clients) soit plus riche que lautre (le casino) et
puisse faire systématiquement « sauter la banque ». Si les mises
nétaient pas plafonnées, nimporte quel prince saoudien pourrait couler tous
les casinos de la Côte dAzur dans la semaine.
Du casino aux champs.
Ronald Reagan lâcha un
jour : « Si nous étions capables de faire baisser la température de
4°C au-dessus de
lURSS, nous en aurions fini dans un an avec le communisme ».
Heureusement, la pluie et le beau temps sont encore dus à des facteurs non
maîtrisables. Mais lagriculteur, soumis à ces facteurs, ne peut faire face à
ladversité que sil possède selon ladage paysan- une récolte sur pied, une
seconde dans sa grange et la troisième à la banque. Le petit paysan endetté
disparaît et le gros paysan riche senrichit : la loi du jeu dictée par
lOMC et appliquée à une activité vitale pour tous- a encore frappé.
Des
champs à la Bourse.
La spéculation
boursière a tous les aspects dun jeu de hasard. Dans leurs prévisions
économiques, les « experts » se trompent en moyenne une fois sur
deux, ce qui démontre non leur incompétence, mais la nature aléatoire de la
chose. Les politiques, eux, se trompent à chaque fois, ce qui là non plus ne
démontre pas leur incompétence, mais leur mauvaise foi, ce qui les oblige à
faire voter des budgets rectificatifs et naviguer à la godille, ce dont
évidemment ils se défendent en parlant de nécessité et de pragmatisme.
Nul ne peut prédire ce que sera le cours
dune action dans un an : la spéculation boursière est un jeu de hasard,
et en négligeant les cas de
« délit dinitié », on peut penser que ce jeu de hasard a
toutes les apparences dun jeu équitable, le petit porteur engrangeant le
même dividende ou subissant la même perte que linstitution financière la
plus cossue.
Il nen est rien. Là
où le petit porteur va saffoler dune baisse et vendre à perte,
linvestisseur institutionnel va être en mesure de laisser passer lorage
pour récupérer sa mise ultérieurement.
Le jeu de poker passe
pour un jeu de voyous. Cest cependant un jeu passionnant sil est équitable.
Or il nest équitable quentre joueurs
de même niveau ayant convenu en début de partie de mettre chacun la même
somme sur la table.
Au jeu
de la spéculation, la retraitée qui vend une action ninflue en rien sur son
cours. En revanche, la baisse provoquée par le gros joueur qui vend un
million dactions est immédiate. Tout se passe alors comme si la règle du jeu
avait subitement changé en cours de partie : on ne peut plus parler dun
jeu équitable, ni même despérance, au sens mathématique du terme défini plus
haut : la spéculation boursière est un jeu inéquitable.
Là encore, le gros
joueur gagne et statistiquement cest le petit qui perd. Lorsque la
partie sanime et quun gros coup a fait basculer le jeu, la panique sempare
des joueurs, les cours seffondrent et les journalistes y vont de leur
manchette habituelle : « Des
milliards de dollars partis en fumée ».
Objection, Votre
Honneur : ils ont simplement changé de poche. En effet, la Bourse, où les deux
seuls joueurs sont les actionnaires et les entreprises (y compris leurs
créditeurs et leurs débiteurs), est un jeu à somme nulle. On appelle
« jeu à somme nulle » un jeu où le nombre de joueurs est fini et où
le montant des sommes en jeu est fini, comme la partie de pile ou face ou la
partie de poker entre amis et les quelques billets mis sur la table. Dans un
tel jeu, si un joueur perd, il est évident quau moins un autre joueur gagne.
On na jamais vu des dollars brûler.
De la Bourse à la politique.
Restons encore un
moment à notre table de poker. Un ami cher vient de tout perdre, et comme on
voudrait profiter encore de sa compagnie (et si possible encore un peu de son
argent
), on va lui prêter de quoi « se refaire ». On le sait
honnête : il rembourse toujours ses dettes de jeux. On va donc lui
prêter suffisamment pour continuer à jouer, mais pas suffisamment pour quil
se permette les meilleures enchères. Il a donc moins de chances de gagner que
ses adversaires : il va sendetter un peu plus.
À la table de poker qui nous
intéresse, il ny a aujourdhui que deux joueurs : les nations, représentées
par leurs gouvernements, et les institutions financières, quon appelait
autrefois les capitalistes, mais qui préfèrent maintenant quon les appelle « le
marché ».
Le premier joueur na plus la
main, il est trop endetté. Pour continuer à jouer, les gouvernements sont
contraints de voter chaque année un budget en déficit : pas de problème,
le « marché » prête, et il prête volontiers. La spirale infernale
est engagée, et la ruine inéluctable. Pour justifier ce budget en déficit,
les ministres déclarent doctement que la croissance va tout régler. Or la
croissance, ce sont dautres enchères qui vont sentasser sur la table de
jeu, et lon a vu que cest le plus riche qui les ramasse. Le résultat le
plus immédiat est que lendettement des nations saccroît. Limpôt sur le
revenu des Français nest aujourdhui même plus suffisant pour régler ne
serait-ce que les intérêts de la dette publique, ce qui nempêche pas le
ministre, jamais à court dinepties, de vouloir le réduire encore.
Chaque année, le
Parlement, censé représenter les citoyens, vote un budget en déficit de 4 à
5% (avoués). La-t-on mandaté pour cela ? Accepterait-on délire un
député qui déclarerait à ses électeurs : « Chaque année je vais
voter un budget qui hypothéquera environ 5% de vos biens et ceux de vos enfants » ?
De laveu même dun ministre, notre pays sest ainsi endetté à hauteur de
mille milliards deuros, et chaque citoyen qui naît doit donc déjà 17.000
euros à lÉtat. Bien sûr, le chiffre est inférieur à la réalité, dans ce
domaine la vérité est politiquement incorrecte. De plus, ce nest pas auprès
de lÉtat que les citoyens sont endettés, mais auprès du
« marché ». On continue cependant délire des politiciens de
droite ou de gauche, peu importe qui martèlent que la hausse du CAC40 va
tout arranger, alors quelle ne fait quaccroître lentement mais sûrement la
ruine des citoyens.
Lautre joueur, cest
bien sûr « le marché », institutions financières et multinationales
chaque jour plus énormes, et qui de surcroît se livrent entre elles à un jeu
de massacre titanesque et permanent. Ces rachats des entreprises les unes par
les autres obéit encore ici à cette même logique qui fait que le plus riche a
le plus de chances de gagner : ces rachats et ventes en cascade ne
constituent pas un jeu pervers auquel samuseraient les financiers, cest une
« nécessité vitale » à lintérieur de cette spirale.
À la
table de jeu (on utilise plutôt lexpression « réunion au
sommet »), ce sont maintenant elles qui dictent les règles à lautre
joueur : les Banques Centrales et les Institutions financières
internationales (FMI, etc.) ont commencé par exiger dêtre indépendantes des
pouvoirs publics et nobéissent plus maintenant quà elles-mêmes. Ainsi à la
table de jeu, les deux joueurs sont clairement indépendants, lun édictant
les règles que lautre est sommé dappliquer.
Il nest évidemment pas question de plumer
ladversaire : la partie sarrêterait et la possibilité de gain aussi.
Pour que la partie continue, il faut comme au poker prêter à lautre joueur, et lon utilise la
technique brillamment mise au point chez nous il y a quelques décennies par
le Crédit Agricole : prêter au paysan à un taux lui évitant la faillite
(la banque y perdrait de largent), mais suffisamment élevé pour quil ne
puisse rembourser son prêt quà laide dautres prêts renouvelés aussi
longtemps quil est possible (car sil arrive à rembourser son prêt, la
banque perd un client).
Les gouvernants nont aujourdhui plus dautre choix que dobéir
aux règles fixées par le marché : privatiser, cest à dire brader le
patrimoine public au-dessous de sa valeur, au prix fixé par lautre joueur. Accepter,
sous menace de délocalisation, que telle grosse entreprise ne paie ni
lURSSAF ni lélectricité. Se résigner à voir les employés jetés à la rue par
paquets de 10.000, au nom de la compétitivité. Supprimer tel ou tel service
public sous prétexte de non rentabilité, tout en étant incapable de définir
ce quest la rentabilité dun service public, ou au contraire, dans la plus
cynique incohérence, vendre telle entreprise de transport aérien, cette fois
précisément parce quelle est rentable. Mettre en place par une simple
ordonnance un nouveau « contrat de travail » qui nen est que la
négation et rend nul et non avenu tout ce qui avait été péniblement élaboré
jusquici. Combler, à marche forcée, et aux dépens des plus faibles, le
« trou de la Sécu », ce trou grâce auquel depuis soixante ans des
dizaines de millions de citoyens ont pu naître, se soigner et mourir dans la
dignité, afin que, débarrassée de son « trou », la Sécu, dont le
budget fait saliver plus dun rapace, soit enfin vendable.
Les gouvernants, affirment,
péremptoires et avec force effets de menton, quils entendent que ce soit
ainsi. Ils ne sont que marionnettes grotesques. Il y a quinze ans, en URSS,
les choses avaient été plus discrètes et plus rapides : il avait suffi
dune seule nuit pour que tout le pays, fruit de soixante-dix années de
larmes et de sang, fût bradé aux prédateurs de la planète.
Les
« experts » affirment quen dessous dun seuil de croissance donné,
léconomie seffondre. Cest oublier une autre loi simple et évidente : cest
précisément lorsquune économie ne survit quen saccroissant quelle est
mathématiquement instable et vouée à seffondrer. On ne peut pas
survivre en bétonnant chaque année 3% de terres en plus, en brûlant chaque
année 3% de pétrole de plus (et dans le même temps déclarer quon va limiter
les rejets dans latmosphère !). Ce ne sont pas les citoyens qui réclament plus de
croissance, plus de productivité : celle-ci est exigée par les mécanismes de
rémunération du « marché », mais elle conduit inéluctablement au
désastre. Cest en examinant comment une nation vit en équilibre
avec les autres nations, ou comment une civilisation vit en équilibre avec
son environnement quon peut prédire ses chances de survie.
On juge surtout une civilisation à la manière dont elle
traite les plus faibles : les femmes, les handicapés, les vieux, les
enfants, les arbres, les animaux, et non pas les traders et
autres golden boys. On a
compris que sans limitation des mises, le prince saoudien ne se contenterait
plus de jouer à la roulette : en une soirée il coulerait le casino,
devenu moins riche que lui. Sans délimitation du terrain de jeu, sans règles
strictes non pas édictées par quelque compassion envers les plus fragiles,
mais découlant du simple bon sens, le système actuel nest pas viable. Laccroissement des inégalités entre les
nations, et à lintérieur des nations entre les citoyens, nest pas une
fatalité que lhomme devrait subir sans pouvoir y remédier, mais résulte du
fait d'avoir transformé le marché en un vaste tripot. La loi des jeux de
hasard ne devrait pas régir l'économie.
Les
gouvernements sont mandatés pour édicter ces lois simples et les faire
respecter.
Comme il nest pas
possible de limiter le montant des transactions, il est indispensable de
freiner laccroissement des inégalités par la redistribution : taxation des transactions financières
(proposition du Dr Tobin) et
imposition progressive
des plus-values. Mais force est de constater quils font exactement le
contraire, quils soient de gauche, de droite, du centre ou dailleurs.
Chacun sait que la
TVA, impôt (sur les dépenses) qui a lavantage dêtre « indolore »
et représente 45% des recettes de lÉtat, est un impôt inéquitable, puisquil
est à taux fixe (19,6%) et frappe donc plus durement ceux qui ont le moins de
ressources. Symétriquement, et pour la même raison, un taux fixe dimposition
(sur les revenus) est inéquitable. Cest déjà le cas dans certains pays. On
ne plus prétendre freiner les inégalités : mathématiquement on les
accélère.
Les
gouvernements portent de ce fait une très lourde responsabilité face à
lavenir, car ils vont contraindre les citoyens à prendre eux-mêmes leur
destin en main. La politique actuellement affichée de « LÉtat pour personne et les Restos du Cur pour tous »
(aux États-Unis : lArmée du Salut
et autres charities) peut faire illusion et maintenir pour un
temps la paix sociale, mais elle nest que la négation de la Politique, au sens grec du terme. Lhistoire
enseigne quau delà de certaines limites, impossibles à estimer, les citoyens
ne se laissent plus gruger sans réagir. Elle enseigne aussi que les conflits
sont imprévisibles, et une fois déclenchés, impossibles à maîtriser.
Claude Plathey, informaticien retraité.
Note (Agence Reuter), lundi 10
octobre 2005 :
Le prix Nobel d'économie 2005 a été attribué à l'Américain Thomas Schelling et à
l'Israélo-américain Robert Aumann
pour leur théorie de "décision interactive" ou "théorie des
jeux".
Leurs études
ont trouvé des applications dans des domaines aussi divers que la sécurité,
la formation des prix sur les marchés, les négociations politiques et
économiques.
La théorie
des jeux a été amorcée dans des textes datant de la fin des années 1940. Thomas Schelling, aujourd'hui âgé de
84 ans, l'a utilisée pendant la Guerre froide pour expliquer des phénomènes
tels que la sécurité mondiale ou la course aux armements. Travaillant sur ses
idées, Robert Aumann, 75 ans, s'est
servi de l'analyse mathématique pour souligner les différentes options dont
disposait un pays contre un ennemi pendant les périodes de conflit.
Remarque :
La théorie des jeux ne date pas des années 1940, mais de la fin du XVIII°
siècle.
|
Lexpression
« vendre son âme au diable »
écorche forcément la bouche dun athée, mais limage philosophique est si forte
quelle simpose pourtant :
Accepter la publicité dans son journal, sa radio, sa télé, nest-ce pas vendre son âme au diable, programmer la
perte de son indépendance, un bâillon sur sa liberté dinformer, sur sa liberté
de ton et, finalement, au plus profond de soi, labandon de son esprit
critique ?
Nest-ce pas accepter de devenir un
pantin ? Au mépris des plus importantes valeurs humaines.
Accepter de la bourse le financement de son entreprise, nest-ce pas vendre son âme au diable, programmer la
perte de son indépendance, un bâillon sur sa liberté de choix dinvestissement
et, finalement, labandon du respect des hommes avec qui lon doit pourtant
collaborer pour réussir ?
Nest-ce pas accepter de devenir un
pantin ? Au mépris des plus importantes valeurs humaines.
Aller chercher pour son parti un financement politique par des entreprises,
nest-ce pas vendre son âme au diable,
programmer la perte de son indépendance, de sa liberté de contraindre les plus
forts pour protéger les plus faibles et, finalement, de sa capacité à
représenter les individus ?
Nest-ce pas accepter de devenir un
pantin ? Au mépris des plus importantes valeurs humaines.
Quel est le bilan coûts avantages de la bourse, de la publicité et du financement
privé des partis ?
Comment se débarrasser de la bourse, de
la publicité et du financement privé des partis ?
Est-ce que la gangrène nest pas déjà trop avancée pour se soigner ?
Laliénation consentie à largent est
sans doute un rouage essentiel de la servitude
volontaire.
Si on continue à sen foutre, on va bientôt voir revenir la police
politique et la torture dans les prisons où personne ne vous entend crier.
Ne souriez pas, on y est déjà aux
États-Unis, (« grande nation démocratique, pays de la Liberté, notre sauveur »
si on en croit nos éditorialistes, complices de fait) alors que même la prison y est aujourdhui privatisée, que la torture y est délocalisée (les USA envoient torturer leurs
terroristes présumés en Égypte ou dans des contrées où il y a moins de gêneurs droitdelhommistes) et la protection des individus y est en chute
libre avec un « Patriot Act »
proprement terrifiant à qui nos brillants éditorialistes naccordent leur précieuse
attention que le temps dun éditorial : mais après léditorial, les
terroristes présumés de Guantanamo,
parmi lesquels, évidemment, il y a des innocents, emprisonnés sans jugement
et sans défense dans le plus grand secret, après léditorial complice de
fait, donc, ces innocents continuent à crier sans que personne ne les entende.
Il faut entendre les nombreux américains
qui protestent avec la dernière énergie sur ce que le culte du pognon fait de
leur démocratie. Ne pas confondre les américains avec ladministration
américaine corrompue et son système de propagande médiatique de mieux en mieux
rodé pour institutionnaliser la servitude volontaire.
Il y très peu de pays (et dépoques) où
les humains se sont mis à labri de la violence arbitraire. Nous avons cette
chance, mais cest très fragile et nous sommes en train de reculer rapidement
vers une société sécuritaire qui risque fort décrabouiller les individus un
tant soit peu hors norme.
Quand jentends le
Ministre de lintérieur durcir le ton et prôner la sécurité à tout crin, et les
"médias de la peur" qui lui servent de rabatteurs pour que nous
acceptions, terrorisés, de perdre nos libertés individuelles, je sens bien que
lexemple américain est emblématique dune dérive dont nos institutions ne nous protègent
pas. Nos institutions
devraient, autant que possible, interdire à largent et au pouvoir de corrompre
nos représentants.
Pour écrire des
institutions qui assurent un contrôle réel des représentants, il est vital
quelles ne soient précisément pas
écrites par ces représentants eux-mêmes. La seule façon décrire des
institutions vraiment protectrices des individus est de les écrire nous-mêmes, en mettant de côté pour quelque temps
les professionnels de la politique, le temps de fixer les règles fondamentales.
Une
nouvelle version du document « Principes
protecteurs dune bonne Constitution
» est disponible. Je viens
surtout de rédiger un petit texte à propos du droit de propriété dans nos institutions. Voici le texte ajouté (pages 18 et 19). Quen pensez-vous ? Je déraille ? :o)
|
Une sorte de pensée unique nous apprend dès
lenfance, comme on inculque un catéchisme, que le droit de propriété est
fondateur, intouchable. À tel point
que la Déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 le pose en droit "naturel et imprescriptible"
(article 2), puis "inviolable et
sacré" (article 17).
Cest pourtant
peut-être une erreur grave dans la hiérarchie
des valeurs.
Bien sûr, le droit de propriété est important, mais en le
plaçant avant même le bonheur des hommes, de tous les hommes,
avant même le respect des autres, le respect de la non douleur des autres,
alors oui, on admet, on organise, on
programme le malheur des hommes, le malheur du plus grand nombre, y
compris dailleurs celui de la plupart des propriétaires eux-mêmes qui,
souvent, sont aussi des travailleurs.
Pour donner une
très précieuse liberté à tous, on a su la tempérer :
on nest pas libre de faire nimporte quoi, on nest pas libre de tuer, pas
libre de voler, on nest pas libre de tricher, violenter, etc. Ce sont ces limites qui garantissent au
plus grand nombre une certaine liberté, une liberté raisonnable.
Il faudrait tempérer le
droit de propriété, comme on a su tempérer la liberté, pour assurer à
tous un droit de propriété raisonnable, au lieu dun droit de
propriété de barbare, complètement immoral, laissant le champ libre à tous
les égoïsmes les plus primaires.
Je ne suis
pourtant ni collectiviste, ni révolutionnaire :o)
Le Conseil dÉtat
lui-même admet dans sa jurisprudence des « limitations
légitimes » au droit de propriété, droit important certes, mais qui
ne mérite sûrement pas une prééminence absolue sur toutes nos valeurs, sauf
évidemment pour ceux qui possèdent déjà beaucoup et qui ne veulent rien
perdre.
Comme tout le
monde, je tiens au droit de propriété, à la fois comme un excellent moteur
de motivation qui incite à leffort, et surtout comme une garantie de
tranquillité pour lavenir : quand un individu est propriétaire, il
peut envisager lavenir, le sien et celui de sa famille, de façon sereine, à
labri de léviction. Il a lesprit plus libre pour philosopher et
sélever :o)
Mais je tiens
plus encore au bonheur des hommes,
celui pour lequel le droit de propriété nest quune condition, pas un
droit supérieur.
On va me répondre
que "lenfer est pavé de bonnes
intentions" et que les pires dictatures se sont appuyées
idéologiquement sur le projet fou du bonheur pour tous, on me dira quil est
dangereux de vouloir le bonheur des gens à leur place, que lidée du bonheur
est personnelle
Mais ce rappel des échecs passés ne fait pas la démonstration
quil faut cesser de chercher les conditions du bonheur du plus grand nombre.
À lévidence, ce nest
pas parce quon a échoué jusquà présent quon échouera toujours.
Dans ma réflexion sur des institutions vraiment protectrices
des individus, je cherche donc le
principe cardinal, celui que tout le monde saccorderait à placer au-dessus
du droit de propriété et qui dominerait ce dernier quand il le faut.
Ce principe idéal
nest pas le droit à la vie car la vie peut être une vie de souffrances, comme on le voit partout, pour le plus
grand profit des propriétaires jouissant dun pouvoir exorbitant. À quoi bon
la vie si cest une vie en larmes ? On voit bien que ce droit à la vie,
déjà souvent reconnu et protégé dans les institutions
"démocratiques", ne fait
pas le poids devant un droit de propriété déchaîné.
Non, ce qui compte absolument, le vrai principe "solaire" qui devrait
surmonter tous les autres, celui dont la force affirmée et contrôlée
règlerait tous les problèmes essentiels de la planète, cette règle de vie à
mettre en première place parce quelle entraîne avec elle toutes les vertus,
cest le respect.
Respect de lautre comme une
règle absolue et universelle, intemporelle et sans exception, car ce respect
rendrait possible la précieuse ataraxie (absence de souffrances, objectif de lépicurisme si bien expliqué et
défendu par Michel Onfray :o)
Concrètement et
par exemple, la propriété placée en valeur première, supérieure et
incontestable, donne aux propriétaires des entreprises une force aussi totale quinjuste.
Les propriétaires
des entreprises ont tous les pouvoirs et disposent donc librement de loutil
de travail des autres. Et les malheureux salariés ne peuvent rien dire parce
que limportance cardinale de leur travail nest proclamée ni défendue
sérieusement nulle part.
La production de richesse exige du capital,
certes, mais aussi beaucoup de travail !
Pourquoi seule la propriété du
capital donne-t-elle du pouvoir dans lentreprise ?
Probablement
parce que ce sont des propriétaires qui écrivent le droit depuis
longtemps.
Pour linstant,
on donne 100% du pouvoir aux personnes qui ne détiennent que 50% des moyens
indispensables à la création de richesse (facteurs de production).
Je trouve
profondément injuste, et je ne suis pas le seul, que des entreprises soient
vendues au plus offrant sans que les salariés (à qui lentreprise doit
pourtant beaucoup de sa valeur) naient rien à dire, traités vraiment comme
des pions, comme des objets.
Le pouvoir dans les
entreprises (celui de vendre,
notamment) devrait être partagé
(50-50 ? 60-40 ?) entre les propriétaires (facteur capital) et les
salariés (facteur travail).
Ce droit de
propriété, rendu expressément prépondérant dans nos institutions et écrasant
dans les rapports humains, a ouvert la boîte
de Pandore doù sest échappé la
concentration du capital qui produit les monstres que sont les
multinationales, "personnes" morales psychopathes qui nous
alièneront ou tueront tous (même les plus riches !) si nous les laissons
faire.
De la boîte de Pandore ouverte par la
priorité du droit de propriété sur nos principales valeurs, sont également sortis
lhéritage et la confiscation progressive, génération
après génération, des richesses par quelques familles de privilégiés, parmi des peuples eux aussi privilégiés,
qui accumulent sans mérite ni
limite, au mépris de la plus élémentaire justice sur la Terre.
On va dire que je
suis un communiste, un collectiviste, et que ce sont là de
vieilles rengaines, mais ce nest pas du tout ça : je tiens au droit de
propriété et je redoute un État tout puissant comme on craint la peste, ma
quête de contre-pouvoirs systématiques en est la trace.
Mais quest-ce qui nous oblige à choisir entre deux extrêmes
mortifères ?
Est-ce quon est condamnés à choisir
entre la négation du droit de propriété et la religion du droit
de propriété, aussi malheurogènes
(sources de malheur :o) lune que lautre ?
Ne pourrait-on pas chercher une voie médiane, intelligente,
respectueuse ?
Lobligation de respect
comme règle de vie supérieure à toute autre semble donc capable dentraîner bien
dautres vertus derrière elle. Mais en
plus, on peut la placer en tête parce quelle semble ne faire courir aucun risque dexcès, ce quon ne peut pas dire
de la propriété, de la liberté ou de légalité.
Avec le respect comme valeur
cardinale, pas de dérive oppressive possible.
On réalise donc ici limportance
de lordre dans lequel on place nos valeurs, nos principes :
de la même façon que légalité entraîne la liberté (et pas
linverse !), le droit de propriété, comme la liberté, devrait céder
le pas devant le respect.
Je propose de
remplacer « Liberté, Égalité, Fraternité » par « Fraternité,
Égalité, Liberté ».
Ça change tout, non ?
Pour formaliser
cette nécessaire pondération du droit de propriété, on pourrait peut-être
utiliser le droit au travail,
(celui dont le TCE voulait nous priver en le remplaçant par le droit de chercher du travail), droit au travail quil faut
peut-être porter au pinacle, aux côtés du droit de propriété, à égalité dimportance
pour permettre dimposer dans lentreprise un partage des pouvoirs entre
tous ceux qui participent à la création de richesse, propriétaires
et salariés (notez que je nai donc pas du tout envisagé limbuvable dictature du prolétariat qui serait
évidemment un excès inverse à celui dénoncé).
Indépendamment de
ce qui serait décidé au niveau institutionnel, le pouvoir exécutif de
lentreprise, comme aujourdhui, pourrait continuer à être délégué à des managers, mais ceux-ci, au lieu de
diriger lentreprise sous le seul contrôle des propriétaires, devraient être
naturellement sous le contrôle des propriétaires et des salariés, un
peu comme dans les SCOOP.
Si, pour la
première fois, on pose enfin cette vieille question directement aux citoyens
modernes, on peut voir apparaître une autre norme supérieure que celle quon
connaît depuis la nuit des temps où seuls des propriétaires ont écrit les
lois :o) Cest sans doute dangereux
mais pour qui ? :o)
|
Jai
laissé cette proposition de limitation institutionnelle du droit de propriété
dans la dernière partie, celle des principes quon ne peut pas proposer à tous
les peuples sans déclencher une polémique.
Dans
ce document, je cherche en effet les principes qui mettront vraiment tout le
monde daccord (sans polémique) pour nous protéger avec des institutions
vraiment faites pour tous et pas pour une caste à part.
|
Extraits
dune émission de radio très intéressante : « Là-bas si jy suis » du 15 septembre 2005,
« Les chiffres du chômage », http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=737 :
François Chevalier (stratégiste chez VP
Finances) :
« Il faut savoir que le pire
ennemi des profits, cest le plein emploi, or on est loin du plein
emploi. »
Thomas Coutrot (économiste) :
« Cest une vieille histoire, le chômage a toujours été employé, dans
les économies capitalistes, par les entreprises, par les employeurs, pour
calmer les revendications des salariés qui sont en place en leur montrant la
file dattente à la porte de lentreprise et en leur disant "si vous nêtes pas content, il y en
a dautres qui prendront volontiers votre place", ça cest aussi
vieux que lhistoire du capitalisme. Ça a trouvé des nouveaux noms :
aujourdhui les économistes aiment bien parler de "chômage déquilibre"
Selon les économistes libéraux,
cest le taux de chômage qui est nécessaire pour calmer les revendications et
empêcher les hausses de salaires et donc empêcher linflation
|
|
Un certain
nombre dexperts de lOCDE estiment que le chômage déquilibre est autour de 8
à 9 %, autrement dit il nest pas souhaitable, dans létat actuel des choses
en France, que le chômage baisse en dessous de ces niveaux, 8-9 %, parce que
cela risquerait de réveiller les revendications et donc de réveiller le démon
de linflation, qui est quelque chose
dont les investisseurs financiers ont horreur.
Sauf si on
arrive, comme ça a été le cas aux États-Unis dans les années 80, à casser
suffisamment les organisations syndicales et les conventions collectives
pour que, même à 4% de chômage, les salariés ne soient pas en mesure de
revendiquer des hausses de salaires. En France, on ny est pas encore
»
Laurence
Parisot (présidente du MEDEF) : « Je pense que le chômage
est une véritable honte, parce que ça fait 25 ans que notre pays bat des records
de taux de chômage, il faut en France libérer, libéraliser, le marché du
travail. Notre conception en matière doffre et de demande de travail est
beaucoup trop rigide, on nest pas adaptés à léconomie daujourdhui qui est
une économie à laquelle il faut réagir rapidement, et il faut que lemploi
sadapte à lactivité et non pas linverse. »
|

|
Quand
lhypocrisie le dispute à lindécence
Nos vieux
"représentants" professionnels jurent quils luttent pour lemploi, ils
clament que le chômage est leur cible principale. On découvre sur cette affaire
centrale du chômage que ce sont tous des menteurs et que nous navons plus de
prise sur eux car cest toute la caste, de gauche à droite, corrompue par le
pouvoir trop longtemps exercé, qui se protège contre les initiatives
citoyennes : cest à peine croyable, en
douce, ils respectent tous
strictement un objectif minimum de
chômage que leur suggèrent les plus grandes entreprises privées pour
maintenir un bon taux de profit, et la lutte que nos soi-disant
"représentants" mènent "pour
lemploi" est en fait une lutte "pour
la précarité de lemploi", pour remplacer, via le chômage, un maximum
demplois stables par des emplois précaires de substitution.
En douce et en vitesse : la
précarisation absolue du CNE a été imposée par ordonnances, cest-à-dire quun exécutif tyrannique écrit et exécute le droit
tout seul, sans contrôle parlementaire, et en août, pendant que tout le
monde est en vacances. Ces gens sont des
bandits !
Avec la
complicité dun groupe stratégique de journalistes, éditorialistes
néo-libéraux, qui ont investi les rédactions et qui martèlent tous les jours,
sans contradicteur, que « cest
inéluctable ».
Cette
précarité touche aujourdhui directement près de la moitié des salariés en
France et elle ne cesse de se généraliser.
Mais quand va-t-on enfin se mettre en travers ?
Sommes-nous
capables de résister ? Pour linstant non, car notre
"démocratie" nest encore quune supercherie sur bien des aspects.
Pas tous les aspects, bien sûr, car la liberté de sexprimer et les élections
ne sont pas rien. Mais elles ne sont quune étape vers une authentique
démocratie.
Espérons
que les responsables ne sont pas "tous pourris" et que certains élus
et certains journalistes auront le courage de nous aider à résister à la
régression politique voulue par les forces économiques. Il est important que les institutions donnent aux citoyens le pouvoir de se défendre
quand la situation est grave.
Après avoir lu larticle « Comment les
amis de Hollande truquent le congrès », dans Marianne
du 17 septembre 2005, on est écoeuré et on comprend quil est temps de renvoyer
tous ces vieux politiciens, pervertis par leur professionnalisme de trop longue
date, à une vie active normale et de les remplacer tous par des jeunes gens : http://non.au.liberalisme.tripod.com/.
Je reçois vos mails dépités, et je dois bien reconnaître que
cette malhonnêteté des éléphants du PS est à pleurer
Mais comment faire ?
Si on continue à les élire, on a exactement ce quon mérite.
Cest pourtant simple : il faut refuser délire un des
ceux qui voulaient nous forcer à dire oui
au TCE, cest tout. Ils ne nous défendront jamais contre les prédateurs
néo-libéraux, ils ne veulent pas dune démocratie réelle qui menacerait leur
pouvoir par des contre-pouvoirs, maintenant
on le sait.
Ils peuvent truander autant quils veulent leurs primaires
internes bidon, pour ma part, je considère maintenant les apparatchiks ouistes du PS comme des néo-libéraux
travestis, et des adversaires dune démocratie authentique. Au moins, ce débat aura montré au grand jour
toutes ces turpitudes.
Bombes à retardement,
choisies et fixées par nos propres "représentants" (16 octobre)
Les
nouvelles qui circulent sur le net à propos de la sécu sont très inquiétantes. Voici quelques liens qui montrent
que nos soi-disant "représentants", quils soient de gauche ou de
droite, ceux que nous avons élus pour nous protéger, ceux qui devraient
défendre nos intérêts, se préoccupent tous plutôt de brader nos
services publics à leurs copains du secteur privé.
Cest
à se demander par qui ils sont payés.
|
« Un
article paru dans Le Parisien du 15
novembre 2004 : '"Sécu :
Douste et le monopole. Philippe Douste-Blazy serait parfaitement informé de la fin programmée
du monopole de la Sécu.
Interrogé par le docteur Esquirol
sur la reconnaissance, par le ministère de la Santé, de l'abrogation des
monopoles en matière de protection sociale, afin de se conformer à l'Europe,
un de ses conseillers a eu le 29 octobre, une réponse limpide : "Le
ministère est parfaitement au courant, mais, pour le moment, le ministre nous
a dit que ce serait un suicide politique d'annoncer une chose pareille. Si le ministre annonçait la fin du monopole
de la Sécurité Sociale, cela soulèverait, dans l'opinion, une trop grosse
vague de protestations." »
La suite, très intéressante, est à lire
là : http://lille.indymedia.org/imprime_article.php3?id_article=1535.
Vous avez besoin
dune confirmation ?
Lisez « La fin du monopole de la Sécu ? »
(France Info, 29 avril 2005 - La
chronique de François de Witt) :
|

|
|
http://www.conscience-politique.org/cgi-bin/gestionnews/news2.cgi?id=dewittsecu : hypocrisie dun
appel au débat quand tout est déjà décidé
|
Labandon de la sécu, sans débat, au profit des grandes compagnies privées
dassurance est une véritable trahison de lidéal républicain. Qui
avait annoncé honnêtement cette félonie dans son programme politique ? Qui
ose même avouer que la trahison a déjà eu lieu ? Personne. Le
néolibéralisme avance masqué, et nous, bonnes poires, on fait confiance à nos
soi-disant "représentants".
Tous
ces professionnels du pouvoir, aussi bien les "socialistes"
(les guillemets servent de pincettes) que les UMP, sont constamment au contact
des hommes daffaires, qui savent évidemment bien choisir leurs "amis",
et on constate partout que cest plus lintérêt des puissants qui guide les
décisions politiques que lintérêt général.
Il est urgent que
nos institutions déprofessionnalisent les responsables politiques :
il faut limiter (interdire ?) le renouvellement des mandats.
À propos de la Sécu,
Jean-Jacques Chavigné vient décrire un article excellent :
« Sauver notre protection sociale en urgence
! »
Extrait :
|
La loi Douste Blazy du 13 août 2004
est une bombe à
retardement contre notre assurance maladie.
Cette bombe à retardement comporte un premier élément : une profonde modification des structures
de direction et de gestion de lassurance maladie.
Les Conseils
dAdministration (où les représentants des salariés sont minoritaires) sont
dépossédés des pouvoirs que leur avait laissés le paritarisme imposé par la
droite. Ces pouvoirs sont maintenant concentrés entre les mains du directeur
général de lUnion Nationale des
Caisses dAssurance Maladie (UNCAM). Ce directeur général a notamment le pouvoir de
fixer le " périmètre des soins remboursés ". Il pourra donc, ainsi, en fonction des
rapports de forces sociaux et politiques diminuer les soins à la charge
de lassurance maladie et augmenter la part des assurances complémentaires.
Cest le modèle américain que la droite veut nous imposer. Quimporte si le
dernier classement (en 2000) de lOrganisation
Mondiale de la Santé (OMS) faisait figurer au premier rang le système de
santé français et au 37ème rang celui des USA. Ce qui est déterminant pour la
droite, cest la volonté du MEDEF qui ne veut pas entendre parler
daugmentation des "charges" patronales mais veut, au contraire, ouvrir
largement le champ de lassurance maladie aux assurances privées.
Le deuxième élément, cest le
maintien du déficit qui, au moment où la droite le jugera
opportun, fournira lalibi nécessaire à la diminution du
"périmètre des soins" remboursés par lassurance-maladie. Les mesures
prises par Douste Blazy en 2004 ne
permettraient, en effet, de revenir à un équilibre des comptes de lassurance
maladie en 2007 que si "la responsabilisation des patients" et les
"bonnes pratiques médicales" permettaient une économie de 7
milliards deuros annuels.
Mais, la "responsabilisation des patients" ne repose
sur aucune expérience concrète. Au contraire, la réalité sociale nous fournit
deux exemples tangibles qui prouvent exactement le contraire.
Les USA tout dabord
où les dépenses de santé laissées à la charge des ménages représentent 22 %
des dépenses de santé et celles liées au paiement de primes aux assurances
privées à 33 % de ces mêmes dépenses contre respectivement 13 % et 11 % en
France. Si lon en croit les théoriciens de
la "responsabilisation des
patients" les Américains, doublement "responsabilisés" par
les sommes restant à leur charge et par laugmentation des primes
dassurance, devraient donc dépenser beaucoup moins pour leur santé que les
Français. Cest exactement linverse
qui se produit : plus de 14 % du PIB des États-Unis sont consacrés aux
dépenses de Santé contre 9,6 % en France.
Le deuxième exemple est celui des pays scandinaves où les dépenses de santé sont de lordre de 8 %
de leurs PIB alors que la plus grande partie des soins est gratuite. Il est
vrai que dans ces pays, la prévention
a une toute autre dimension que dans notre pays.
(
) La bombe à retardement est donc en place. Elle attend
pour exploser que le rapport de forces politique et social donne le champ
libre à la droite. Après les trois raclées
électorales subies par cette dernière et la proximité de la présidentielle,
lactuel directeur général de lUNCAM (ancien directeur de cabinet de
Douste-Blazy) fait profil bas. Il attend, à lévidence, une victoire de la droite
en 2007 pour accélérer la diminution du " périmètre des soins "
remboursé par lassurance maladie et faire la part encore plus belle aux
assurances complémentaires.
Lire ici la suite de ce très bon article : http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2772
|
Ce
qui se passe sur le front de lAGCS, cet exemple académique de trahison des populations par
leurs représentants politiques, est édifiant : lire tous les jours http://www.hors-agcs.org/agcs/.
Lisez aussi « Mon parti
politique est-il en conformité avec les règles de lAGCS ? »,
par René
BALME et Laurence Kalafatides.
Extrait :
|
(
) « Plus proche de chez nous, privatisation de lANPE,
de la Poste, de la SNCF, dEDF-GDF, dAir France, de France Télécom... et
tout récemment de la SNCM que Monsieur De
Villepin a décidé de brader au privé à 10 % de sa valeur réelle.
Tout cela est inscrit en filigrane dans lAGCS. Les ministres ne faisant que
suivre ou anticiper, selon le cas, les résultats des négociations. Faut-il
rappeler que rien, aujourdhui - hormis les règles de lOMC et celles, à venir,
de lAGCS - ne justifie quelque privatisation
que ce soit ou quelque ouverture du capital dune entreprise
publique.
LOMC, on le voit, ne porte pas seule la responsabilité de
cette politique de la terre brûlée. Nos
gouvernements sont largement complices, et chaque nouvelle négociation nous
dépouille un peu plus de notre héritage, que sont les services publics
et les acquis sociaux. LAGCS est un vol à main armée de stylo.
LAGCS ou le principe dirréversibilité
En 1997, le Sénateur Maurice
Lombard faisait remarquer que « la
signature de lAGCS entraîne une nécessaire
déréglementation des monopoles publics ». Monsieur Lombard a simplement oublié de préciser
quavec lAGCS, ces « nécessaires
déréglementations » sont irréversibles. Autrement
dit un futur gouvernement qui voudrait remettre ces services sous forme de
monopole public nen aurait pas le droit, sauf a dédommager chacun des 149
autres pays membre de lOMC qui en ferait la demande. Le budget de la nation
ny suffirait pas !
Les très nombreux candidats qui dores et déjà se bousculent
au portillon de lÉlysée devraient sépargner du sang et de la sueur. Si les
négociations en cours à lOMC aboutissent fin 2006 comme le souhaite Pascal Lamy, alors pour les prochaines
élections, nous auront droit à un
programme unique. Quelque soit la couleur politique du candidat, son
programme électoral tiendra en une phrase : « Les règles de lOMC, TOUTES les règles de lOMC, RIEN QUE les
règles de lOMC ».
Les fétichistes de la globalisation rétorqueront que lOMC ne
soccupe que de commerce et que les gouvernements sont libres de mener les
politiques quils souhaitent. Ceux là seraient bien inspirés de se souvenir
des propos de Mr Supachai, ex
directeur général de lOMC, « Nous ne devons pas oublier que lOMC a pour rôle dinfluencer les
politiques - et ladministration des politiques- autant des grands que
des petits pays ».
LAGCS et la privatisation de la
politique ?
Encore aujourdhui, nos candidats, présents, déclarés et à
venir (présidence, assemblée nationale, région, département, mairie...)
ignorent jusquà quel point lOMC « influence » les
politiques. Il faut lire en détail la
nomenclature de lAGCS, cest à
dire la liste des services soumis à laccord, pour mesurer lampleur des
dégâts. (
)
Lire la suite là : http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=1946...
|
On se demande si ce déclin
programmé de la démocratie va nous laisser inertes jusquau bout ou bien si on va enfin réussir à sarracher à
notre confiante et paresseuse mollesse.
Au passage, tout ça ne date pas
dhier. Je vous conseille aussi cet article du Monde diplomatique daoût 2005 : « Karl Kraus, contre lempire de la
bêtise », un appel à
résister signé Alain Acardo (on ne
mâchait pas ses mots, à lépoque :o)
Extraits :
|
Les médias disposent des moyens
dentretenir lillusion dune équivalence
entre liberté et liberté de la presse, alors que cette dernière signifie surtout
liberté des industriels qui possèdent la presse.
Sous lapparence du « débat
public », les journalistes dominants ont réussi à imposer leurs normes à
des militants et à des intellectuels.
Le satiriste Karl Kraus fustigeait déjà ces formes de « bêtise »
dans les années 1930.
(
) Se prostituer à lordre établi
Parmi les différentes catégories intellectuelles qui, de plus
ou moins bonne foi, se complaisaient à prendre la nuit pour le jour, et
travaillaient à croire et à faire croire que lordre nouveau nazi était,
sinon toujours absolument irréprochable, du moins contrôlable, amendable, et
donc acceptable, il y en avait deux en particulier qui fournissaient une
cible de choix à Kraus : les partisans de la social-démocratie et
les journalistes, chez qui cécité et surdité au réel composent une forme
de bêtise proche de lautisme.
Laptitude des sociaux-démocrates à emboîter le pas aux
nationalistes et bellicistes lors de la première guerre mondiale avait édifié
Kraus sur leur inaptitude politique
et morale à faire front. Où trouveraient-ils
la force de résister, demandait-il, « alors
que chaque fibre de leur être incline à pactiser » avec le monde
comme il va ? Aussi ne les croyait-il pas en mesure de sopposer à la
barbarie montante. Pour Kraus,
lessence même de la « bêtise »
social-démocrate, cétait le réformisme de principe, lillusion de croire
quon peut dîner avec le Diable, le refus systématique de laffrontement, la
volonté forcenée dintégration, le désir éperdu dêtre bienséant, de « mener une vie bien tranquille dans
une jolie petite opposition sécurisante », et lirrémédiable naïveté
de penser que les bandits den face allaient respecter ces beaux sentiments
et être assez raisonnables pour entendre raison.
Si on peut dire aujourdhui que les partis sociaux-démocrates
et ceux quils influencent nont pas su tirer de lexpérience dun siècle
dhistoire dautre enseignement que celui dun acquiescement encore plus délibéré à la dictature du
« réel » (ennoblie de nos jours en « logique de marché »),
que dire alors de lactivité de la presse et de ses journalistes, de cette « journaille libérale » pour
laquelle Kraus éprouvait une
exécration à la mesure du rôle essentiel quelle jouait dans lentreprise dabrutissement généralisé
des populations ?
Une grande partie du travail de Kraus, pendant des lustres, a consisté à lire attentivement la
presse de son époque et à en démonter savamment, méticuleusement, le
discours, pour en montrer toute limposture, à partir « de lusage quelle fait du langage, de la déformation du sens
et de la valeur, de la façon dont sont vidés et déshonorés tout concept et
tout contenu ». À ses yeux, le penchant naturel de la presse était
de se prostituer à lordre établi. Il prenait soin dailleurs de préciser : « Je mets la fille publique, du point
de vue éthique, au-dessus de léditorialiste libéral et je tiens
lentremetteuse pour moins punissable que léditeur de journal. »
Sa critique sadressait alors essentiellement à la presse
écrite. Il naurait rien à rabattre de sa sévérité aujourdhui, bien au
contraire. Tout au plus, compte tenu de lévolution sociologique de ce
secteur, de sa croissance explosive, de la concentration des titres, stations
et chaînes entre les mains dun petit nombre de groupes capitalistes,
admettrait-il peut-être de faire une
distinction entre la caste dirigeante
et éditorialisante du monde journalistique, quasi tout entière acquise à
léconomie libérale et au maintien de lordre idéologique, et larmée des simples exécutants,
dont beaucoup connaissent les affres de la précarité et dont quelques-uns se
battent courageusement, seuls ou avec leurs syndicats, contre
larbitraire patronal privé ou public et contre la tendance, plus prononcée
que jamais, à la prostitution de la
presse au pouvoir économico-politique de largent. (
)
La suite : http://www.monde-diplomatique.fr/2005/08/ACCARDO/12409
|
Le style de
lépoque était, disons
direct. Mais au
moins, on appelait un chat un chat.
Les gens qui nous conduisent à lAGCS comme
on conduit les veaux à labattoir, via lOMC, ne méritent pas dêtre
réélus : ils trahissent leurs électeurs. Que des millionnaires votent pour ces
politiques (UMP+PS=UMPS) est cohérent, mais que des gens normaux, salariés,
employés et cadres, votent ainsi et cautionnent cette politique de caste
richissime, cest incroyable. Jy vois une totale absence de contrôle : on fait complètement confiance à nos
représentants, on ne prend pas la peine de lire les plus radicales
critiques des politiques menées, jen sais quelque chose, jétais encore comme
ça il y a moins dun an, conditionné par le martèlement quotidien de la pensée
unique
Maintenant que
je me méfie des "grands" journaux, du "7-9" de France-Inter et de la télé, je me
réveille.
Le NAIRU, ça
réveille ! Notre peur est programmée par nos
"représentants" (14 octobre)
Tous les citoyens qui vivent de leur travail, et pas dune
rente, tous ceux qui se moquent pas mal dune inflation modérée parce quils ne
possèdent rien, ou si peu, mais qui se préoccupent prioritairement du chômage
parce que, simplement, leur bonheur de vivre et celui de leur famille sont
directement menacés par la peur qui grandit avec linsécurité sociale et la
précarité, tous ces citoyens laborieux feraient bien daller lire, imprimer et
relire ce nouveau blog passionnant :
« NAIRU, le Nom de la Ruse.
La face cachée du chômage. », http://lenairu.blogspot.com/
On y trouve une analyse plus fouillée et plus documentée chaque
jour, une prose claire et pétillante, des liens importants
Il va falloir consulter ce blog important tous les jours :o) Extrait :
|
« Le
chômage de masse depuis désormais 30 ans ne serait pas un Fléau Naturel, résultat
de l'ire d'une quelconque divinité toute puissante. Il se pourrait même qu'il
en soit venu à être intégré comme un élément
utile, indispensable et même planifié
par certaines instances humaines, pour faire pression sur les "fidèles" (encore appelés salariés) et
leur faire peur. Ce "Diable"
moderne servirait en outre une cause appelée lutte contre
"l'inflation". Car l'inflation, elle, serait le "Démon"
pour une autre catégorie de personnes : les investisseurs financiers et
les détenteurs de patrimoine. »
|
Un outil important à faire connaître
Il semble urgent de réveiller les autres et
de résister.
Grands principes dune
bonne constitution, vraiment protectrice (9 octobre)
Ça y est. Je me
lance enfin :o)
Vous trouverez sur la
page daccueil un lien vers un nouveau
texte, constructif :
« Les grands principes dune bonne
Constitution qui prouverait la guérison de notre démocratie »
Jai hâte de connaître vos réactions :o)
Est-ce que nous autres, citoyens de
base, de tous bords, allons avoir lénergie dentretenir ce débat entre nous,
non professionnels, sans lenjeu du référendum imminent, cest encore pour moi
un mystère.
Cette nuit, je suis fatigué, je doute :o(
On verra...
Je mettrai en place des forums en fonction de votre intérêt
pour la question ;o)
La servitude légale et
volontaire ne date pas dhier (8 octobre)
|
« Sil se formait une classe exclusivement au fait des
principes de lart social, des lois et de ladministration, elle trouverait
bientôt dans la supériorité de son esprit, et surtout dans lignorance de ses
compatriotes, le secret de créer des distinctions et des privilèges ;
exagérant limportance de ses services, elle parviendrait à se faire regarder
comme la protectrice nécessaire de la patrie ; et, colorant ses audacieuses
entreprises du prétexte du bien public, elle parlerait encore de liberté et
dégalité à ses peu clairvoyants concitoyens, déjà soumis à une servitude
dautant plus dure, quelle paraîtrait légale et volontaire. »
|
Philippe Buonarroti, dans « La conspiration
pour légalité, dite de Babeuf », 1828 (Éditions sociales, 1957,
p. 171), cité p. 199 dans le livre de Paul Alliès « Une constitution
contre la démocratie ? Portrait dune Europe dépolitisée. » (Climats,
2005).
À qui pensez-vous, vous, dans notre
France de 2005, quand Buonarroti vous
annonce déjà, depuis le début de son 19e siècle, cette classe
parasite si prévisible ? :o)
Citoyens debout contre
lAGCS et la directive sur les services (Bolkestein) (4 octobre)
Je relaie
ici un appel de Pascale Fourier, animatrice du site « Des sous
et des hommes » :
|
Message de Pascale
Fourier, animatrice de Des Sous
et des Hommes, émission
d'initiation à l'économie d'AligreFM,
93.1 en région parisienne, et sur le
Net : www.des-sous-et-des-hommes.org.
Bonsoir,
Ma vie professionnelle réelle m'oblige cette année à beaucoup anticiper
mes émissions. Ordinairement, par honnêteté vis-à-vis d'Aligre FM, la radio
associative de la bande FM parisienne qui me permet de faire les émissions
qui sont diffusées le mardi de 9h30 à 10h sur le 93.1, je ne mets pas les
émissions en ligne avant qu'elles ne soient diffusées, sauf quand il y a une
urgence, ce qui était le cas pour les émissions sur le Traité
constitutionnel... Or il y a là urgence....
Aussi vous trouverez sur le site, les deux émissions faites avec Frédéric Viale, coordinateur de la
Commission OMC/AGCS du mouvement Attac. La deuxième en particulier est très
inquiétante...
http://dsedh.free.fr/119_11_10_05_Frederic_Viale_1_sur_2.mp3
http://dsedh.free.fr/120_18_10_05_Frederic_Viale_2_sur_2.mp3
et la transcription de
l'émission la plus inquiétante: http://dsedh.free.fr/transcriptions/viale120.htm
Du 13 au 18 décembre se réunira à Hong-Kong la 6° Conférence ministérielle de
l'OMC, qui
sera précédée par des réunions préparatoires du 17 au 21 octobre. Cette
réunion de Hong-Kong devrait marquer une volonté d'accélération du mouvement
de libéralisation, en particulier dans le domaine des services, et l'Union
Européenne s'apprêterait à faire des concessions importantes. Or rien de
ce qui va se décider en notre nom n'arrive à nos oreilles, pas plus par
l'intermédiaire des médias que des partis politiques ou des syndicats (ou
alors, ils font peu de bruit...).
Le problème, comme pour le Traité Constitutionnel, est bien un
problème de spoliation de la démocratie : nous, français,
majoritairement, avons montré le 29 mai dernier notre désaveu des politiques
libérales. Le moins que l'on puisse demander, c'est que nos élus, les médias
s'emparent de ce sujet et le traitent en amont, avant que les choses ne
soient décidées, qu'ils favorisent ainsi le débat démocratique, et partant la
décision démocratique. Les décisions qui seront prises à Hong-Kong
engageront l'Europe, donc notre pays. Je vous invite donc à vous informer
d'une part, et d'autre part à demander aux médias de vous informer ;
je vous invite à interpeller vos élus : point n'est besoin pour cela de
connaître à fond le dossier, complexe, plein de paroles rassurantes émises
par l'OMC très probablement... ; il suffit de demander à vos
parlementaires européens et nationaux, aux partis politiques et syndicats de
s'informer et d'informer la population... C'est le minimum que l'on puisse
demander en démocratie.
Par ailleurs, il semblerait que la directive Bolkestein sera très
bientôt discutée (au niveau de l'Europe), contrairement à ce que d'aucun
nous avait dit lors de la campagne référendaire. Il faut suivre là aussi
l'affaire, interpeller nos élus, les médias, les partis politiques et les
syndicats. Vous pouvez trouver des renseignements notamment sur le site http://www.urfig.org/francais.htm (http://www.urfig.org/Bolkestein-moment-d-agir.doc)
où vous trouverez aussi des informations sur la Conférence de Hong-kong.
Dans la même série, il conviendrait de s'inquiéter de la "privatisation
d'EDF" prévue (le Monde
dixit) : l'affaire a été repoussée pour cause de mouvement social du 4
octobre...
On pourra peut-être me reprocher de sortir de mon rôle de
"journaliste" en appelant ainsi à l'action. Je rappellerai juste
alors qu'on a longtemps appelé les médias le 4ème pouvoir... mais
que pour que 4ème pouvoir il y ait, il convient d'anticiper,
d'informer en temps et en heure les citoyens de ce qui devrait être décidé en
leur nom de façon à ce que la démocratie ne soit pas qu'un vain mot. Je
demande juste d'être informée, que mes élus soient informés, et que la
décision soit démocratique. Je ne fais que tenir, bien modestement, mon rôle
de "journaliste" et mon rôle de citoyenne.
Pascale Fourier, animatrice de Des
Sous... et des Hommes, AligreFM.
|
Coup de main à Yvan Bachaud pour
imposer le référendum
dinitiative citoyenne (2 octobre)
Je relaie un appel dYvan Bachaud, bagarreur infatigable
pour quune Constituante vraiment citoyenne voie le
jour, sans politiciens professionnels,
par tirage au sort.
(Visitez son site http://www.mic-fr.org/indexf.html,
ses interpellations des "responsables" politiques de tous bords (sans
exception) sont intéressantes (voir mon message du 9 août) : quand il
sagit du pouvoir dintervention directe des
citoyens dans la vie politique (RIP), les membres de ce quil faut bien
appeler une caste politique
professionnelle mentent sans arrêt.)
Yvan Bachaud a besoin
daide, voici son appel :
|
Le 28.09.2005
Comment nous rendre un petit service
À diffuser largement
Merci
Le Mouvement pour lInitiative
Citoyenne est en train de mettre en place en France une « Assemblée constituante citoyenne française »
composée de 300 personnes tirées au sort sur les
annuaires de tous les départements français au prorata du nombre dinscrits.
Leur mission : préparer un
nouveau projet citoyen de Constitution européenne.
Dabord, nous cherchons de laide pour nous tirer au sort seulement 15 numéros (sans
la commune, sans les noms et adresses)
dans les 12 départements suivants. Il faut environ 7 minutes
J
Ardennes, Belfort, Cantal,
Corrèze, Creuse, Indre, Jura, Marne, Pyrénées Hautes, Tarn, Tarn et Garonne.
Ensuite, nous cherchons de laide pour nous tirer au sort 30 numéros dans les 28 départements
suivants. Il faut environ 15 minutes
J
PROVINCE :
Aisne, Charente, Cher, Côtes du
Nord, Eure, Eure et Loire, Landes, Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche,
Marne, Oise, Orne, Pas de calais, Pyrénées Atlantiques, Sarthe, Seine
Maritime, Sèvres (Deux), Somme, Vendée, Vienne, Vienne (Haute).
RÉGION
PARISIENNE :
Essonne, Seine Saint-Denis, Val
de marne, Yvelines.
COMMENT PROCÉDER.
1°Vous divisez le nombre de pages blanches par 15 ou 30 selon le
département.
Cela vous donne un nombre « X ».
2° Puis vous relevez le N° à la page 29, 3ème colonne, 3ème
ligne. Un N° de SIMPLE CITOYEN (pas une société ni même un médecin
coiffeur etc.) vous prenez donc le nom suivant si cest le cas à la 3ème
ligne. J
3° Vous ajoutez « X » à 29 et vous relevez le N° 3ème
colonne , 3ème ligne
jusquà avoir 15 ou 30 N° selon le cas du département.
Puis, soit vous menvoyez les infos par mail, soit vous mappelez et je
vous rappelle pour que vous me les dictiez. Il ny a que 6 chiffres, cest
très rapide.
Si vous
voulez vous charger dun département, contactez-moi, je vous dirai si le
département est toujours "libre" : y.bachaud@mic-fr.org, tél. : 08.73.80.65.02 (tarif local) ou 04.72.24.65.02 si cest occupé
Post scriptum :
Le Mouvement pour lInitiative
Citoyenne est une association totalement apolitique dont lunique
objet social est dobtenir linstauration du référendum dinitiative
citoyenne à tous les niveaux territoriaux de la commune à lUnion
européenne.
|
Rendez-vous des Zengagés à La Ciotat (2 octobre)
Les 13, 14 et 15
octobre 2005, le festival des Zengagés, à La Ciotat, nous offre un lieu de débat, une agora, un point de rencontres.
Vendredi
14, après les cours (18 h), je vous y rejoindrai avec plaisir :o)
Le site : http://les.zengages.free.fr/
et le programme : http://les.zengages.free.fr/programmeLESZENGAGES.pdf.
Au passage, si vous le pouvez, vendredi
14 octobre, à 10 h, je vous recommande le film essentiel « Argentine, mémoire dun saccage » de Fernando Solanas : lArgentine y
apparaît crûment comme un laboratoire du néolibéralisme, cest clairement ce
qui nous attend si on ne résiste pas.
On sort de ce film consterné,
bouleversé, révolté
réveillé.
Entretien avec une
journaliste espagnole (1er octobre)
Juste après le référendum, une journaliste espagnole, Ana Zarzuela, du magazine Cambio16, ma posé quelques questions
pour comprendre notre Non qui
paraissait étonnant, vu de létranger.
Ses questions étaient intéressantes. Elle ma autorisé à vous
rapporter notre entretien.
|
(30 mai 2005) Estimé M. Chouard,
Je suis Ana Zarzuela, du magazine espagnol Cambio16.
Peut-être vous le connaissez, cest un media spécialisé en politique
nationale et internationale, le plus vétéran magazine dactualité en Espagne.
Nous sommes en train danalyser le Non
français à la Constitution Européenne et les conséquences pour la
politique française et pour lavenir de lUnion Européenne. (
) Nous
souhaitons avoir votre opinion sur ce sujet, nous aimerions bien compter sur
votre avis (
). Je vous envoie quelques questions en espérant que vous
pourrez y répondre. Je suppose que vous êtes occupé, mais je suis sûr que
votre opinion sera très intéressante pour les lecteurs de Cambio16 en
Espagne.
Merci bien pour votre aide.
1. Pourquoi le Non a-t-il gagné en France, mère de
lUnion Européenne et moteur du processus constitutionnel ?
Le Non des
français peut très bien s'analyser, si on est de bonne foi, comme un
renouveau de l'idée européenne (et pas comme une fin), une appropriation du
projet européen par les citoyens eux-mêmes.
Nous sommes
nombreux à vivre cet événement comme une naissance, et pas comme une
mort. Il faut savoir entendre cela.
Quand ils lisent
le texte avec un il critique, les citoyens (de toutes nationalités) se
rendent enfin compte que, malgré les progrès indéniables d'un traité à
l'autre, la démocratie n'est plus qu'apparente dans les institutions européennes,
depuis longtemps, et que tous les pouvoirs sont hors du contrôle citoyen.
Le référendum
montre heureusement qu'on n'est pas obligé de valider cette évolution qui
s'est faite discrètement et, bien sûr, sans le consentement des citoyens
concernés.
Pour une fois
que le peuple peut dire ce qu'il pense de cette "post démocratie",
il serait fou de s'en priver.
Dire Oui au TCE,
pour le peuple, ce serait confirmer lui-même un recul des droits politiques
des citoyens, recul organisé depuis quarante ans à coup de traités (donc sans
lui) : ce serait se faire politiquement hara-kiri.
Par exemple, il
est inadmissible de laisser les États, à coups de traités, "monter"
au niveau international les choix de politique économique, car cela a pour
effet de priver les peuples de toute possibilité de retour en arrière (puisqu'on
ne décide plus au niveau national, et que le Parlement européen n'a aucun
pouvoir d'initiative) : on nous prive ainsi du "droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes" (principe important affirmé en 1789).
Mais pour que
cet acte de résistance soit possible, il faut qu'un vrai débat ait lieu et
que l'on demande leur avis directement aux peuples, et pas seulement à leurs
représentants.
Si j'ai bien
compris, ce débat n'a pas eu lieu en Espagne (il paraît que les Espagnols
n'ont pas reçu le TCE chez eux). Ce
débat occulté a bien failli nous arriver aussi (début septembre 2004, le
débat n'avait pas lieu en France, le Oui était naturellement à 60%, on vivait
sur un rêve).
1.1.
Quattendez- vous après la victoire du NON ?
Je ne me fais
pas trop d'illusions : on n'obtiendra pas rapidement de spectaculaires
résultats (un nouvelle constitution, courte et claire, authentiquement
démocratique et qui n'impose pas une politique économique).
Il faut imaginer
la difficulté pour de simples citoyens révoltés, même nombreux, de s'opposer
au chemin pris par tous les corps constitués.
Ce changement de cap, cette décision de construire une vraie Europe
politique démocratique de la même façon que se construisent toutes les
démocraties du monde (en demandant au peuple ce qu'il veut et en lui laissant
le contrôle des institutions), ce changement de cap, donc, ne pourra se faire
que si des hommes politiques se font rapidement le relais, fort et déterminé,
de la pression populaire.
On verra bientôt
si ces hommes politiques existent.
1.2. Vous
avez été protagoniste d´un surprenant mouvement social et politique à gauche.
Une sorte de réveil citoyen, de réflexion citoyenne collective, de
participation et représentation directe, un nouveau front de la gauche avec
les mouvements sociales, le mouvement antiglobalisation... Quest-ce quil a
changé ? Quest ce quil restera de tout ça ?
Les arguments
que j'ai développés ne sont ni de gauche ni de droite, ils peuvent être
compris par tout le monde : des institutions 'démocratiques' permettent
aux citoyens d'être tantôt de gauche, tantôt de droite, tantôt libéraux,
tantôt sociaux, au gré des élections.
Le problème des
institutions est au-dessus de la politique. Ce qu'on va décider ici va rendre
possible la politique. Si on se trompe (si on crée un parlement ligoté, par
exemple), il ne sert plus à rien d'avoir une réflexion politique (de gauche
ou de droite).
Le TCE prive les
peuples de ce contrôle politique en imposant le néo-libéralisme. Il n'est pas
étonnant qu'on s'y oppose.
Ce qui est
surprenant, c'est qu'on ait mis tant de temps à se "réveiller".
C'est sûrement à cause de l'ambiance médiatique qui valide cette organisation
tous les jours, à travers les "informations" (journaux, radios,
télés). Dans cette ambiance, on
n'imagine même pas contredire la pensée unique : si on en croit les journaux,
le libéralisme est une évidence, il est devenu "inévitable", et il
n'y a que des rétrogrades pour penser le contraire.
Mais on trouve
désormais des opposants au néo-libéralisme aussi bien à gauche qu'à droite.
Difficile de
dire ce qui restera de ce Non historique,
mais ce que je sens dans ma boîte aux lettres, c'est une forte
contagion : tous les gens normaux comprennent vite où est leur intérêt,
et ça dépasse les frontières, bien sûr :o)
2. Il semble
que les arguments des partisans du Oui sont plus simples et homogènes, mais
les arguments du Non sont plus variables et complexes. Pouvez-vous les
résumer ? Si nous écartons les votes de lextrême droite, de Le Pen et
les xénophobes, quel pourcentage des Non est le Non de la gauche? Quel
pourcentage de ce Non correspond au désir de punir à Chirac et Raffarin, et
quel pourcentage est la réponse aux problèmes européens ?
Moi, je trouve
le vote Non très homogène : on voudrait faire croire que nous n'avons pas lu
le texte alors que c'est exactement le contraire : les gens qui votent Oui,
le plus souvent n'ont précisément pas lu le texte et votent en confiance, en
pensant faire avancer l'Europe, alors que les gens qui votent Non ont lu,
analysé, décortiqué le texte, et plus on lit le texte, plus on comprend ce
qu'il organise (sans l'avouer clairement), et plus on a peur, et plus on vote
Non.
L'homogénéité du
Non, c'est le refus du texte proposé, clair et net, et c'est exactement ce
qu'on nous demandait.
Il y a des
catégories de Non, évidemment, mais il y a aussi de nombreuses catégories de
Oui : combien de gens qui votent Oui votent en se pinçant le nez (à
contrecur) ? (contradiction) Combien votent Oui en pensant donner des armes
pour le combat social, alors que d'autres votent Oui en sachant pertinemment
qu'ils neutralisent durablement le combat social ? (contradiction) Combien votent Oui avec un sentiment
d'avancer vers le fédéralisme, alors que d'autres votent Oui pour renforcer
le poids de la France (ce qui est un argument souverainiste, finalement) ?
Que de contradictions !
En fait, avec un
texte aussi long, compliqué et trompeur, il n'y a rien d'étonnant à ce que la
réponse simple, Oui ou Non, soit difficile à interpréter, mais il est injuste
de faire ce procès d'ambiguïté au seul Non.
Et le vote
"punition contre Chirac"
n'est pas du tout hors sujet par
rapport au TCE puisque la politique de Chirac
et la politique imposée par le TCE ont toutes les deux le même ADN : un
néo-libéralisme doctrinaire qui impose de tout déréguler, c'est-à-dire de
dépouiller les États de leurs droits d'intervention et d'interdiction. Il est donc artificiel et peu crédible de
prétendre dissocier les deux questions (même si, pour ma part, je n'ai pas du
tout développé ces arguments de politique intérieure).
3. Croyez-vous que le déficit de connaissance, la
défiance des citoyens et le sentiment quil sagit dun Traité de politiciens
et de bureaucrates, ont pu pousser le Non ? Pensez-vous que lUnion sera
capable de changer et solutionner ce déficit démocratique ? De quelle
façon ?
C'est
précisément le contraire : c'est le déficit de connaissance du Traité et des
institutions européennes qui conduit à voter Oui en faisant largement confiance à ceux qui
nous gouvernent, et c'est en revanche la connaissance méticuleuse du texte
proposé qui conduit à s'en méfier comme de la peste.
Il est facile
d'instaurer une réelle démocratie dès qu'on en a la volonté politique. On connaît bien les rouages qui protègent
les hommes (élections, contre-pouvoirs, indépendance des juges, etc.) :
en effet, ce sont les mêmes partout dans le monde, on n'a pas besoin d'années
pour trouver un compromis. Ce dont a
besoin un Polonais pour vivre en démocratie ressemble beaucoup à ce dont a
besoin un Espagnol, un Italien ou un Français.
Non, ici, c'est
la volonté politique qui manque, assurément, pour faire disparaître le
"déficit démocratique" (euphémisme délicat qui dissimule un vrai
scandale).
4. En Espagne quelques analystes font l'interprétation
suivante : c'est la peur qui a poussé le Oui et le Non. Les partisans du
Oui ont eu peur de lisolement de la France, de la rupture du laxe
France-Allemagne, du Traité du Nice... Et, de lautre côté, les partisans du
Non ont peur du libéralisme économique en France et dans lUnion, les
travailleurs ont peur de perdre le travail, de la réduction des salaires, de
la concurrence sauvage, de la perte du pouvoir citoyen à Bruxelles... Chirac
a peur du châtiment des électeurs, Hollande a peur de la gauche au PS, et
Raffarin a peur de ladieu. Quest-ce que vous pensez de cette
interprétation ?
Il y a
effectivement des peurs (légitimes) dans les deux camps.
Le débat,
superbe, qui a eu lieu en France, nous a permis de découvrir nos peurs, de
les comprendre, de les comparer, et finalement de trancher.
Nous avons eu l'impression
de vivre un grand moment de démocratie, un progrès de civilisation :
avez-vous déjà vu des millions de personnes simples se passionner pour leur
Constitution ? C'est un progrès pour l'Humanité, une politisation, au
sens noble du terme, des citoyens, qui deviennent ainsi des acteurs de leur
propre vie.
C'est beau. C'est joyeux. C'est constructif. Pas de quoi pleurer.
Ne croyez pas
les tristes sires qui voient là un recul ou un repli parce qu'ils ne croient
plus eux-mêmes en rien qui vienne du peuple.
5. Le Non
français est une gifle pour lEurope, pour l'actuelle carte de route
du voyage européen, ou seulement pour le texte du Traité ?
C'est peut-être
une gifle à ceux qui pensaient pouvoir imposer ce texte aux peuples sans même
qu'ils le lisent, mais ce n'est pas du tout une gifle pour l'Europe, c'est
exactement le contraire : enfin, l'Europe a trouvé des citoyens qui la
veulent, mais qui savent très bien ce qu'ils veulent et qui ne veulent pas de
cette Europe-là.
C'est une
supercherie, une mystification, une manipulation, de faire croire que le Non
français est anti-européen. C'est
n'avoir rien compris à ce qui se passe ici (ou plutôt faire semblant de
n'avoir rien compris, parce que c'est commode de caricaturer et de déformer
pour ne pas reconnaître qu'on a peut-être tort).
L'actuelle
'carte de route' est compromise, mais ce que disent précisément les citoyens,
c'est que la route était mauvaise.
L'Europe
citoyenne, démocratique, va peut-être naître de ce refus. Ne voyez-vous pas l'immense potentiel pour
les Européens ?
Seul un Non permettait d'ouvrir cette porte.
6. On ne peut pas arriver à la Constitution Européenne
sans la France et les Français, mais le référendum a dit que lactuel texte
na pas l'accord de la France et Bruxelles assure quon ne peut pas changer
le texte. Alors, tous les 25 pays de lUnion, nous sommes dans une impasse.
Maintenant quelle est la solution ? Bruxelles ne veut pas penser à un
plan B.
Un plan B qui
serait conçu par les mêmes qui ont conçu le plan A aurait toutes les chances
de présenter les mêmes défauts.
Il nous faut un
plan 2, inédit, original, et c'est à ça que de nombreux citoyens français
réfléchissent en ce moment.
Ce n'est pas
leur métier, il leur faut un peu de temps pour fixer leurs exigences
démocratiques et formuler une proposition crédible. Heureusement que nous avons l'Internet car la plupart des medias
nous gênent au lieu de nous aider, en ressassant un ressentiment stérile et
mauvais perdant, des reproches et des menaces.
Pourtant, nous
irions beaucoup plus vite vers une Europe qui satisferait tout le monde si
nous étions capables de nous réconcilier à l'issue de ce débat.
Pendant les
discussions, les Ouiistes et les Nonistes ont en effet souvent constaté
qu'ils sont très proches, ayant exactement les mêmes objectifs (une Europe
unie, forte et fraternelle).
7. Monsieur Giscard dEstaing a une proposition: un
nouveau référendum en France en 2006. Croyez vous que ça sera possible ?
Pensez-vous que ça peut être une insulte pour le peuple français ?
Absolument. Une
véritable insulte.
On retrouve, là
encore, un vrai mépris pour le suffrage universel.
C'est bien le
même ADN que celui du TCE.
Ce texte est
mauvais pour les peuples qui ont pourtant besoin d'un texte.
Il faut donc en
faire un autre, plus respectueux des peuples.
8. Les partisans du Non considèrent que la Constitution
Européenne veut constitutionnaliser le libéralisme économique en Europe, mais
croyez-vous que le Non de la France va arrêter ce processus ? Larticle 1-3 dit que l´Europe doit être
une économie sociale, quelle est la valeur que vous donnez à ça ? Quelle
est lalternative que vous proposez ?
À l'étude,
l'expression 'économie sociale de
marché' s'avère être un gros mensonge de la Constitution. Si on lit simplement
le texte, on a l'impression que le mot sociale
tempère, adoucit, le mot marché. Mais si on cherche l'origine exacte de cette
expression, on trouve une doctrine économique (allemande) plus ultra
libérale, plus extrême que toutes les autres, et qui n'a donc rigoureusement
rien de sociale. Comme exemple de supercherie, on ne peut pas mieux
trouver. Le Traité est farci de ces
pièges qui ne se voient qu'après une lecture approfondie et recoupée
d'analyses complémentaires.
Ce Non n'est qu'une étape : on nous a mis
(sans nous consulter) dans la prison de Nice (après le couloir d'Amsterdam,
etc.), et on nous demandait de fermer nous-même la porte à clef, en jetant la
clef.
En votant
Non, on a refusé de fermer la porte de
Nice.
Mais il reste
maintenant à sortir de Nice.
Il est donc vrai
que voter Non ne suffit pas, mais
c'était la seule façon de commencer à sortir du piège néo-libéral.
Le reste est à
faire, mais la prise de conscience citoyenne, contagieuse à travers les
frontières, nous aidera sûrement à progresser : une conscience citoyenne
nouvelle devrait permettre de faire émerger rapidement des courants
politiques nouveaux, avec de nouveaux projets.
9. On dit, en général quune crise peut être une
opportunité pour la croissance et lamélioration. Cette situation va-t-elle
emporter une évolution de lidée de lEurope et sa réalisation ? Les
français seront-ils capables de faire
réfléchir ?
On dit parfois
que seul le désordre permet de véritables évolutions. Espérons que ce
désordre (très modéré) nous permettra de faire évoluer nos institutions,
aussi bien en France qu'en Europe, vers plus de contrôle citoyen des pouvoirs
institués.
10. Quel prix va payer Monsieur Chirac pour sa
défaite ?
Rien du tout :
en France comme en Europe, les acteurs politiques ne sont guère responsables
de leurs actes et rien ne permet, en droit, de forcer le Président à se
démettre avant les élections.
11. Quel est lavenir que vous voyez pour la gauche
française ? Maintenant elle est dans un processus de division qui semble
profond. M. Hollande va se rendre devant M. Fabius ? Le mouvement pour
le Non va prendre corps comme une alternative politique ou
social-citoyenne ?
Spectaculairement
désavoué par son électorat, Hollande
devrait démissionner et laisser la direction du PS à ceux qui représentent le
Non, mais là aussi, les responsables ne sont pas si responsables que ça, et
il faudra malheureusement une bagarre fratricide pour dénouer cette situation
déplorable.
Si les
socialistes n'avaient pas renoncé, comme les autres PS en Europe, à protéger
les gens contre le néo-libéralisme, on n'en serait pas là. Ce reniement historique est vécu comme une
faute, une 'trahison', par de nombreux sympathisants du PS qui n'ont plus
personne pour les défendre au centre de l'échiquier politique du pays. Ce choix politique délibéré des PS de ne
plus se battre contre l'ultralibéralisme ouvre un boulevard aux extrémistes.
12. Lespace politique français et les partis
politiques traditionnels sont cassés par cette crise ?
Oh, ils ont la
peau dure :o)
|
Lintégration forcée
continue, à linsu des européens (30 septembre)
Un article assez technique,
mais vraiment très intéressant sur le site www.libertepolitique.com :
« La Cour de justice contourne les traités européens
: dormez braves gens
»,
par François
de Lacoste Lareymondie :
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article.php?id=1355.
|
Dormez en paix braves gens
lintégration européenne se
poursuit sans vous. Et contre les décisions de vos gouvernements. Ce n'est pas
parce que le projet de traité constitutionnel est mort et enterré, avec J.-M.
Barroso, président de la Commission, comme dernier inscrit sur la liste des
fossoyeurs, que la machine s'arrête.
Le 13 septembre
dernier, sur demande de la Commission, la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE) a annulé une décision-cadre du Conseil relative à la
protection de l'environnement par le droit pénal (1). L'arrêt n'est pas passé
totalement inaperçu, mais sans qu'on prête assez d'importance au mécanisme qu'il illustre
: celui de l'intégration forcée qui
fonctionne à l'insu des Européens. Il faut y revenir pour souligner qu'au-delà de la
question immédiate de la répartition des pouvoirs, ce qui est réellement en jeu c'est la confiance que l'on peut
accorder aux traités et aux organes chargés de veiller à leur application.
Enjeu suffisamment grave pour qu'on crie " casse-cou " !
De
quoi s'agit-il ?
Le 27 janvier 2003, le Conseil a adopté à
l'unanimité de ses quinze membres (2) une décision-cadre par laquelle il
obligeait les États à adopter de façon concertée des sanctions pénales à
l'encontre des auteurs d'atteintes à l'environnement, tout en leur laissant
le choix des incriminations et des peines conformément à leur ordre juridique
interne. La décision énumère les agissements qui doivent être réprimés ; elle
les classe sur des échelles de gravité pour encadrer le niveau des peines
susceptibles d'être infligées ; elle règle enfin une série de questions de
compétence et de procédure juridictionnelles de sorte que les dispositifs
nationaux soient coordonnés. Pour fonder sa décision, le Conseil s'est placé
sous l'empire du troisième pilier du traité de Maastricht de 1992 relatif à
la coopération policière et judiciaire en matière pénale ; c'est-à-dire dans
un cadre intergouvernemental, requérant l'unanimité, en une matière qui n'est
pas communautarisée puisque le droit pénal relève encore de la souveraineté
des États.
C'est précisément ce fondement que la Commission a contesté. La
protection de l'environnement constitue un des objectifs de l'Union et fait
l'objet d'une politique établie (3) ; elle entre donc dans le cadre du premier
pilier du traité, celui qui est communautarisé, avec ses mécanismes propres
de décision (initiative de la Commission et vote par le Conseil à la majorité
qualifiée en co-décision avec le Parlement). Aussi la Commission en
tirait-elle argument pour faire entrer également dans ce même cadre
l'adoption de sanctions pénales au motif qu'elles en constituent un
complément indissociable.
Le raisonnement de la CJCE
On ne surprendra personne en disant que la Cour a suivi la Commission
et annulé la décision du Conseil. Mais il faut s'arrêter un instant sur son
raisonnement.
La Cour reconnaît certes qu'en principe, la législation pénale et
les règles de procédure pénale ne relèvent pas de la compétence de la
Communauté. Elle reconnaît également qu'il n'y a pas de précédent à l'intrusion
du communautaire dans le champ pénal, et que le contenu de la décision
attaquée est exclusivement de cette nature. Mais peu importe : elle écarte
ces objections en considérant que la Commission, lorsqu'elle estime que la
mise en uvre d'une politique commune (en l'espèce la protection de
l'environnement) appelle l'instauration de sanctions pénales complémentaires,
a le droit de passer outre et de se placer dans le champ du premier pilier,
donc d'obliger le législateur communautaire à " prendre des mesures en
relations avec le droit pénal des États membres et qu'il estime nécessaires
pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte ", moyennant
l'application des procédures correspondantes.
L'affaire
est grave
L'affaire est grave, et à plusieurs
titres. L'enjeu était considérable. Dans le
premier cas, la souveraineté des États maintenue dans une matière donnée
prévalait ; ceux-ci demeuraient maîtres des mesures de coopération à prendre
dans le cadre de la coopération intergouvernementale. Dans l'autre, la
logique communautaire justifiait par elle-même l'empiètement sur ce domaine
réservé nonobstant les textes contraires.
Emboîtant le pas à la
Commission, la Cour n'a donc pas hésité à contourner les souverainetés
nationales, préservées sur
une matière précise dans un traité ratifié par les États membres,
en faisant prévaloir son propre raisonnement, fût-il un peu spécieux, sur un
texte pourtant clair. De plus, elle l'a fait
en dépit de l'opposition expresse de tous les États membres qui
avaient adopté unanimement la décision contestée en connaissance de cause et
dont la plupart étaient venus la défendre devant la Cour.
En
d'autres termes, la Commission et la Cour se sont accordées pour substituer
leur appréciation à celle des États sur ce que ceux-ci entendent mettre en
commun et sur la façon dont ils entendent coopérer ; elles l'ont fait en
recourant à un principe qui, pour elles, domine tous les autres, celui de la
primauté de l'intégration communautaire qui doit commander tout le reste, de
gré ou de force ; elles l'ont fait en
toute impunité puisqu'en vertu du droit qu'elles ont elles-mêmes forgé, elles
sont à l'abri de tout recours sauf pour un État à ouvrir une crise
politique majeure et risquée
Une méthode hélas caractéristique et habituelle
N'imaginons pas
cependant que cet épisode soit exceptionnel. Le
point de départ se situe en 1964 lorsque, dans un arrêt " Costa contre
E.N.E.L. " (4) que certains ont qualifié de " coup d'État
juridique " la Cour a conféré aux normes communautaires une primauté
absolue sur les droits souverains des États membres, y compris en matière
constitutionnelle, en leur attribuant un effet direct dans leur droit
interne. Depuis lors, nombreux sont les exemples de cette prévalence à
laquelle les États ont dû se soumettre.
Pour la
Commission, l'intérêt de communautariser une matière est évident : dans ce
cadre en effet, elle tient le Conseil à sa merci puisqu'elle a le monopole de
l'initiative et qu'elle est maîtresse de la procédure, y compris devant le
Parlement européen lorsqu'il y a matière à co-décision. Les États membres
réunis en Conseil n'ont alors plus le choix que d'approuver le projet tel
qu'il leur est soumis, ou de le rejeter en bloc. Alternative impossible,
évidemment. À toutes fins utiles, je renvoie les sceptiques à un autre arrêt
récent de la Cour (5) qui a annulé les conclusions adoptées le 25 novembre
2003 par le Conseil, aux termes desquelles celui-ci avait suspendu les
procédures de déficit excessif engagées à l'encontre de l'Allemagne et de la
France et modifié les recommandations qu'il leur avait antérieurement
adressées : l'annulation s'est fondée sur le fait que, après avoir adopté des
recommandations, le Conseil ne pouvait pas les modifier ensuite sans une
nouvelle impulsion de la Commission qui, seule, dispose d'un droit
d'initiative.
Quant au mécanisme d'extension de ses compétences "
par voie de proximité ", la Commission en use continuellement.
Les exemples abondent et je me contenterai d'en citer un qui est d'actualité.
La santé publique n'est pas une matière communautaire. Qu'à cela ne tienne ! L'unification du marché intérieur permet de
toucher à tout, pourvu qu'on aborde la question par le bon bout. En
l'espèce, il s'agit d'un projet de réglementation des publicités figurant sur
les emballages alimentaires : la Commission a décidé d'y soumettre les "
allégations nutritionnelles " et surtout les " allégations santé
"(6), et d'interdire de tels messages lorsque les aliments dépassent
certains seuils (d'alcool, de matières grasses, de sucre, de sel, etc.) dans
le but explicite et politiquement porteur de lutter contre l'obésité. Pour
faire bonne mesure, la Commission prévoit même de s'adjoindre les services
d'une " autorité scientifique ". Le tour est joué : les
associations de consommateurs poussent à la roue tandis que les industriels
se battent sur le contenu des normes ; le Parlement a sauté sur l'occasion
pour entrer dans le jeu et se livrer à un débat de fond ; quant aux États
réunis en Conseil, ils sont piégés entre le rejet pur et simple avec le
risque politique correspondant, et l'approbation qui les dépossède un peu
plus (7).
Un problème de principe qui touche aux mécanismes
communautaires eux-mêmes
Entendons-nous
bien. La question n'est pas ici de savoir si telle norme alimentaire est
bonne ou mauvaise, ou si l'instauration de sanctions pénales à l'encontre des
pollueurs est souhaitable ou non ; ni de savoir s'il est ou non légitime de
communautariser ces matières. La question posée est celle de la confiance que
l'on peut accorder aux traités signés et aux instances chargées de les mettre
en uvre. Lors de la récente campagne référendaire, les défenseurs du projet
de traité constitutionnel accusaient de procès d'intention ceux qui mettaient
en doute les soi-disant garanties données aux États par telle ou telle stipulation.
L'expérience quotidienne montre que ce sont ces derniers qui avaient raison.
L'Union Européenne ne fonctionne pas comme cela est écrit
dans les traités.
En réalité, elle
fonctionne selon un mécanisme d'intégration
juridique à sens unique dont les traités servent de prétexte ou d'occasion :
comme tout se tient plus ou moins, la domination sans recours que se sont
arrogées la Commission et la Cour de justice, et le raisonnement par
attraction qu'elles ont développé aboutissent de proche en proche à tout
faire tomber dans le champ communautaire. C'est ainsi que, subrepticement,
les États et les gouvernements, pourtant seuls dotés de la légitimité
démocratique, sont dépossédés de leurs compétences au profit de ces deux
organes dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont d'essence
oligarchique et technocratique.
Tant que cette
captation n'aura pas cessé, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas posé
clairement le problème des pouvoirs de la
Commission et encadré davantage le
rôle de la Cour de Justice, l'engrenage tournera. Mais ayons
conscience qu'il aboutira inévitablement, tôt ou tard, qu'on s'en réjouisse
ou qu'on le déplore, à une rébellion des peuples : la schizophrénie actuelle
n'est pas durable, surtout après les élargissements récents. D'ailleurs,
n'a-t-elle pas déjà commencé ? Le risque grandit de jeter le bébé avec l'eau
du bain, et de donner raison aux Cassandre qui craignent de voir l'Europe se
défaire. L'enterrement du projet de traité constitutionnel n'y change rien,
bien au contraire : il remet au premier plan l'enjeu concret d'une réforme
nécessaire que les grands discours mystico-politiques avaient escamotée.
C'est pourquoi
nous persistons à penser que, pour conforter la construction européenne dans
un contexte qui a fondamentalement changé depuis cinquante ans, il faut
remettre à plat son fonctionnement, mais en partant du réel et non de schémas
théoriques, et qu'il faut le faire d'urgence.
Pour les notes
voir le site dorigine de cet article : http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article.php?id=1355
|
Lexemple suisse
pour ressourcer la démocratie européenne (29 septembre)
Un article court mais
intéressant dans le journal canadien Le
Matin :
« La Suisse, un
modèle pour l'Europe ? » http://www.matin.qc.ca/monde.php?article=20050802112845
|
« Et
si le modèle européen, c'était la Suisse ? L'Union européenne en
proie au doute n'a peut-être pas besoin d'aller chercher très loin des
réponses à ses questions. Au lieu de regarder outre-Atlantique, certains
universitaires lui conseillent de se pencher sur la Confédération helvétique.
En rejetant la Constitution européenne au printemps, les électeurs français
et néerlandais n'ont pas seulement enterré, ou presque, le traité. Leur
"non" a exprimé les doutes profonds de nombre d'Européens, qui
craignent de voir les technocrates décider de tout sans consulter les
peuples, s'inquiètent de devoir abandonner leur souveraineté ou redoutent de
perdre leur identité nationale noyée dans l'union renforcée.
Pour
certains universitaires, la Suisse recèle peut-être des solutions. Il y a
sans doute, disent-ils, des leçons à tirer
de ce petit pays du vieux continent, nation alpine farouchement indépendante
qui rassemble un mélange complexe de groupes ethniques et linguistiques dans
un intérêt commun de paix et prospérité. "L'échec de la
Constitution signifie que l'Europe va devoir tout repenser", estime Jonathan Steinberg, professeur d'histoire
à l'université de Pennsylvanie, spécialiste de l'histoire et de la culture
helvétique. "Les États de l'Europe seraient en fait mieux servis par une
forme suisse de fédéralisme". À
l'opposé de la tendance décriée de l'UE à prendre les décisions importantes
dans le secret des bureaux de Bruxelles, la Suisse entretient une tradition
de démocratie directe. Chaque année, au moins trois référendums nationaux
sont organisés sur les grands sujets. Et les "votations" locales
sont encore plus nombreuses.
La Suisse,
qui compte 7,4 millions d'habitants, a choisi le système confédéral.
Les petites communes qui gèrent les affaires locales sont regroupées au sein
de cantons, qui sont autant de micro-États semi-indépendants unis de façon
souple. Le gouvernement fédéral dans la petite Berne n'a ainsi que peu de
pouvoir comparé aux capitales des États plus centralisés comme la France ou
la Grande-Bretagne. "Ce qui rend ce système si original c'est qu'il
préserve l'identité fondamentale de la communauté", souligne Jonathan Steinberg, auteur de "Why Switzerland?"
("Pourquoi la Suisse?").
Certains ont
désigné les États-Unis comme un possible modèle pour l'Europe. Mais Daniel Kelermen, un expert du
fédéralisme de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne estime qu'un système
moins centralisé à l'helvète est sans doute plus compatible. "Si on
cherche des modèles, ce n'est pas forcément nécessaire de regarder de l'autre
côté de l'Atlantique", remarque-t-il. "On peut aussi regarder au
centre de l'Europe". Le modèle idéal ressemblerait ainsi "plus à la
Suisse qu'aux États-Unis à bien des égards". Pour lui, l'Europe ferait
bien de donner suite à certaines idées suisses, comme la dévolution du
pouvoir et le système collégial de
gouvernement, qui évite une trop grande personnalisation à la tête de l'État
ou du gouvernement central.
La Suisse
compte quatre langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le
romanche, divisées pour certaines en une quantité de dialectes parfois
incompréhensibles d'une vallée à l'autre. Sa démocratie directe et
fortement locale a beau promouvoir des identités régionales fortes, les
diverses communautés du pays sont restées unies malgré les turbulences de
l'histoire européenne et la montée des nationalismes. "On devrait arrêter de prétendre qu'il n'y a
qu'un peuple européen lorsqu'on écrit une Constitution",
argue Kalypso Nicolaidis, maître de
conférences en relations internationales à Oxford. "Le problème c'est
qu'on a encore trop tendance en Europe à vouloir toujours centraliser
davantage". (
) »
|
Les traces de la fête de lHumanité (29 septembre)
Il faut que je
vous parle un peu de lambiance chaleureuse de la fête de lHuma (10 et 11 sept.) : dabord, jai découvert
José Bové que je ne connaissais pas
et qui est attachant : souriant, généreux, cohérent, courageux
Un humain
bien sympathique dont la lutte, parfois héroïque, semble exemplaire pour nous
autres, trop timides citoyens :o)
Je vais lire ses livres et je vous en parlerai.
Jai aussi
découvert des militants humanistes et une réflexion politique généreuse et
lucide, loin des caricatures quon lit dans les journaux à propos des
communistes et autres résistants de gauche.
Jai aussi
rencontré Michel Onfray, qui semblait
avoir naturellement sa place dans ce rassemblement de résistants à toute forme
doppression. Son travail de longue date pour démystifier les religions
complète et renforce notre réflexion pour des institutions authentiquement
démocratiques.
Je remercie donc
les organisateurs de cette fête populaire davoir permis à la fois ces
précieuses rencontres et les passionnantes conversations qui se déroulent
depuis.
Jai de la
chance :o)
Premières pages du livre de Montebourg
(28 septembre)
Arnaud
Montebourg (député) et Bastien
François (professeur de droit public) viennent de publier un livre important
et intéressant : « La
Constitution de la 6ème République, Réconcilier les français avec la démocratie » (chez Odile Jacob).
Le premier livre de Montebourg, « La Machine à trahir, rapport
sur le délabrement de nos institutions » (publié en 2000) était
enthousiasmant : la perversité de nos institutions y est clairement
démontrée et fortement dénoncée. Je voulais vous résumer ce livre pour vous
aider à sentir son importance, mais je nai décidément pas le temps (vous
trouverez un bon
résumé, écrit par Giorgio Bocci à http://c6r33.free.fr/article.php3?id_article=22).
Tous les français devraient lire "La
machine à trahir" qui aide à comprendre que nous sommes tous
concernés, quotidiennement, par ce problème institutionnel quil ne faut surtout
pas laisser aux « experts ».
Le nouveau livre
de Montebourg propose cette fois une
Constitution. Chaque article est commenté. Je suis en train de le lire, et je
retrouve avec plaisir à la fois lénergie de Montebourg pour sauver la démocratie et de nombreuses propositions
intelligentes de la C6R.
Mais il faut quand même lire ce dernier livre dun il vigilant
car, sans lavoir encore fini, jai déjà trouvé une disposition dangereuse.
Page 52, je lis larticle 2 de ce projet de Constitution :
|
Article 2 :
|
|
La France participe aux Communautés
européennes et à lUnion européenne constituées dÉtats qui ont choisi
librement, en vertu des traités qui les ont instituées, dexercer en commun
certaines de leurs compétences.
|
|
Dans ce cadre, elle consent
aux transferts de souveraineté nécessaires à la mise en uvre de ces
traités.
|
Cette dernière
disposition est un vrai chèque en blanc (cest même une procuration permanente)
qui permet tous les abandons, à linsu de la population et même,
éventuellement, contre sa volonté.
Il faut évidemment prévoir que le référendum
est une condition de validité incontournable pour tout transfert de
souveraineté.
Je rappelle que
nos représentants ne sont pas propriétaires de la souveraineté populaire, ils
ne peuvent pas en disposer. Nous serions bien fous de leur laisser cette
possibilité (souvenons-nous que nos députés nous auraient livrés, avec 90% de Oui, aux institutions antidémocratiques
de lUnion technocratique et lobbypnotisée).
Puis, dans les
commentaires qui accompagnent cette proposition darticle 2, je lis (page
53) :
« La 6ème République (
) pose le principe général dun transfert de compétences au
profit de lUnion européenne sans référence à un traité précis et daté
(ce transfert étant bien sûr organisé soit sous la forme de traités ratifiés
par la France, soit sous la forme dune Constitution européenne), et sans
référence à une contrainte de réciprocité. La
6ème République est donc résolument européenne. »
Je ne reconnais
pas là le style de Montebourg et je
crois reconnaître plutôt une certaine "eurolâtrie"
de Bastien François (qui nous
exhortait à approuver le TCE : voir ma page Échanges et nos arguments
respectifs) dans ces commentaires qui abandonnent à nouveau, sans contrôle
populaire, des règles protectrices essentielles sur lautel du dieu Europe.
Je crois quil faut être beaucoup plus
prudent et garder le contrôle de notre souveraineté qui peut, certes, devenir
européenne, mais qui doit rester populaire.
Je trouve
décidément inique que des changements institutionnels soient
réglés à coup de traités, sans le consentement explicite des peuples
eux-mêmes, alors que de si graves évolutions devraient évidemment être décidées
par référendum. Quand les
représentants dun peuple transfèrent sa souveraineté sans laccord exprès du
peuple concerné, ces représentants trahissent leur peuple.
Je continue ma (lente) lecture et je vous tiens au courant :o)
Débordé (26 septembre)
Plus de dix jours sans vous écrire
:o)
Et pourtant je lis tous les jours des documents de plus en plus
passionnants, vous êtes une ressource formidable. Quest-ce quelle est belle
et importante, cette réflexion sur la démocratie !
Mais mes étudiants ont besoin de moi et ils sont prioritaires,
bien sûr. Je suis plus lent à digérer vos idées et surtout à rédiger des
synthèses ou émettre des signaux. À
lévidence, jai pris lhabitude de vous écrire. Cest fou comme cette histoire a changé ma
vie
Cest fou.
Jai une pile dinfos à vous signaler, je men occupe cette
semaine, promis ;o)
Chroniques économiques (15 septembre)
Jai
enfin trouvé une bonne chronique économique : la chronique Économie dOlivier Pastré, professeur à lUniversité de Paris VIII et membre du Cercle des économistes,
sur France Culture du lundi au
vendredi à 7 h 15, est vraiment instructive :
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/
Les archives des Matins de France Culture (et des
chroniques dOlivier Pastré, donc)
sont dailleurs une mine inépuisable, avec des invités souvent
passionnants : http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/archives.php.
Quand
on a subi tous les matins sur France
Inter, pendant des années, lécoeurante propagande néolibérale et les
dogmes boursicoteurs de Jean-Marc
Sylvestre, pensée unique imposée tous les jours sans contradicteur (à part
le pauvre Bernard Maris qui na
obtenu récemment que 5 minutes par semaine de temps de parole, le vendredi), on
apprécie lintelligence et la finesse dOlivier
Pastré, libéral modéré, humain, comme une bouffée doxygène.
Ses chroniques des mercredi 14 et
jeudi 15 septembre poussent un cri
dappel au secours pour sauver les agriculteurs. « Les agriculteurs sont dans une misère noire » rappelle-t-il.
Olivier Pastré nous signale un rapport important (120 pages) de lInstitut
Montaigne (www.institutmontaigne.org),
« Ambition pour lagriculture, libertés pour les
agriculteurs» quon peut télécharger à http://www.institutmontaigne.org/site/page.php?page_id=114.
Une autre émission très intéressante,
cet été, sintitulait Économie pratique, économie
savante, où Daniel Cohen, professeur d'économie à l'Université Paris-I et à l'École
normale supérieure, libéral lui
aussi, mais pas néolibéral, sest entretenu tous les jours avec un invité dans
le cadre de lémission Quartiers dété,
le matin sur France Culture :
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/ete2005/quartiers_ete/archives.php.
Pléonasme exemplaire : insensibilité néolibérale (14 septembre)
La
revue de presse de Jean-Louis Ezine,
dans Les Matins de France-Culture du 12 septembre, a bien
fait dévoquer la colère du chroniqueur illustre du New-York Times, Bob
Herbert :
« Bush
sest rendu dans le sud le 2 septembre et a prouvé, si cétait encore
nécessaire, quil navait toujours rien compris. Au
lieu de se préoccuper des habitants sinistrés, affamés, malades, mourants, il a
parlé de choses et dautres, racontant ses souvenirs de lépoque où il faisait
la fête à la Nouvelle Orléans et observant que Trent Lott, sénateur républicain
du Mississippi, avait perdu une de ses maisons, mais quil ne tarderait pas à
la remplacer par une splendide demeure, allant jusquà ajouter "Jattends
avec impatience le jour où je pourrai masseoir sous sa véranda
".
« Ce
comportement, écrit Bob Hebert, restera parmi les
pires réactions dun Président à une crise nationale aussi grave. Ce que nous avons
vu, cest la dangereuse incompétence et la stupéfiante indifférence du Président
et de son gouvernement à la souffrance humaine ».
Le chômage menace aussi les cadres : sils se révoltent à leur tour, cessant de collaborer docilement
aux plans de licenciements profitogènes, on peut, enfin réunis,
éradiquer cette régression humaine quest linsécurité sociale (13 septembre)
Cest la rentrée, et le plus important
cest que Daniel Mermet et son équipe reprennent lantenne (France Inter, du lundi au vendredi de 17
h à 18 h, indispensable émission Là-bas
si jy suis).
Ces jours-ci, cest le chômage, et particulièrement celui des
cadres, plutôt à labri jusquà présent, qui est décrit en situation réelle.
Les émissions (il y en a plusieurs) sont intéressantes et aussi, bien sûr, le
précieux répondeur, tribune ouverte aux auditeurs de France Inter, passionnant répondeur, amusant répondeur, formidable
répondeur de Là-bas si jy suis.
Idée forte : un cadre ayant
conduit lui-même des plans sociaux du temps où il travaillait, sachant
pertinemment quil abîmait des vies, réalise aujourdhui dans sa chair la
détresse du chômage qui dure (déjà six ans). La question nest pas, pour les
auditeurs, de lui pardonner ou de le condamner, distraits par le montant élevé
de ses indemnités de chômage, il sagit surtout de faire prendre conscience du danger aux autres cadres, ceux-là qui sont les
dociles complices des décisions de dégraissage pour un meilleur profit des
actionnaires, pour quils refusent enfin, eux aussi, de collaborer avec la
machine financière néolibérale qui nous
menace TOUS en nous opposant les uns aux autres.
Question : allons-nous accepter
dêtre finalement tous "en trop", ou allons-nous
réagir avant ?
Écoutez les
émissions du 12 et du 13 septembre : les archives sont à http://www.la-bas.org/
et le site officiel est à http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/.
Par ailleurs, Daniel nous invite à nous retrouver, auditeurs de Là-bas si jy suis, en créant des lieux de rencontre et de débat, café
bar ou autre, repaires
(repères) de Là-bas si jy suis.
Si vous avez envie den créer un, dites-le au répondeur de LBSJS : 01 56
40 37 37.
La sociocratie :
force de lauto-organisation (9 septembre)
Mieux que lautocratie où un chef
décide tout seul, mieux que la démocratie où la majorité impose sa loi à la
minorité, la sociocratie (mot créé par Auguste Comte) essaie de permettre aux
individus de sauto-organiser, déliminer la relation sous-jacente du maître et
de lesclave.
Une intéressante recherche pour
prendre des décisions comme le ferait un
organisme vivant : en sauto-organisant, cest-à-dire en permettant à
toutes les composantes de lorganisation dexercer un pouvoir souverain sur la
gestion de lensemble.
Des expériences concrètes existent, ça
semble donner de bons résultats, cest intéressant.
Gilles
Charest, canadien, y voit une solution à de nombreux problèmes de vie
en société : http://www.sociogest.ca/cms/index.php?id=34,0,0,1,0,0 (voir la page Articles).
Rendez-vous à la Fête
de lHumanité (5 septembre)
Invité à la fête de lHumanité, samedi prochain 10 septembre à 14h00, jaurai
plaisir à rencontrer José Bové.
Jespère que nous aurons du temps pour
réfléchir ensemble, avec vous, à ce que nous pouvons faire concrètement pour
sauver la démocratie.
Le
rendez-vous est sur le stand de la
Société des Amis de lHumanité :
http://www.humanite.fr/fete-rubrique.php3?id_rubrique=12183
.
Je viens de découvrir un projet
formidable. Un site Web nommé « lexpérience démocratique » propose un projet de
démocratie directe à grande échelle.
Cest enthousiasmant.
|
Description
Introduction
Actuellement, on considère quil est impossible de consulter tous les citoyen(ne)s
sur chaque question qui se présente. En conséquence, pour mettre en oeuvre la
démocratie, les citoyen(ne)s choisissent des « élu(e)s ». Ces élu(e)s ont
pour mandat :
de les représenter (auprès
dentités externes, par exemple à lONU pour un président de la république)
deffectuer les choix à leur
place (en interne, par exemple le niveau des impôts locaux pour un maire)
La démocratie représentative représente un progrès incontestable par rapport
aux situations antérieures. Il ny a pas de système existant dans lequel les
citoyen(ne)s aient autant la possibilité de sexprimer et de peser sur les
choix de société. Toutefois, la démocratie représentative comporte un
grand nombre de problèmes. Parmi eux, certains sont dus à sa structure même :
Désaffection du vote (due à la
sensation légitime quont les citoyens de ne pas peser sur les décisions qui
les concernent)
Corporatisme/clientélisme
(encouragés par la stratégie du processus daccession au pouvoir)
Corruption (due au manque de contrôle
sur les plus hauts niveaux de la pyramide)
Notre
Projet
Intitulé « LExpérience
Démocratique », notre projet consiste à fournir les outils permettant de
mettre en oeuvre une forme de démocratie directe à grande échelle. En effet,
nous faisons lhypothèse que les conditions sont peut-être enfin réunies pour
permettre la consultation des citoyen(ne)s sur lensemble des sujets qui les
concernent. LExpérience Démocratique
est basée sur trois grands principes :
Permettre lexpression de tous les
citoyen(ne)s, grâce à des outils Internet
permettant a chacun de soumettre un vote, de proposer des réponses, et de
voter
Transformer cette expression en décision,
grâce à une méthode de vote permettant de «révéler» au mieux la position dun
groupe
Appliquer cette décision
Éléments
concrets
Architecture
Le projet de lExpérience
Démocratique est basé sur une architecture client-serveur sur internet. Le client est un logiciel que
possède chacun des membres de lExpérience
Démocratique, et qui permet de soumettre une question (sous forme de
vote), de proposer des réponses, et de voter. Le serveur est un ordinateur
qui centralise les votes, dépouille les scrutins, et conserve les résultats
dans une base de données.
Type de scrutin
Le type de scrutin utilisé est la méthode de Condorcet, inventée
par le mathématicien philosophe du 18ème siècle. Dans ce type de
scrutin, les électeur(trice)s classent les réponses candidates par ordre de
préférence. Une méthode mathématique simple pour le dépouillement permet de
désigner le candidat vainqueur.
Exemple (
)
La
suite sur www.demexp.org...
|
Un document
simplifié donne envie den savoir plus :
http://www.demexp.org/non-spip/20040419ed-libreast.pdf.
Lidée, à terme, délire des députés "expérience
démocratique" qui auraient
comme mandat impératif de défendre honnêtement la position, actualisée en
permanence, des membres actifs est vraiment séduisante et mérite que nous
en parlions.
Arapèdes cratocrates
(29 août)
Jai souvent
limpression que notre démocratie
est en fait une aristocratie. Cest une erreur.
Aristocratie fait référence au pouvoir
donné aux meilleurs et nous sommes
loin du compte : ce ne sont pas toujours les meilleurs qui nous
gouvernent. Il est donc dommage de déconsidérer ce mot "aristocratie"
qui pourrait peut-être encore servir : pour rendre un sens positif à ce
vieux mot, il faudra dabord oublier limposture de lAncien Régime qui avait consacré une aristocratie héréditaire,
au lieu dimposer des contrôles et des remplacements fréquents
qui auraient pu donner vie à une méritocratie
confiant le pouvoir à ceux qui ont vraiment le plus de mérite, vraiment les meilleurs.
Je cherche donc
un mot pour désigner notre système qui permet à une caste dhommes au pouvoir (dirigeants politiques, dirigeants
médiatiques, dirigeants économiques
) de ne rester au pouvoir que parce quils
sont parvenus au pouvoir sans réel contre pouvoir. Le pouvoir par le pouvoir.
Javais pensé à castocratie, mais jai continué à
chercher.
Le mot monocratie existe, quand cest un chef unique qui décide, mais ce nest
pas exactement ce que je veux pointer parce que cest plutôt un groupe qui bloque les
renouvellements. Parmi les mots qui se rapprochent de notre situation actuelle,
mais sans correspondre tout à fait, nous avons aussi phallocratie où le pouvoir est réservé aux seuls mâles, ploutocratie qui donne le pouvoir aux plus riches, gérontocratie où
les plus vieux sont au pouvoir et technocratie qui confie les manettes
aux seuls techniciens. Je ninsiste
pas sur leurocratie qui, sous
couvert de beaux discours fraternels européens, déplace subrepticement tous les
centres de pouvoir hors de tout contrôle citoyen.
Le mot existant
qui irait le mieux est autocratie
qui est le pouvoir exercé sans aucun
contrôle. On y est presque, mais ce nest pas tout à fait notre cas
puisque les élections et certaines procédures de révocation existent et
permettent théoriquement un contrôle, manifestement insuffisant, mais un
contrôle quand même.
Il me fallait un
autre mot, un nouveau mot : ils
gardent le pouvoir parce quils ont le pouvoir, ils se protègent entre eux.
Cest un pouvoir légitimé par le seul fait davoir eu une première fois
le pouvoir malheureusement sans
contre-pouvoir. Après, on narrive plus à sen débarrasser. Par le jeu des
amis et des partis, seuls habilités
à présenter des candidats crédibles, par le cumul des mandats, par le jeu dinstitutions pas assez
démocratiques, les accès au pouvoir sont bien verrouillés et le pouvoir du
peuple nest encore quune vue de lesprit.
Je
propose cratocrate (du grec kratos "force, puissance"
et du grec kratos "force, puissance" :o).
Nous
vivons en cratocratie, où les
arapèdes (berniques) au pouvoir se servent de leur pouvoir pour garder leur
pouvoir, sans contre-pouvoir. :o)
À ce sujet, on lira avec intérêt la chronique de Claude
Allègre, « Renouveau
démocratique », dans lExpress
de cette semaine : http://www.lexpress.fr/idees/tribunes/dossier/allegre/dossier.asp?ida=434455.
|
(
) Ce manque de respect et de
confiance pour les électeurs est un cancer de la démocratie !
Peut-on essayer de réagir, au lieu d'attendre une explosion qui, même si elle
était salutaire, ne serait pas forcément salvatrice?
Il faut rapprocher la politique du
citoyen. Un premier moyen qui, certes, ne sera pas suffisant mais qui me
paraît nécessaire est de limiter totalement le cumul des mandats et leur
pérennisation. Le gouvernement Jospin a fait un petit pas vers la
limitation de ce cumul. Un seul mandat, de quelque nature que ce soit,
national, local, exécutif. Un mandat qui devrait aussi être limité dans le
temps. Deux mandatures pour toutes les fonctions électives. Ces
dispositions devraient être générales et s'appliquer également aux fonctions
syndicales nationales et locales.
Mises en uvre immédiatement, ces
mesures renouvelleraient quasi totalement la classe politique française.
Enfin du sang neuf ! Elles
interdiraient de fait la fonction d'élu sans métier, donc sans connaissance
de la vie réelle, du travail. Elles obligeraient les élus à
travailler, car, comme le proclame justement Nicolas Sarkozy, 80% des élus
vont de réunion en réunion, mais ne travaillent pas, prétextant une surcharge
de tâches à accomplir. Bien sûr, cela ne leur donnerait pas forcément du
courage et de l'imagination, qui manquent à beaucoup, cela ne leur ferait pas
passer le goût de la politique politicienne. Mais, leur situation n'étant
plus pérenne, les élus se rapprocheraient de la France d'en bas, sachant
qu'un jour ou l'autre ils seraient forcés d'y retourner.
Voilà un bon sujet de référendum !
Avec un résultat assuré.
|
Contre la servitude
volontaire, lapport philosophique de Michel
Onfray (20 août)
Je vous avais parlé fin mai
de cet excellent document de Michel Onfray, prof de philo
enthousiasmant, qui sintitulait Contre
la servitude volontaire. Le texte
original, complet, est publié à : http://perso.wanadoo.fr/michel.onfray/CONTRE_LA_SERVITUDE_VOLONTAIREav05.pdf.
Il faut relire de temps en temps ce texte important.
Depuis quelques jours, jécoute les cours de philo de Michel Onfray sur France Culture, de 19 à 20 h, mais je lécoute aussi depuis des semaines
en voiture grâce à ses précieux disques, chaque fois que je le peux.
Je découvre donc la philo vraiment très tard, cest savoureux et
important, complètement lié à notre réveil politique à tous : la résistance à loppression
(politique, sociale, religieuse ou autre) et la recherche de lautonomie, dune liberté respectueuse des autres, sont souvent au centre des
objectifs des philosophes et Michel
Onfray est un guide aussi savant quattachant.
Un lecteur (merci Yves)
vient de mapprendre que Michel Onfray
a un site et jy ai trouvé des documents intéressants comme « LEurope des crétins », « La vie des cloportes » ou « Linsolente génération des traîtres » :
http://perso.wanadoo.fr/michel.onfray/accueilonfray.htm.
Nest-ce
pas cet enseignement-là qui manque aux citoyens pour que grandisse enfin une
authentique démocratie ? Nest-il pas urgent de sortir lenseignement
philosophique de la prison de lannée de Terminale
et lui donner sa chance dépanouir à grande échelle la vie des hommes ?
Autre chose (cest lié) : je lis en ce moment le tout petit
livre dAmartya Sen, « La
démocratie des autres » (Manuels Payot, 2005). Cet indien, "prix
Nobel" déconomie 1998, explique que la démocratie nest pas du tout une
invention de loccident, et surtout que la démocratie nest pas réductible
aux simples élections, que la recherche du débat
public avant de décider ensemble
se retrouve partout sur terre et à toutes les époques.
Il me semble que ce débat
public éclairé qui devrait précéder tout vote prend tout son sens avec léducation des citoyens, et à mon avis, particulièrement
lenseignement philosophique.
On a ce quon mérite (9 août)
Si on veut la démocratie,
la vraie, cest à nous de limposer, vraiment, au lieu de voter automatiquement
pour des représentants qui ne jouent pas leur rôle et qui représentent plus
leur parti ou eux-mêmes que les citoyens qui les ont élus.
Si la démocratie nest pas une supercherie,
les citoyens mécontents devraient pouvoir changer ce qui leur déplaît :
ils ont grand besoin du RIC (référendum
dinitiative citoyenne), RIC national et RIC local.
Si la démocratie est authentique, quand un élu ou un grand
commis a trahi ou gravement démérité, les citoyens devraient pouvoir sen
débarrasser avant la fin de son mandat : cest le rôle du RIC révocatoire,
national et local.
Si la démocratie a un sens, le peuple doit pouvoir se défendre
directement contre une loi quil juge injuste : il doit pouvoir déclencher
un RIC abrogatoire, national ou
local.
Le signe tangible que la démocratie nest pas quun mot creux
qui aurait servi à flouer les peuples au profit dune nouvelle aristocratie,
cest le RIC, outil puissant au service des citoyens pour décider eux-mêmes de
leur propre sort.
Le RIC met une dose significative de démocratie participative dans la démocratie
représentative.
Alors, si on continue à voter pour des gens qui nous
refusent obstinément ce droit élémentaire, tous les Jospin, Chirac, Strauss Kahn, Lang, Sarkozy et autres qui roulent
en fait pour eux et pas pour nous, si on
continue à voter pour eux, cest bien fait pour nous, on a ce quon mérite.
Pour faire le point des promesses trahies par tous
les partis sur ce sujet central pour nous tous, je vous recommande
lintéressant document, dressé par le tonique Yvan Bachaud, vice
président du MIC, Mouvement pour lInitiative Citoyenne (www.mic-fr.org), « Honte aux
partis » : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Honte_aux_partis_Yvan_Bachaud.pdf
|
Extraits : « En 1988, dans sa lettre à tous les
Français, François Mitterrand avait écrit que le référendum dinitiative populaire (RIP) était une aspiration
profonde des Français et quil allait saisir le légiste.
Mais cest seulement le 10 mars 1993, après cinq
ans ! que F. Mitterrand (à la surprise générale selon Le Monde du 12 mars p. 8) a fait
adopter par le dernier Conseil des Ministres de M. Bérégovoy un projet de Loi
sur le référendum dinitiative populaire qui a été déposé sur le Bureau du Sénat où il est encore ! »
(
) « En 1993, avant les
législatives, dans un
fascicule électoral intitulé, La réforme maintenant ! », le
RPR, présidé par J. CHIRAC, avait écrit en quatrième de 20 promesses :
Création dun droit dinitiative populaire permettant à un groupe
important de citoyens de provoquer lorganisation dun référendum sur un
sujet donné. Dès 1993 le gouvernement proposera un projet de révision
constitutionnelle.
En 1993, après lélection, la révision a bien eu lieu, mi-juillet, PAS pour le RIP, mais pour instaurer
en hâte la Cour de justice de la
République pour que les Ministres socialistes soient jugés par leurs
copains parlementaires, dans laffaire du sang contaminé ! »
(
) « Sur lEurope, cest toujours, le
même double langage de lUMP :
MM JUPPÉ, GAYMARD,
TOUBON ont rendu public le 21 juin 2000 un
PROJET de Constitution européenne dans lequel est inscrit le référendum dinitiative populaire européen.
MAIS une fois au pouvoir, il na
pourtant pas été présenté et défendu devant la convention de VGE.
Moins de 40% de
"participants" aux Européennes ! Félicitations aux Français qui
ne sont pas dupes.
En effet, dabord, alors que dans 10 pays sur 15 membres en 2003,
les électeurs bénéficient du "vote
préférentiel" qui leur permet de modifier les n° dordre sur la
liste et donc de placer en position
éligible les candidats de leur
choix, en France tous les élus avaient été davance désignés par les états majors des
partis !
Ce sont leurs
représentants, pas ceux du peuple.
Ensuite et surtout,
les "abstentionnistes" savent bien quaprès lélection, ils ne
pourront pas contrôler les directives
que voteront les représentants des partis, puisquils ne disposent pas du référendum dinitiative populaire européen pour
abroger tout ou partie dune directive ou en proposer une nouvelle. (
)
|
Même si on nest pas daccord avec toutes les interprétations dYvan Chabaud, et ce nest pas si grave,
son courage opiniâtre à soutenir cette cause (qui nous concerne tous) force le
respect.
Jai du mal à croire que tous les vieux partis nous trompent systématiquement
sciemment, mais sur lessentiel cest-à-dire lauthenticité de la démocratie,
ils nous refusent effectivement un rouage fondamental, et cest donc à nous de créer non pas un
parti (forcément englué par une discipline carcan et pollué par des luttes
de pouvoir interne) mais un mouvement, un groupe de pression, pour
imposer précisément cette évolution urgente de la démocratie, un
groupe dont la disparition serait absolument programmée une fois son objectif
atteint.
Une « démocratie » sans RIC est une escroquerie qui
justifie des guillemets accusateurs.
Mais la démocratie se
gagne : on ne nous la donnera pas.
Et même ce quon a déjà aujourdhui, il faudra se battre pour le
garder ! Oui vraiment, souvent, on a ce quon mérite : on pourrait
commencer par cesser délire des gens qui nous maltraitent depuis longtemps.
Des institutions contre la sauvagerie (sélection naturelle) (4 août)
Encore une série d'articles poignants sur les
atroces souffrances de civils innocents, martyr voulu par des
"scientifiques" et "politiques" avides de
"progrès" et fiers de leur effet de "dissuasion" : http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=17628.
Lire notamment "Récits
des jours dHiroshima" du docteur Shuntaro Hida : http://www.dissident-media.org/infonucleaire/temoig_hida.html.
Des années d'horreur
indicible, aujourd'hui encore, et notre indifférence lamentable,
distanciée, blasée, suicidaire, à la généralisation de ces armes folles.
Comment ne pas
accabler les institutions
qui ont permis à des dirigeants de commettre des crimes aussi épouvantables ?
Comme je suis
d'accord avec Albert Camus qui criait, le 8 août 1945 :
|
(
) la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré
de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide
collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.
(
) Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité,
nous apercevons encore mieux que la paix est
le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un
ordre qui doit monter des peuples vers les
gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison.
|
Ne faut-il pas imposer aux dirigeants de
consulter directement leur peuple avant de l'envoyer mourir à la guerre ou
avant de partir assassiner des humains lointains ?
Sauf urgence à se
défendre, pas d'intervention militaire sans référendum.
Et ne serait-ce pas une prévention élémentaire, évidente, de tenir éloignés
les "marchands de canons", (ceux qui s'enrichissent directement quand les
tueries ont vraiment lieu), de toute fonction proche du pouvoir : éloignés du pouvoir politique, mais également éloignés
du pouvoir médiatique ?
Je vais peut-être paraître provocateur, mais je ne le suis pas tant que
ça : les peuples ainsi exterminés et torturés par les guerres ont été victimes de la sélection naturelle, comme nous le serons
nous-mêmes probablement, bientôt, à notre tour : citoyens
incapables d'imposer des institutions protectrices,
ils sont morts dans d'atroces souffrances du fait de la barbarie débridée des dirigeants
qu'ils ont laissé faire.
Cela n'arrive pas qu'aux autres : les
habitants d'Hiroshima vivaient paisiblement, comme nous en ce moment, aussi
indifférents aux malheurs des autres et aussi négligents de leurs propres
institutions.
Nous devrions tous contrôler étroitement nos
représentants politiques.
Comédie de suffrage universel (27
juillet)
Michel
Balinski professeur à l'École
polytechnique et directeur de recherche au CNRS, vient décrire un bon
papier dans Libération : « Le suffrage n'est plus
universel ». Extraits :
« La
démocratie, explique le Robert, est
"[la] doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir
à l'ensemble des citoyens... ; [l']organisation politique dans laquelle les
citoyens exercent cette souveraineté".
Les décisions récentes, des gouvernements de gauche et de
droite, d'éviter toute refonte de la
carte électorale prouvent le contraire : la démocratie française est devenue la
doctrine d'après laquelle la souveraineté appartient aux élus... ;
l'organisation dans laquelle les élus exercent cette souveraineté. Les élus, ces compétiteurs exceptionnels qui
sont à la fois les concurrents et les arbitres de la lutte électorale,
conçoivent les règles du jeu pour préserver autant que possible le statu quo : que chaque
circonscription reste ce qu'elle était pour maximiser les chances de son député
actuel de remporter la prochaine élection. Ainsi le système électoral est redevenu
une «comédie du suffrage universel»,
selon l'expression de Victor Hugo
pour qualifier le système instauré par Louis
Napoléon en 1852. »
Michel
Balinski nous donne ensuite les grandes lignes du mode demploi du charcutage électoral ordinaire sous nos institutions,
doù il ressort, par exemple, que « une
voix d'un habitant de la Lozère vaut plus que trois voix d'électeurs dans les
Bouches-du-Rhône ».
La
répartition actuelle des députés entre
départements crée donc, à elle seule, des inégalités criantes, mais le découpage des circonscriptions, à
lintérieur des départements, renforce encore ces inégalités :
« En 1999 la deuxième circonscription de la Lozère la
moins peuplée de France recensait 34 374 habitants, la deuxième du
Val-d'Oise la plus peuplée de France , 188 200 habitants : l'inégalité était de 447,5 %, deux
habitants de la première de ces circonscriptions pesaient autant que onze
habitants de la seconde. (
)
Répertorier les tailles étonnamment différentes des
circonscriptions en 1999 à travers la France et elles ne peuvent qu'être
encore plus disparates aujourd'hui suffit à démontrer le caractère fondamentalement anticonstitutionnel du découpage actuel.
Les inégalités entre les circonscriptions d'un département ne dépassent pas 10
% dans seulement douze des cent départements. Or, il est facile de dessiner des
cartes électorales par ordinateur en limitant les inégalités à l'intérieur d'un
même département à moins de 10 %, tout en respectant les critères qui avaient
été exigés en 1986 : quelques mois d'efforts suffiraient à redécouper
équitablement la France entière ! (
)
Le
suffrage n'est pas universel. Le temps
est venu d'établir un organisme entièrement indépendant des hommes politiques
avec le pouvoir de formuler et faire respecter les règles de la compétition
électorale. Aucune
"modification à la marge" ne suffira : seule une refonte profonde
pourra garantir un suffrage universel. Mais sans un suffrage universel réel il
n'y a point de démocratie. »
Lire larticle intégral, très
intéressant, sur http://www.liberation.fr/page.php?Article=313673.
Il faudra que nous pensions à cet aspect des choses dans la Constitution dinitiative citoyenne (CIC)
que nous formulerons et il faudra y être attentif autant pour la France que pour lEurope.
Rappelons en
effet que, dans les institutions européennes, légalité des suffrages des citoyens européens est violentée pour
protéger les États: ainsi, un citoyen maltais pèse politiquement treize fois plus
qu'un citoyen allemand : les 82,5 millions d'Allemands ont droit à un
député européen pour 860 000 habitants, tandis que les 394 000
Maltais un député pour 66 000 habitants.
Voyez lintéressante
synthèse du TCE de Robert Joumard :
http://institut.fsu.fr/chantiers/europe/traite_constit/joumard.pdf, page 15).
Trotskysme ou trotskisme
Et si on parlait de choses sérieuses ?
(26 juillet)
Je ne voulais pas en
parler, tant ça me paraissait futile, mais vous êtes nombreux à mécrire pour
prendre ma défense contre cet homme public qui riait de mon hésitation au
moment décrire le mot trotskiste,
mot plus que rare sous ma plume : « i
ou y ? », métais-je demandé et lavais-je avoué simplement au
sympathique Jean Lebrun avant quun
vaniteux ne sesclaffe à côté de moi : « Quel
enfantillage, enfin ! Peut-on parler publiquement de politique quand on
est aussi ignorant ? Pourrait-on rester entre gens sérieux ? » sétait exclamé en substance mon voisin (jai
oublié son nom).
Pour mettre un terme à
cette diversion, qui prête à sourire tant elle nous conduit au degré zéro de largumentation, je rappelle
la définition du Petit Robert qui admet simplement toutes les
orthographes : Trotski et Trotsky, trotskisme et totskysme, trotskiste et
trotskyste
Quon se le dise :o)
trotskiste
ou trotskyste [trэtskist] n.
1926; de Trotski (parfois écrit Trotsky), pseudonyme de Lev
Bronstein
¨ Partisan de Trotski et de ses doctrines (le trotskisme ou trotskysme),
notamment la théorie de la révolution permanente. Les trotskistes se sont
réunis en 1938 dans la IVe Internationale. Adj. Groupe
trotskiste.
Quand on demande trotskysme
à Google, il rend 9 700 pages
Web qui utilisent cette orthographe. Et quand on demande trotskisme, Google
renvoie 15 800 pages ainsi rédigées.
On fait donc comme on
veut, et on peut recommencer à parler entre adultes de choses
sérieuses ;o)
Je suis lent à vous
résumer le précieux livre de Montebourg,
et aussi à vous proposer une liste de principes essentiels quune authentique
démocratie devrait respecter dans sa Constitution, liste à discuter puis à
voter, entre citoyens, point par point : cest parce que vous menvoyez,
et aussi que je déniche sur les portails, tous les jours, trop de références et
de textes passionnants à lire et à digérer pour synthèse
Je nai pas le temps
décrire comme je le voudrais :o)
Pour être honnête, jai
aussi la chance de faire à nouveau des vols immenses, qui me prennent pas mal
de temps : le 14 juillet, par exemple, jai décollé de Signes (près de
Toulon) à 12 h 30, et je me suis posé à Allos (près de Barcelonnette) à 20 h
30, après huit heures de bonheur pur, daventures (des points bas affreux, peur
de poser si tôt, des sorties de nuages étincelants, un vol serré avec un
aigle
), sans autre moteur que lair chauffé par le soleil qui monte jusquaux
nuages, 125 km à vol doiseau, 5 h de retour en stop,
et plein dimages féeriques à vous montrer pour partager, dès que jaurai pris
le temps de les mettre en page. Tout ça
aère bien les neurones :o)

À mi parcours,
le lac de Sainte-Croix et, sur lautre rive,
le plateau de Valensole et Moustier Sainte-Marie
(Cliquez sur la photo pour lagrandir)
Mais on a quitté, deux minutes, le sujet des institutions, pardon :o)
Dans les médias aussi, la liberté totale conduit à
loppression du plus fort.
Lenjeu et les bonnes idées dune loi sur les médias au Venuezela (24 juillet)
Je
viens de dévorer un très bon article de Renaud Lambert sur le Venezuela qui,
encore une fois, sert de prisme étonnant pour analyser notre société
française :
« Le prisme médiatique vénézuélien » :
http://www.acrimed.org/article2077.html
« Concentration de la propriété des médias, qualité
déplorable des programmes, presse partisane en lien direct avec les forces
politiques, réglementation obsolète, le Venezuela est un prisme qui nous
éclaire aussi sur les situations française et plus généralement, européenne.
Retour sur une loi et son contexte. (
)
R. Lambert décrit dabord la violence
des attaques que subit une loi prétendue scélérate sur les médias au Venezuela.
Tout ça est édifiant, vraiment intéressant (un petit air de famille avec la
diabolisation du Non chez nous).
Puis,
il décrit la situation réelle (à son avis) et là, on découvre un niveau de
concentration inquiétant et une opacité sur le sujet évidemment entretenue. On
trouve surtout dans la récente loi des
idées importantes pour organiser, chez nous aussi, lindépendance et la
pluralité des médias.
« Dans un tel contexte et avec neuf des dix quotidiens
nationaux et six des sept grandes chaînes de télévision détenus par des
intérêts capitalistes, le leurre du « libre
marché des idées » ne tient pas. Selon cette logique, qui revient à
associer liberté individuelle et liberté du marché, « le meilleur test de la validité dune idée, cest sa capacité à
se faire accepter au milieu de la compétition du marché. » Mais, la
liberté des entreprises - de presse ou non - a toujours valu plus que celle des
citoyens au Venezuela. Déjà en 1953, un homme daffaires américain écrivait : « Ici, on a la liberté de faire ce qui
nous plaît avec notre argent : pour moi, cette liberté vaut plus que toutes les
libertés politiques et civiles réunies ». Nen déplaise aux tenants
dune vision libérale du monde, la
liberté de la presse est une médaille à deux faces indissociables, comme
lexplique Henri Maler dans un essai
à paraître : « la liberté
dexpression doit sentendre comme dune part le droit pour les journalistes dexercer leur métier à labri des pressions
gouvernementales et financières, mais aussi, le droit pour les citoyens davoir
accès à une information libre, de qualité et pluraliste. » Or ce
droit des citoyens nest pas respecté par les médias privés au Venezuela. Leur
attitude, au moment du coup détat, fut dinterrompre la couverture « en
direct » de lactualité afin de ne pas montrer les « manifestations
monstres » de soutien à Chávez qui se mettaient en place partout dans le pays.
La liberté de la
presse nest garantie que dans la mesure où le droit dinformer nest ni soumis
à la tutelle du pouvoir politique ni assujetti aux objectifs commerciaux des
groupes financiers. Cest donc une imposture de confondre la liberté de la
presse et la liberté des entreprises de presse de faire et de produire
nimporte quoi, nimporte comment. »
Puis
R. Lambert décrit la loi en
question. Je retiendrai ici une idée que
je trouve enthousiasmante :
« Le droit des citoyens à informer, eux aussi, est renforcé par laffectation
dune portion du spectre radioélectrique qui est affectée aux médias
communautaires. Par ailleurs, les opérateurs du câble et du satellite sont
contraints à transporter gratuitement, jusquà un maximum de 15% de leur offre,
les signaux des organes communautaires : cest le principe du « must-carry »,
lune des revendications fondamentales des médias alternatifs et communautaires
en France. En effet, dans ces médias à but non lucratif, où lon travaille
souvent bénévolement, le principal problème est celui de la diffusion et de son
coût, bien souvent inabordable. Lorsque la diffusion est assurée par le biais
de mesures telles que le must-carry, des médias coupés de leurs publics
trouvent enfin le moyen de se faire entendre.
Dans la logique de "participation" propre au Venezuela bolivarien, la nouvelle loi
met en place des structures qui permettent aux représentants de la « communauté
» de défendre leurs « droits relatifs à la communication ». Les
opérateurs sont dans lobligation dapporter des explications ou des réponses
dans les quinze jours à ces remarques de fond ou de forme qui peuvent porter
sur laccès aux archives, la participation à des consultations, la défense des
droits des usagers de la radio et de la télévision, la mise en place de
programmes déducation critique aux médias, la promotion du dialogue entre les
médias, lÉtat et les usagers, etc. Cette participation des
"usagers" aux médias se rapporte directement au projet
bolivarien de « participation citoyenne », selon lequel « Toute personne a le devoir de remplir
ses responsabilités sociales et de participer de façon solidaire à la vie
politique, civile et communautaire du pays, en promouvant et en défendant les
droits de lhomme comme fondement de la cohabitation démocratique et de la paix
sociale. »
Nous
sommes bien évidemment loin du modèle libéral de démocratie où les citoyens ne
sont sollicités que pour le vote de représentants sans quil ne leur soit
permis de participer activement à la vie politique du pays. De la même façon, les intérêts corporatistes des
« professionnels » qui, dans la presse comme ailleurs, naiment guère
que le public ne se mêle de leur travail, passent après le droit fondamental
des citoyens à participer. La loi affirme donc lapparition dun nouvel acteur
dans le paysage médiatique vénézuélien, le citoyen, à bien distinguer du simple
"consommateur" de médias. Ceci passe par la création dun
Directorat et dun Conseil de Responsabilité Sociale, décrits au chapitre V,
article 20 de la loi, qui ont pour responsabilité de discuter et dapprouver
les régulations techniques rendues nécessaires par la loi ainsi que détablir
certaines sanctions. Ils sont donc les
garants de la lettre de la loi, mais surtout de son esprit. (
)
Petit à petit, il devient évident en Amérique latine que la
réforme politique dun continent dévasté par la dictature, les pouvoirs
autoritaires et militaires, passe aussi par la réforme de situation de
concentration et pouvoir médiatique hautement dangereux pour la démocratie.
Il
est curieux quau même moment, les « vieilles démocraties » dEurope
et dOccident laissent se refermer sur leurs médias létau des pouvoirs financiers concentrés
et acceptent ainsi de voir la démocratie mise en danger sur leur sol. »
Tout
ça est simplement passionnant. Il faut vraiment lire cet article sur le site dAcrimed.
Je
découvre vraiment le Venezuela
contemporain comme un modèle de réflexion pour une meilleure démocratie.
Quand je pense au torrent de graves accusations que déversent
régulièrement Alexandre Adler et dautres
chroniqueurs renommés sur lexpérience du Venezuela, je reste songeur. Qui a raison ?
Lidée de la clérocratie, en lieu et
place de la démocratie ? (23 juillet)
Jai reçu de François Amanrich ce message plein
desprit :
|
La
démocratie est-elle soluble dans le peuple ?
Lorsque, en
1789, une partie de la bourgeoisie française se servit du peuple,
essentiellement parisien, pour renverser la monarchie, elle n'eut jamais
l'intention de partager le pouvoir avec quiconque. Et surtout pas avec le
peuple. Elle avait instigué cette révolution pour ravir le pouvoir à la
noblesse et ce n'était sûrement pas pour le donner à un peuple qui, plus est,
ne demandait rien. Le peuple était l'outil de la conquête et, la victoire
assurée, l'outil pouvait retourner dans sa caisse. D'autres révolutions se
servirent du même outil... avec le même résultat. C'est le paysan qui profite
du lait, pas la vache.
De république en
république, la caste politique, finit, après bien des réticences, par
appliquer un semblant de démocratie. En 1848 l'instauration du suffrage universel fut saluée comme une
grande avancée démocratique. Bizarrement, bien que du genre féminin, la
démocratie fut réservée aux hommes. En 1945, avec le droit de vote accordé
aux femmes, le peuple eut le droit de choisir ses dirigeants. Enfin... eut le
droit de choisir parmi les dirigeants proposés par la caste politique. Ce
n'est pas parce que le mouton choisit son gardien qu'il devient berger.
Puisqu'il en
avait la possibilité, le peuple essaya d'élire des dirigeants qui
répartiraient équitablement, sur toutes les épaules, le poids de l'État. Il
tenta un coup à droite puis un coup à gauche. Comme ça ne marchait pas,
encore à droite, puis encore à gauche. Mais, chose étrange, plus les
dirigeants changeaient, plus c'étaient les mêmes. Seuls, restaient les
problèmes. Le fardeau pesait toujours aussi lourd sur les épaules du peuple.
Les moutons portent souvent de la laine mais jamais de pull.
Alors le peuple
en eut assez. Il finit par refuser le droit qu'on lui avait octroyé et
préféra la pêche à la ligne aux urnes démocratiques. La caste politique s'en
inquiéta, puis s'en accommoda, pensant avec sagesse : « Qu'importe la
participation populaire pourvu qu'on garde le pouvoir ». De temps en temps,
parce que ça coïncide avec ses intérêts, elle rappelle à grands renforts de
menaces, les dangers de l'abstention. Parle de devoirs, elle qui ne connaît
que ses privilèges. Promet de graves périls, elle qui est toujours là. Crie
au loup. Mais quand le troupeau sait que son berger mange de la viande
pourquoi aurait-il peur du loup ?
Alors, la
démocratie est-elle soluble dans le peuple ? Pas celle que nous connaissons
aujourd'hui. En fait, quand on regarde bien, le plus grand handicap de la
démocratie actuelle, c'est le peuple !
Dans le système
clérocratique...
François Amanrich (Porte-parole du Mouvement Clérocratique) http://www.clerocratie.com
|
Les citoyens pétillent didées,
dans un joyeux désordre tant ils sont nombreux. Il est passionnant dessayer de
catalyser tout ça en de substantielles améliorations de notre Cité.
Cest le charme de la
période que nous vivons en ce moment :o)
Révélateur européen et
réflexion sur nos
institutions nationales (22 juillet)
Le débat référendaire,
au moins en France, a servi de révélateur
de létat de nos institutions qui se dégradent depuis longtemps, et pas
seulement dans le cadre européen.
Nos institutions, européennes mais aussi nationales, nous échappent
progressivement jusquà atteindre un point où les citoyens nont plus de moyen
institutionnel de résister. Les élections sont finalement le dernier
vestige, largement illusoire, dun pouvoir des citoyens qui est déjà devenu très
théorique.
Nos mass médias
nous échappent également, vendus et achetés comme des marchandises, soumis à la
concurrence et à la concentration et donc à des contraintes de productivité et
daudimat souvent en contradiction avec leur mission dinformation. Simpose
ainsi une "pensée unique", dogmatique, de plus en plus clairement
éloignée de lintérêt général. Il ny a pourtant que ces médias de masse qui
peuvent permettre la naissance et lévolution dune conscience politique
citoyenne, maintenant que nous sommes des millions à vivre ensemble. Leur
indépendance et leur pluralité sont essentielles à la survie de la démocratie.
Notre liberté et la
maîtrise de notre destin sont dans nos institutions qui nappartiennent quà
nous, nous tous, et dans nos moyens de communication qui font notre force.
Le sujet des institutions concerne donc tout le
monde, il est accessible et il est essentiel.
À mon avis, si nous
devions navoir quune préoccupation politique, dans notre vie quotidienne,
elle devrait concerner notre Constitution, ce pacte de gouvernement entre nous
et nos représentants qui établit tous les pouvoirs
et surtout leur contrôle.
Je viens de lire deux
bons livres dont je voudrais vous parler un peu.
Le premier est un petit
livre de Paul Alliès, « Pourquoi
et comment une VIe République » (Climats, 2002, 59
pages). Paul Alliès est professeur de sciences politiques à lUniversité de Montpellier I et il est membre fondateur de la Convention pour la VIe République
(www.c6r-fr.org).
La Ve
République (la Constitution de 1958) porte en elle limpuissance des représentants du peuple (les parlementaires) et lirresponsabilité des décideurs qui
nont finalement de comptes à rendre à personne. Ce simulacre de démocratie
entraîne la désaffection des électeurs qui finissent par se rendre compte que,
dans ce système, leur vote ne sert à
rien.
Il ne suffit pas, bien
sûr, daffirmer tout ça : il faut le démontrer, cest lobjet de ce petit
livre.
Voici son plan (mais il faut bien sûr lire le livre pour bien comprendre ce qui
nest quun résumé) :
I - Ce qui ne peut plus durer :
Un
présidentialisme pervers
Le Président de
la République a des pouvoirs immenses, encore renforcés depuis quil est élu au
suffrage universel, sans aucun contre pouvoir. Comme un roi. Cest une dérive bien peu républicaine, bien peu
démocratique.
Un exécutif
divisé
La
cohabitation, rendue possible par la double tête de lexécutif, est incohérente
et affaiblit lexécutif. Mais surtout, la séparation entre Président et
Gouvernement (seul à rendre des comptes) renforce lirresponsabilité du
Président.
Un parlement
impuissant
Notre Parlement
na pas le pouvoir de faire la loi, ni celui de consentir à limpôt, ni celui
de contrôler le gouvernement.
II - Ce quil faut changer :
Un régime primo
ministériel
Le Gouvernement
devrait émaner du Parlement, et lui rendre des comptes, effectivement.
Lélection du Président au suffrage universel (qui fait de lui, matériellement
et psychologiquement, un vrai roi) doit disparaître.
Un Parlement
actif
Il faut dabord
absolument interdire le cumul des mandats, spécialité française aberrante et
unique au monde. Il faut aussi donner du poids et un vrai pouvoir de contrôle à
lopposition pour quelle serve à quelque chose (lui donner un rôle dans la
rédaction de lordre du jour de lassemblée, par exemple). Il faut aussi
remplacer le Sénat (qui bloque toute révision constitutionnelle sans mandat
populaire et sans contrôle) par une chambre représentant les régions.
Des contre-pouvoirs
légitimes
Le Conseil
Constitutionnel, hors de contrôle, sans débats publics et sans mandat
populaire, sest progressivement arrogé un pouvoir constituant exorbitant
(exactement comme la CJE la fait en Europe). Rien ne justifie que les représentants
directs du peuple au Parlement soient ainsi ligotés par une institution aussi
peu démocratique. Il faut mettre en place un vraie Cour suprême, émanation du
Parlement et débattant publiquement sous contrôle citoyen. Lindépendance et la
pluralité des médias devraient être garanties au niveau constitutionnel.
Un pouvoir
local démocratique
Le Conseil
constitutionnel, depuis 1982, limite de façon drastique, et arbitraire (le CC
est nommé, il est hors contrôle et il ne débat pas publiquement), lévolution
de notre droit des libertés locales par une interprétation restrictive des
articles qui prévoient pourtant que les
collectivités locales « sadministrent librement ». Il faut inventer
un vrai pouvoir local démocratique, en simplifiant les niveaux dadministration
(suppression du département), en libérant la créativité des pouvoirs locaux, en
décentralisant la vie politique (cest possible grâce à linterdiction du cumul
des mandats et à un statut de lélu qui protège bien), en permettant aux
citoyens dintervenir directement dans la vie locale (RIP, référendums
dinitiative populaire).
III - Comment changer :
Lauteur résume enfin les modalités de révision de notre Constitution et
rappelle que de nombreux obstacles peuvent se mettre en travers dune
initiative parlementaire : notamment, laccord du Sénat qui est obligatoire, ce qui lui donne un vrai droit de veto
qui permet à cette assemblée dempêcher les citoyens de sexprimer sur la révision
par référendum. Il faudra donc franchir cet obstacle juridique (révoltant) pour
faire évoluer notre Constitution.
Il faudra, à ce propos, dans notre prochaine
Constitution, bien penser à éviter de tels verrous antidémocratiques.
Ce petit livre se lit
très vite et il donne envie de lire le suivant :o)
On ne peut sempêcher de rapprocher cette conception très antiparlementaire de nos
institutions nationales de la façon dont sest construite lEurope depuis cinquante ans :
construction par et pour les gouvernements, la plupart du temps sans consulter
les peuples, sans débat honnête, et sans jamais donner un pouvoir
prééminent aux assemblées élues par les
peuples, ni un pouvoir direct aux peuples eux-mêmes.
La
Ve République, en affaiblissant les représentants des citoyens,
infantilise les citoyens eux-mêmes et les éloigne du fait politique. La Constitution de 1958 nest pas
démocratique.
Cette
situation nest pas inéluctable, il ne faut pas traiter la Constitution de 1958
comme une vache sacrée : toutes les Constitutions évoluent et peuvent
progresser, mais la révision qui
simpose aujourdhui ne pourra avoir lieu que sous la pression populaire et
à travers une assemblée constituante
car, comme on la vu à loccasion des institutions européennes, les pouvoirs en
place, à la fois juges et parties, ne sont pas du tout impartiaux et, si on les
laisse faire seuls, ils rédigent des institutions à leur avantage, cest-à-dire
où les contrôles sont factices et la démocratie simulée.
Je vous parlerai du
deuxième livre, essentiel, un peu plus tard :o)
Il est en train de se passer quelque chose en Allemagne
(20 juillet)
Emmanuelle, française
expatriée, ma envoyé cet intéressant message :
|
Bonjour,
Il est en train
de se passer quelque chose en Allemagne. Les allemands n'ont pas eu droit à
un référendum sur la constitution européenne. En revanche, ils vont
vraisemblablement aller aux urnes avec un an d'avance. Et un nouveau parti dans le paysage
politique !
Parce que le
temps jusqu'aux élections du 18 septembre est très court, le (lui aussi
nouveau) parti WASG - Wahlalternative für Arbeit und Sozial-Gerechtigkeit (en
français "alternative électorale pour le travail et la justice
sociale") et le rejeton de l'ancien parti communiste de l'Allemagne de
l'Est encore bien implanté dans l'ex-RDA, le PDS, se mettent ensemble pour
réunir les forces de gauche représentant une
alternative au néo-libéralisme.
Les deux
partis se sont regroupés le week-end dernier dans une alliance portant le nom
de Parti de Gauche. Ses leaders
sont côté WASG Oskar Lafontaine et côté PDS Gregor Gysi.
Leur programme
est un programme sortant de la pensée unique: retraite minimum pour tous de
800 EUR, salaire minimum pour tous de 1500 EUR (il n'existe pas de salaire
minimum en Allemagne), relance de l'économie par la création d'emplois par
l'état, allocations familiales minimum de 250 EUR par enfant, assurance citoyenne
dans laquelle les revenus des actions seraient aussi mis à contribution, mise
en place d'un impôt sur les grandes fortunes, etc.
Ce parti est
crédité pour l'instant de 11 % des intentions de vote, ce qui en ferait le 3e
parti allemand. Dans les Länder de l'ex-RDA, il est même au-delà de 30 %,
soit au-dessus du CDU (démocrate chrétien). Il monte dans les sondages, il
ramènerait même des abstentionnistes aux urnes et de plus en plus de gens
s'imaginent pouvoir voter pour lui. Pour l'instant, ce parti fait peur aux
partis traditionnels et il est victime côté médias et élites politiques de la
même chose que le NON en France : on ne parle pas beaucoup du fond, juste de
la forme. Il y a de cela quelques semaines, les journaux se préoccupaient du
nom qu'allait prendre cette nouvelle alliance et des difficultés qu'il allait
y avoir à la réaliser des deux côtés.
Le problème
est maintenant résolu : les délégués des deux partis (WASG et PDS) ont voté à
plus de 75 % pour partir ensemble en campagne électorale. Oskar Lafontaine
est critiqué, taxé de "populiste" et montré du doigt comme chassant
des voix du côté de l'extrême droite par la classe politique traditionnelle
parce qu'il a dit qu'il ne trouvait pas normal que les salariés allemands
perdent leurs emplois du fait de la délocalisation ou de l'arrivée sur le marché
du travail d'étrangers sous-payés (vous savez: le plombier polonais).
|
Pas
grand-chose pour l'instant dans les médias sur le programme du Parti de
Gauche, si ce n'est pour le fustiger en disant qu'il s'agit d'un retour en
arrière et de propositions démagogiques. Et pour cause ! Relance de
l'économie par la création d'emplois financés par l'état, imposition de tous
les revenus, y compris ceux du capital, création d'une "sécurité sociale
citoyenne" où chacun participerait en pourcentage de ses revenus, id.
pour le système des retraites, représentent une politique en rupture avec le
néo-libéralisme ambiant, avec la possibilité d'avoir un vrai débat sur les
choix de société, ce dont les partis traditionnels ne semblent pas vouloir.
En France, on
ne parle pas ou très peu du Parti de Gauche. Je viens de trouver un article
en anglais disant que d'après des journalistes allemands (bien-pensants, cela
va de soi), ce parti était un parti dangereux, populiste et démago. Étant
donné que ce qui est ou va être véhiculé dans les médias français sera ce que
les médias allemands diront de leur campagne, il existe un gros risque qu'en
France, on n'en sache pas plus sur ce nouveau parti que l'on a véritablement
lu en Allemagne les raisons pour lesquelles les français ont voté NON.
Comme ce sont
cependant les mêmes raisons qui ont mis le NON à 55 % en France et qui
font du Parti de Gauche le parti qui monte, je voulais attirer l'attention
là-dessus : il y a un truc qui est en train de se passer de l'autre côté du
Rhin, une remise en cause du néo-libéralisme au niveau politique qui pourrait
faire de grosses vagues. Et M. Lafontaine n'est pas plus populiste que MM.
Mélenchon ou Emmanuelli. Mais évidemment, dans la pensée dogmatique ambiante
des faiseurs d'opinion, ils ont profondément tort. À suivre.
Emmanuelle
Liens en français:
Un article du Monde du 18/07/2005 sur le sujet :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-673366@51-642773,0.html
et http://www2.dw-world.de/french/presse/1.145165.1.html
Sites en allemand : http://www.linkspartei.info/
et http://www.w-asg.de/
Articles en allemand :
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,365832,00.html
http://focus.msn.de/hps/fol/newsausgabe/newsausgabe.htm?id=16893
http://www.zeit.de/2005/29/linksalternative
L'article en anglais dont je parle (traduit d'un article
allemand paru dans Die Zeit) : http://www.signandsight.com/features/241.html
|
Question
française : nos vieux partis sont-ils capables de défendre ardemment une réforme institutionnelle profonde
ou faudra-t-il, chez nous aussi, faire émerger de nouvelles forces
politiques ?
Autrement
dit : le néolibéralisme (accepté
aujourdhui par les vieux partis du centre, à gauche comme à droite) est-il
compatible avec une authentique démocratie ?
Est-il nécessaire, avant de réformer les institutions, de
disposer dun parti qui résiste vraiment à cette doctrine économique ? Ou
bien faut-il dabord rétablir des institutions démocratiques pour permettre un
changement de cap économique, éventuellement dinitiative populaire ?
Les deux problèmes,
économique et politique, sont sans doute liés, mais je ne sais pas si lun doit
trouver sa solution avant lautre.
Scandaleux
affaiblissement du programme REACH
contre les risques
chimiques (18 juillet) (Lien)
La lecture du "journal alternatif dinformation militante"
www.legrandsoir.info
est éclairante.
Quest-ce qui doit être
prioritaire ? La logique économique du profit maximum et de la
compétitivité, ou bien la logique politique de la protection des hommes et de
notre environnement ? Voyez le cas emblématique du projet européen REACH
sur le contrôle des produits chimiques et découvrez sa mort récente et
scandaleuse pour raison de "guerre économique", guerre déclarée,
comme dhabitude, par ceux qui ne souffrent pas au combat.
Lire larticle de Daniel
Tanuro : « Europe :
inaccessible politique des produits chimiques » :
|
Juillet 2005.
« Nous sommes disposés à revoir
notre position. Le résultat des études pourrait déboucher sur des modifications
profondes. La Commission na pas adopté de position dogmatique ».
Cest en ces termes que le nouveau
Commissaire européen à lIndustrie, Günter Verheugen, sexprimait en janvier
dernier devant le Parlement Européen au sujet du projet européen REACH denregistrement,
dévaluation et dautorisation des produits chimiques [1]. Cette déclaration confirme un tournant
important.
Conçu initialement comme une
« nouvelle politique » en matière de lutte contre la pollution
chimique, REACH - Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals - a soulevé chez certains
lespoir que lUnion Européenne ferait passer la santé des populations avant
le profit des multinationales. Mais lespoir est parti en fumée.
Lindustrie chimique a mobilisé toutes ses forces pour torpiller le projet,
les gouvernements lont appuyée et les partisans de REACH dans les
institutions ont été bridés. La petite phrase de Verheugen ne laisse aucun
doute sur les intentions de léquipe Barroso. Une législation vraiment
conséquente, avec le principe de précaution, est décidément inaccessible - unreachable
- dans le cadre néolibéral.
Pour comprendre la bataille autour de REACH, il faut remonter
plus de vingt-cinq ans en arrière. En 1976 exactement. A lépoque, (
)
|
La suite, importante, est à lire à : http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2490.
Ma question : comment rendre nos
institutions fortes par rapport aux puissances économiques ? Quels textes
juridiques fondamentaux pourraient remettre le politique au dessus de
léconomique ? Comment protéger durablement les multitudes humaines contre
la cupidité de quelques uns, aussi
puissants soient-ils ? Comment éloigner
les lobbies économiques des décideurs politiques ?
Encore une idée pour lemploi : le TCSM, taux de contribution sociale maximum (7 juillet)
Lidée de TVA sociale
fait son chemin dans les esprits.
Dans la même veine,
voici une autre piste très intéressante pour préserver les emplois fragiles : elle consiste à ne pas
toujours exiger, sans discernement, les mêmes charges sociales : je
reproduis ci-dessous le texte de présentation rapide quen fait son auteur, Dominique
Estérez
(lu sur un forum, http://communautes.hexali.fr/reforme_des_prelevents_obligatoires-t15314.html) :
|
TCSM : Proposition
de réforme des prélèvements obligatoires
Dynamiser lactivité et lutter contre le chômage
Bonjours,
Il y a quelque temps, jai débattu sur le forum France économie, dune réforme que je
proposais pour aménager nos prélèvements obligatoires afin de dynamiser
lactivité et lutter contre lexclusion et le sous-emploi.
Beaucoup de participants mont signifié leur sympathie pour la
démarche et leur intérêt pour cette piste qui consiste à ajuster les
prélèvements des actifs les plus fragilisés par un plafonnement à un Taux de
Contribution Sociale Maximum par rapport à leurs valeurs ajoutées : le TCSM.
Jai présenté cette réforme, un peu technique, mais dont les
conséquences pourraient être humainement considérables, dans une note qui a
été expédiée au Premier Ministre, début juin.
Je viens de créer un site Internet
qui publie cette note avec le courrier envoyé à Monsieur de Villepin.
http://www.tcsm.fr/
Si vous souhaitez soutenir cette idée, allez-y et
manifestez-vous : sondage en ligne, commentaires et diffusion de ladresse du
site comme de linformation, etc.
Dans la tourmente que nous vivons, cest le moment ou jamais
de changer pour la bonne direction !
Merci de votre soutien. D. Estérez
(Je précise, sil en était besoin, que je nai ici aucun
intérêt mercantile personnel)
|
Si vous êtes pressé, lisez au moins le
principe et les illustrations, cest vraiment astucieux :o)
Le texte simprime mal (il est coupé sur sa droite) : jai créé un pdf qui simprime
correctement.
À la recherche de lessentiel (6 juillet)
Voici dix jours que je nécris plus dans
ce journal et pourtant je lis sans arrêt et je griffonne partout des notes
pour résumer et formuler lessentiel. Je dévore le
livre étonnant, important, fondateur, de Montebourg,
je malimente du livre révolté de Ziegler,
de lessai synthétique de Généreux,
des thèses lumineuses de Lordon, des
monuments de Polanyi, Chomsky et Attali
Jen ai trouvé encore quatre ou cinq autres qui ont lair
tout aussi passionnants. Je nai donc pas le temps, pas la tête à publier tout
de suite.
Je vais méloigner un peu, digérer, et vous en parler à
nouveau un peu plus tard :o)
Je suis à la recherche des
principes fondamentaux que nous, citoyens, devrions exiger, je dis bien exiger,
de nos institutions, aussi bien nationales queuropéennes. Des principes
qui ne sont ni de gauche, ni de droite,
des principes qui ne sont pas français
mais universels, des principes consensuels qui ne demanderont pas des
années de discussions pour tomber sur un compromis, des principes essentiels
qui, précisément, ne supportent pas de compromis.
Pour tomber vite daccord, partout à travers les peuples
européens, il faut sen tenir à lessentiel.
Il faudrait que nous arrivions à proposer nous-mêmes,
nous : citoyens, un texte fondamental, un pacte de gouvernement entre
nous, hommes libres, et nos représentants.
Je vais écrire un nouveau texte qui sappellera « Une bonne Constitution qui
montrerait
» ;o)
Je vais essayer aussi, si je peux, de rendre ce site plus interactif, pour nous rapprocher encore.
Jai deux mois (les vacances) pour ça. Je sens que ça va
passer vite :o)
Si vous avez des idées, nhésitez pas à men faire part :
je puise mon énergie dans la vôtre.
Mouvement pour linitiative citoyenne, le MIC (25 juin)
De toutes les réformes institutionnelles
dont lurgence fut révélée par notre débat sur le TCE, la plus importante,
à côté de la responsabilité réelle des
acteurs politiques et de la prééminence
du Parlement, me paraît être linitiative citoyenne,
cest-à-dire la possibilité pour un
grand nombre de citoyens de soumettre au vote de tout le pays une décision,
quelle quelle soit.
Cest la réforme la plus importante et ce sera sans doute la
plus difficile à arracher car elle permet, sur les sujets importants qui nous
tiennent massivement à cur, de court-circuiter nos représentants et de faire
valoir directement notre volonté dhommes libres. On peut deviner que nos
représentants auront du mal à prendre concrètement ce risque politique, aussi
démocratique soit-il. Il faudra donc sûrement leur imposer, si nous sommes
daccord sur ce projet.
En attendant, les initiatives citoyennes pour rédiger nous-mêmes
des propositions dinstitutions commencent à émerger. Je vous transmets aujourdhui un message reçu
dYvan Bachaud :
|
Citoyens,
aidez nous
Assemblée constituante citoyenne française, cest bien parti
Pour avoir rapidement une Constitution
européenne démocratique au service des citoyens, le Mouvement pour
lInitiative Citoyenne (MIC) est en train de mettre en place une Assemblée Constituante Citoyenne Européenne
(ACCE) issue de 27 Assemblées Constituantes citoyennes nationales. Un appel est lancé aux associations susceptibles de piloter une
opération nationale.
UN seul impératif
dans pour cette opération : les membres doivent être tirés
au sort.
Le MIC pilote la
mise en place de lAssemblée Constituante Citoyenne Française.
Il a été décidé au
départ de tirer au sort 300 personnes
sur les listes électorales réparties sur tous les départements au prorata
du nombre délecteurs.
Nous avons
commencé par un test sur le Rhône où il fallait 7 membres.
Nous avons eu la
très bonne surprise de constater que nous avons obtenu nos 7 accords avec
seulement 33 appels téléphoniques des personnes tirées au sort.
Nous avons
peaufiné une méthode de tirage unique, partant de lannuaire (donc vérifiable
par tout le monde) puis se reportant sur les listes électorales également à
disposition de tout citoyen.
Toutes les listes
électorales sont à disposition de tout électeur à la Préfecture.
Il faut moins
dune heure pour établir la liste dappel dun petit département. La seule
astreinte est quil faut se rendre une fois à la préfecture.
Le MIC lance un
appel à tout citoyen voulant prendre en charge rapidement un département.
Nous contacter au
plus vite
Cest bien parti
À DIFFUSER
LARGEMENT
Merci
Yvan Bachaud, Vice-président du Mouvement pour
lInitiative Citoyenne
Bayettant 69360 Communay Tel.
04.72.24.65.02
E-mail : y.bachaud@mic-fr.org site :
www.mic-fr.org
Post scriptum :
Le Mouvement pour lInitiative Citoyenne est une association
totalement "apolitique" dont lunique objet social est dobtenir linstauration du référendum
dinitiative citoyenne à tous les niveaux territoriaux, de la commune à
lUnion européenne.
UNE QUESTION DE
BASE : êtes-vous favorable au RÉFÉRENDUM DINITIATIVE CITOYENNE, en
toutes matières bien sûr, et à tous les niveaux territoriaux ?
Merci de me
répondre il faut 3 secondes.
Yvan Bachaud
Vice-président du Mouvement pour l'Initiative Citoyenne (MIC)
y.bachaud@mic-fr.org Site: www.mic-fr.org Tél. :
04.72.24.65.02 Bayettant 69360
Communay # LYON
|
Urgence des politiques
keynésiennes pour réduire le chômage (24 juin)
Encore
un entretien intéressant sur Les matins de France
Culture. Cétait le 20 juin, linvité était
lexcellent Jean-Paul Fitoussi
(voir adresse sur la page Liens et docs)
Léchec du Conseil Européen sur le budget est dabord dramatisé par les éditorialistes de France Culture, selon lesquels cet échec serait une conséquence de
la crise ouverte par le Non des
peuples.
Mais
léchec est ensuite fort bien dédramatisé par Jean-Paul Fitoussi, selon lequel cet échec date en fait des
années 1980 (!) et aurait eu lieu, bien sûr, quel que soit le résultat du
référendum. JP Fitoussi rappelle, en outre, que le budget de
lagriculture, ce nest que 0,4 % du PIB (40 % de 1 %)
Si
on en récupérait la moitié (pour mener une politique de recherche et
dinnovation, par exemple), on naurait libéré que 0,2 % du PIB !
Le vrai
problème de lEurope, cest linsignifiance de son budget qui, entre autres
causes, réduit lEurope à limpuissance devant le chômage, par laveuglement
dune « doctrine ».
Alexandre Adler donne ensuite une explication intéressante de lincroyable disgrâce
actuelle des politiques keynésiennes (relance de la demande par des grands
travaux) : daprès lui, cest la guerre du Viêt-nam, financée sans
hausse des impôts, qui a déclenché une hyper inflation, exportée par le
dollar, puis une stagflation, mal interprétées, qui ont permis le retour à la
mode des politiques libérales, hostiles à toute intervention étatique. Il
observe pourtant que la croissance actuelle aux USA tient à une forte
intervention de lÉtat qui dépense beaucoup (fort déficit budgétaire).
Daprès JP
Fitoussi, lEurope est un très grand pays (par le revenu national), mais se
comporte comme un petit pays, de façon orthodoxe, timide, alors quun grand
pays est tout à fait capable, surtout avec une monnaie unique, davoir une
politique autonome, keynésienne sil le veut.
La
croissance européenne dépend à 99% de la demande interne européenne, et
pas de la compétitivité. Or, on ne se donne pas les moyens davoir une
vraie politique européenne. Et on paie cette impuissance (volontaire) par le
prix le plus grave de tous : le chômage de masse, qui est une plaie fondamentale
pour nos sociétés.
Pour
expliquer cet incroyable sabordage, JP
Fitoussi défend une hypothèse : au Conseil
Européen, chaque pays est jugé selon sa réputation, or il
se trouve que depuis la révolution conservatrice (79-80), les critères de la réputation
sont devenus linflation basse, léquilibre budgétaire et la concurrence, et nous
les avons pris au sérieux.
Alors que nulle part au monde, ils ne sont pris au sérieux !
Par
exemple, savez-vous que la zone Euro
est la région du monde qui a le déficit budgétaire le plus faible (2,5 %) et
pourtant, à entendre les journaux, on a limpression que lEurope et ses États
sont en faillite, quils nont plus les moyens de leur gestion, mais ce nest
pas vrai ! Le Japon a 7,5 % de déficit, les USA ont 6,5 % de déficit,
la Grande Bretagne a 3,5 % de déficit et la Zone Euro a
2,7 % de déficit !
Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, nous nous sommes pris dans ce jeu
de réputation où chaque gouvernement au Conseil
Européen croit quil doit montrer patte blanche (un certain niveau de
souffrance de ses populations) pour que sa voix soit écoutée.
Pour JP
Fitoussi, une solution crédible est un fédéralisme restreint, à 5 ou
6 pays, pour décider ensemble de façon volontaire (et en laissant les autres
décider ce quils veulent).
Encore
une émission de radio bien intéressante, tout à fait liée à notre réflexion
institutionnelle.
Nota :
merci pour vos précieux messages, riches et affectueux, qui me donnent tant de
force :o)
Le libre échange
débridé est-il la cause de gaspillages et de nuisances graves ? (21 juin)
« Là-bas
si jy suis », lémission modeste et géniale de Daniel Mermet, sur France Inter à 17 h, était encore bien intéressante les
20 et 21 juin (voir adresses sur la page Liens
et docs) : on y a évoqué le transport routier très bon marché, la
mise en esclavage des chauffeurs routiers, le nombre grandissant des poids
lourds sur les routes, avec les nuisances, les gaspillages et les dangers
associés, et le rapport entre cette incurie écologique et le libre échange
dogmatique.
Par rapport à notre sujet
constitutionnel, se pose la question des transports inutiles générés par le libre échange, motivé
uniquement par le profit : on y apprend, et lexemple est très parlant,
que des crevettes danoises traversent lEurope en camion pour aller se faire décortiquer
au Maroc, puis reviennent au Danemark, toujours en camion, pour y être
conditionnées, puis repartent en Europe, devinez par quel transport, pour finir
dans nos rayons après avoir parcouru combien de milliers de km inutiles ?
Faut-il vraiment sen remettre totalement
aux choix du marché (myope, égoïste, cynique, courte vue, etc.) pour déterminer
le degré déchanges, et donc de transports, et donc de gaspillages et de destructions
des ressources de la planète ?
LÉtat et la puissance publique nont-ils
pas un rôle régulateur évident à jouer ?
On apprend au passage que
le ministre des transports italien est personnellement propriétaire dune
entreprise dautoroutes, ce qui doit bien le gêner un peu pour favoriser le
ferroutage. Je lis cette aberration à ma manière, avec mes lunettes
actuelles : comment les institutions (une Constitution)
peuvent-elles imposer le respect de lintérêt général ?
Dans lémission "Là-bas si jy suis" du 21, un
membre du conseil scientifique dAttac défend lidée de relocaliser
léconomie pour diminuer les transports. Pour rendre le transport routier
dissuasif, plus cohérent avec ce quil coûte vraiment, il faudrait introduire
les coûts externes du transport (pollution, santé, accidents, infrastructures
)
dans son prix, grâce à une taxation spécifique.
Les Suisses
ont précisément, par référendums
dinitiative populaire (RIP) :
· interdit la circulation des camions à travers la
Suisse (au profit du rail) : un article constitutionnel dorigine
directement populaire entérine donc désormais cette priorité du rail sur la route,
· interdit laugmentation de la capacité des routes
qui traversent la Suisse,
· imposé une taxe sur les poids lourds, malgré les
pressions de lUnion européenne (avec qui la Suisse a un accord bilatéral),
· et imposé la construction de deux tunnels
ferroviaires de basse altitude à travers les Alpes
Je
trouve décidément ces RIP bien séduisants, un vrai progrès de la démocratie, à
conquérir.
La
Suisse serait-elle aussi un « laboratoire du Non » ? :o)
Quant à lUnion européenne, pour protéger le sacro-saint libre échange, elle
lutte contre ces initiatives écologiques : elle empêche que la taxe sur le
transport routier augmente !
On note aussi que lUE a déjà imposé à lAutriche de renoncer à une
taxation de ce type.
Indispensable émission de
radio :o)
Imposer la Partie I
par voie parlementaire ? (18 juin)
Certains partisans du TCE déçus
prétendent que la partie I na pas été
contestée pendant le débat et
quelle faisait consensus (« le
téléphone sonne » du 17 juin, voir page « Liens et docs »).
Ils en déduisent quon
devrait donc aujourdhui limposer à part, sans référendum bien sûr, pour garder le meilleur du TCE, dans
lurgence de la crise.
Ces gens-là ne manquent pas dair.
On constate, ici encore, le peu
dattention que les défenseurs du traité ont accordée aux arguments développés
par les opposants au traité pendant des mois.
Cest la Partie I, en effet, qui
décrit les rouages inacceptables de la post démocratie :
confusion des pouvoirs au profit du pouvoir exécutif, faiblesse marquée du
pouvoir législatif, lois sans parlement, absence de contrôle des pouvoirs,
influence nulle des citoyens sur leurs représentants et sur les politiques
menées, pouvoir judiciaire directement dépendant de lexécutif, banque centrale
hors de contrôle, équilibre budgétaire imposé, etc.
Alors prétendre quil est possible, malgré les référendums
français et hollandais massivement négatifs, de mettre en vigueur cette Partie
I par voie parlementaire, cest montrer encore une fois le mépris du suffrage universel qui suinte partout chez ceux qui ont
pris, depuis trop longtemps, lhabitude de tout décider sans jamais en référer
aux citoyens.
Le désordre actuel est propice aux évolutions : on sent
déjà des inflexions dans les préoccupations (apparentes) des responsables.
Il faut que nous, citoyens sans pouvoir, soyons capables de
lister nos exigences fondamentales, mais de façon courte et simple : une liste
lisible et compréhensible par tous, une liste capable de réunir un vrai consensus international,
de gauche à droite. Si une exigence fait débat, litige, on la retire : il
ne faut garder que le socle de ce à quoi on tient vraiment tous.
Il faudrait que cette liste soit une sorte de pétition point par point, que chacun
pourrait signer et commenter point par
point.
Ce nest pas encore une Constitution, mais ce sont les principes que nos Constitutions,
européenne mais aussi nationale, devront respecter.
Car la 5ème République mérite, elle aussi, les plus
graves reproches : nous sommes, en France, déjà largement en post démocratie. Le sens de lHistoire
serait, à la faveur dune politisation des citoyens comme celle que nous vivons
en ce moment, daméliorer nos institutions de façon significative : création
de référendums dinitiative populaire, mandats uniques et non renouvelables,
suppression des ordonnances (lois sans parlement), tirage aux sort des citoyens
représentant les autres ?, etc.
Je suis en train de lire un bouquin
décapant, passionnant : il sappelle « La machine à
trahir » et cest Arnaud Montebourg, jeune
parlementaire, qui la écrit en 2000 (Denoël). À suivre
:o)
Médiatisation pour accélérer la contagion démocratique (17 juin)
Ça y est, la version anglaise
du texte « Une mauvaise
constitution
» est prête et publiée :o)
Elle permettra à dautres citoyens du monde de comprendre que la
crainte des Français nest pas seulement économique, mais aussi et surtout
juridique : les institutions
proposées dans le TCE ne sont pas du tout démocratiques.
Cest une bonne raison dy résister et de dire Non, Non
à ce texte-là et pas du tout Non
à lEurope.
Ce matin,
lémission Today de la radio BBC devrait parler de laventure de ce
site, comme devrait le faire, si tout se passe comme prévu, le journal de Canal plus, dimanche 19 juin à 12 h
40
:o)
On peut voir ce
journal à http ://www.canalplus.fr/tpl108.htm&cid=13139&getTitle=1&nopub=1.
Flexibilité :
le mot de la fin dAlain Rey (15
juin)
Stéphane ma fait passer ce précieux
message :
Une proposition passionnante pour lutter contre le chômage (12 juin)
Les 12 000 messages (!)
que jai reçus depuis deux mois sont une mine dintelligence inouïe, une immense énergie positive :o)
Je distille doucement cette réserve, puisque le courrier
quotidien se calme après le vote.
Je vais ici encore assurer le relais et vous livrer tel quel un message passionnant, écrit par
Carole qui se présente en détail mais qui souhaite rester anonyme ici.
Son message est double : elle décrit dabord une idée
séduisante sur le financement de la protection sociale par la TVA pour tirer la
protection sociale de tous les pays vers le haut, cest la TVA sociale, et elle lance ensuite un appel à concrétiser notre
éveil politique par ladhésion à un parti.
Dans mon esprit, cet appel citoyen est révélateur et vaut pour tous les partis, de gauche à
droite : notre démocratie ne peut vivre et progresser que si les citoyens
se politisent concrètement.
|
Bonjour,
Je lis votre journal tous les matins maintenant. Merci
de continuer le combat !
NON, nous n'avons pas fait "une bêtise" : c'était
la seule façon de pouvoir espérer changer les choses.
Mais ce n'est évidemment pas suffisant, d'autant que je
regrette que les arguments démocratiques ne soient jamais vraiment venus au
premier plan du débat grand public, alors qu'il me paraît essentiel de
montrer qu'il y a un lien de cause à effet entre la carence démocratique des
institutions et la conduite de politiques économiques contre le peuple. (Je
suis d'accord avec beaucoup qui disent maintenant qu'il faut traiter
séparément la question institutionnelle et la question économique, mais je
frémis chaque fois que j'entends dire que la partie institutionnelle serait
consensuelle.)
Pour la suite du combat, je suis inquiète comme vous
quand je vois le PS se contracter : Hollande lundi, Strauss-Kahn aujourd'hui
(oui, ça me coûte, mais j'écoute encore France Inter, où Paoli me semble se
faire discret, alors que Guetta veut à tout prix montrer qu'il avait raison).
Pour cette raison, j'ai une proposition à vous soumettre, qui est l'objet de
mon mail, mais je dois faire un détour et me présenter (un peu) d'abord.
Je suis sympathisante PS. (Comme je comprends bien que
vous appréciez de pouvoir situer vos interlocuteurs, je précise
accessoirement que je suis (
).
Ma motivation était de répondre à l'appel pour le projet
2007, d'essayer d'apporter au moins une idée qui me tient à coeur : lutter
contre le chômage en transférant
le coût de la protection sociale des salaires vers la consommation, via la
TVA.
[Parenthèse sur ce sujet qui ne coule pas de source (je
sais que la TVA est taboue à gauche, et je ne vois d'ailleurs pas d'autre
raison à l'absence de débat sur "la
TVA sociale" - comme certains l'appellent) :
·
La TVA est un instrument que nous maîtrisons encore
(à la hausse, seulement...), en dépit de l'OMC et de l'Union. (Cet argument
est logiquement annexe, mais c'est essentiel du point de vue de la
faisabilité de la démarche : elle n'exige pas de rupture majeure avec notre
environnement international.)
·
Le transfert du financement
de la sécurité sociale des salaires vers la consommation via la TVA permet de
supprimer le biais énorme entre
les produits nationaux et les produits venus des pays "esclaves" (Chine, Inde ...) où nos entreprises se
délocalisent allègrement.
Voici le biais dont je veux parler : chaque fois qu'un bien
est produit en France, contrairement aux pays à protection sociale faible ou
inexistante, nous produisons en même temps de l'allocation familiale, de
l'assurance chômage, de l'assurance vieillesse ... Très bizarrement, ce biais
n'est jamais mentionné par les chantres de la concurrence libre et non
faussée (évidemment parce qu'ils espèrent que le forçage de la concurrence le
fera disparaître par disparition de la sécurité sociale, cette terrible
externalité positive de l'économie que le modèle libéral néglige fort
commodément).
Pour bien faire comprendre pourquoi la TVA permet d'agir sur
ce biais, je rappelle que les échanges transfrontaliers (y compris au sein de
l'Union) se font en prix hors taxe : la TVA est payée par le consommateur final
selon le taux du pays du consommateur. Donc, en transférant le financement de
la protection sociale sur la consommation via la TVA, c'est chaque fois qu'un bien est consommé en France, indépendamment
du pays d'origine et de son niveau de protection sociale, que nous pouvons
financer en même temps de l'allocation familiale, de l'assurance chômage, de
l'assurance vieillesse ... (Remarquons au passage que dans cette
configuration nous n'avons plus à avoir peur de la directive Bolkestein et
que le plombier polonais qui viendrait faire de la plomberie en France premièrement
ne pourrait plus guère être moins cher que le plombier français (qui se fait
rare), deuxièmement contribuerait à la sécurité sociale en France comme le
plombier français - à condition de savoir récupérer la TVA sur sa
prestation.)
Le résultat de la suppression du biais induit actuellement par
le financement de la protection sociale par la production, c'est de démotiver les délocalisations, et de manière
générale de réduire très considérablement la pression sur la variable
d'ajustement qu'est (assez logiquement) devenue la masse salariale.
En corollaire, le résultat de la suppression de ce biais,
c'est aussi de rendre aux produits nationaux une compétitivité à l'exportation que toutes les politiques de
compression de la masse salariale par les licenciements n'atteindront jamais.
Il faut être conscients que le coût de la main d'oeuvre en France est pour
l'employeur le double du salaire net touché par le salarié, la différence
étant les charges patronales et salariales qui financent la sécurité sociale.
Si l'on considère, à la louche et en moyenne, que le prix de revient d'un
produit national comprend 50% de coût de main d'oeuvre, comme la moitié de ce
coût correspond au financement de la protection sociale, c'est de 25% que
l'on peut faire baisser le prix de revient des produits nationaux à
l'exportation.
On voit donc aussi que, pour bien faire, il faudrait que la
démarche englobe nos partenaires européens avec lesquels nous avons beaucoup
d'échanges, l'Allemagne en premier lieu. (Je verrais là une très belle
initiative franco-allemande pour reprendre la main sur l'économique - et
enchaîner sur les institutions ensuite.)
Pour conclure l'argumentaire "positif" : le Danemark a accompli la réforme du
financement de sa protection sociale (modèle) par la TVA depuis 1987 ; le Danemark a un taux de chômage voisin de 6%.
Il faut maintenant répondre rapidement aux objections qui se présentent.
·
Le transfert du financement
de la sécurité sociale des salaires vers la consommation via la TVA n'est pas inflationniste pour les produits
nationaux (ni pour les produits issus des pays européens à forte protection
sociale qui suivraient la même démarche) : le prix hors taxe baisse d'autant
que les taxes montent. (Ca, c'est en global, avec des différences d'un
produit à l'autre selon la part de main d'oeuvre qui entre dans la
composition du prix, sauf à moduler la TVA en fonction des produits pour ne
pas bouleverser le système de prix - mais je laisse ce débat pour plus tard.)
·
Il est évident par contre
que les produits chinois ... seraient
plus chers. C'est aussi le cas si l'on utilise la dévaluation monétaire
pour favoriser les exportations (la dévaluation de l'Euro n'étant cependant
pas, en l'état des traités, un instrument à notre portée : cf. les critiques
sur les statuts de la BCE).
·
L'instrument TVA n'est
cependant pas protectionniste (les
taxes à l'importation, qui sont des instruments protectionnistes, ne sont
plus à notre portée cf. OMC ...) puisque l'instrument TVA ne fait que
supprimer un biais concurrentiel : on dirait plus justement qu'il est
"anti-antiprotectionniste". C'est même un instrument très moral car, au lieu de tirer les
pays à forte protection sociale vers le bas, il tire leurs concurrents vers
le haut. (Il faudra bien un jour dire que les Chinois sont au moins autant
nos esclaves que les voleurs de nos emplois, puisqu'ils produisent des
richesses dont ils ne voient jamais la couleur.)
·
Le transfert du financement
de la sécurité sociale des salaires vers la consommation via la TVA n'est pas "injuste", en tout cas
pas plus qu'aujourd'hui, puisqu'il se
fait à prix constants à la consommation - sauf pour les produits des pays
"esclaves". Comme aujourd'hui, cette injustice peut se corriger
par l'impôt sur le revenu et la redistribution sociale : puisque, en
accomplissant ce transfert vers la TVA, on fiscaliserait la protection
sociale, on pourrait aussi imaginer que les bas revenus se verraient attribuer,
sur la base de la déclaration des revenus, un revenu complémentaire de
redistribution (sorte d' "impôt négatif"). Remarquons enfin que le
financement de la protection sociale par les salaires, outre qu'elle ne
fonctionne plus, n'est pas particulièrement juste non plus.
Je pourrais approfondir et je souhaite vraiment qu'un débat
grand public puisse naître sur cette proposition anormalement absente de la
scène médiatique, mais je referme provisoirement cette parenthèse déjà plus
longue que prévue.
Une dernière remarque quand même : parmi les instruments non
encore essayés pour lutter contre le chômage, outre ceux cités ci-dessus et
dont on voit que seule la TVA est accessible aujourd'hui, il reste celui
proposé par Sarkozy (et même certains à gauche si j'ai bien entendu Védrine
mardi !) : la flexibilité ... !
Donc ce débat que j'appelle est vraiment vraiment urgent. (fin
de la parenthèse)]
J'en viens maintenant à ma proposition d'action concrète, qui repose sur l'analyse suivante.
Le PS est le seul parti qui peut porter le changement au
gouvernement, en tout cas de manière non violente.
Mais cela suppose qu'il représente ses électeurs,
lesquels ont massivement voté non.
Or la direction continue à se réfugier derrière ses militants,
qui avaient voté oui, pour refuser de se remettre en cause. (J'ai entendu un
proche de Hollande parler du "bouclier des militants" qui le
protège.)
Strauss-Kahn a encore dit ce matin que le rôle d'un
parti est de proposer ce qu'il croit être bien, et qui est déterminé par le
vote des militants, et de voir ensuite si les électeurs y adhèrent.
Par ailleurs, il faut être conscients que la moyenne
d'âge des quelque 100 000 militants PS est de 60 ans (je dis bien la
moyenne !). Je confirme qu'à 32 ans je suis, de très loin, la benjamine de la
section que je fréquente.
Il faut être conscients que c'est parce que moins de
9 000 militants PS, faisant confiance à leurs chefs, ont choisi de voter
oui (comme les plus de 60 ans en général) plutôt que non au référendum
interne, que le PS a défendu le oui au lieu du non.
Donc : pour que le PS nous représente, nous ses
électeurs, et pas seulement les militants actuels, il devient urgent
d'adhérer au PS pour peser sur ses propositions !
C'est aussi ça, le problème de la démocratie, de
toujours compter qu'il se trouvera bien quelqu'un pour nous représenter. Ce n'est plus le cas le aujourd'hui, si Strauss-Kahn et
Hollande arrivent à marginaliser Fabius, Emmanuelli et les autres en
s'appuyant sur des militants dont on attise l'esprit de revanche. (Il faut
entendre dans les réunions PS l'agressivité et les cris de haine sur le thème
"Fabius et les autres ont fait perdre le parti, alors qu'on était si
bien partis pour 2007 après les élections de 2004".)
Donc, concrètement, ma proposition est d'utiliser l'outil Internet et notamment le pôle de
référence que votre site est devenu dans la bataille du Non pour demander à un maximum de monde, s'ils partagent cette
analyse, d'aller prendre vite une carte d'adhérent au projet du PS (10 euros,
dont 6 récupérables sur les impôts), à l'inverse des militants socialistes du
non qui déchirent leur carte de désespoir.
Je crois avoir dit pourquoi c'est nécessaire. Cela a en outre
le mérite d'être vraiment faisable : quelques
dizaines de milliers de personnes suffiraient. Vous avez montré que vous
pouvez toucher ce nombre.
Êtes-vous d'accord pour essayer ?
Merci d'avance.
Merci de toute façon pour ce que vous avez fait
jusque-là.
Carole
|
La post-démocratie
en pratique : gouverner sans le Parlement (10 juin)
Je métonne que la décision de gouverner par ordonnances ne soulève pas une insurrection : cette possibilité quoffre la 5ème
République au gouvernement de légiférer sans le Parlement trahit la violence
potentielle que notre Constitution porte contre le peuple quelle est censée
protéger.
Je ne développe pas encore ce point essentiel car je suis en
colère, et on ne fait rien de bon sous lemprise de la colère.
Le néolibéralisme
en pratique : retour au 19ème siècle (9 juin)
Déréguler, cest interdire à lÉtat dinterdire.
Le Premier ministre, Dominique de Villepin, dans son discours de politique générale, vient de
proposer la création d'un contrat de travail
"nouvelle embauche" pour les très petites entreprises, avec une période d'essai allongée à deux ans,
un dispositif moins contraignant pour l'employeur - ce qui a suscité de vives
réactions sur les bancs de l'opposition de gauche. (http://fr.news.yahoo.com/050608/290/4gcz3.html)
Je vous transmets ci-après un message important qui circule sur
le net. Il vient de Gérard Filoche,
inspecteur du travail et donc fin connaisseur du droit du travail et défenseur
institutionnel des salariés :
« Une période d'essai, qu'est-ce que c'est en droit du
travail ?
La possibilité d'être mis à la porte sans
aucune procédure, par oral, sans lettre, sans motif, sans recours, seulement
parce que l'employeur l'a décidé, et il pourra le décider dorénavant à deux ans moins un jour...
Toutes les discriminations deviennent
possibles...
Le jeune ou le senior pourra se
défoncer pendant deux ans, être soumis, accepter les heures supp' impayées, les tâches les plus ingrates, en
dépit des risques en matière de sécurité ou de santé, il devra être flexible,
malléable, corvéable, et au bout du bout, il sera renvoyé, chassé comme un
valet, comme au 19ème siècle, voilà ce que viennent d'inventer MM Chirac et De Villepin, une attaque sans précédent contre le droit et le
contrat de travail...
Gérard Filoche, membre du Bn du
Ps, D&S, Nps, inspecteur du travail. »
Ce qui est particulièrement inquiétant, cest cette impression
de totale absence de contre-pouvoir en
dehors des élections : nos institutions (Constitution de 1958, 5ème
République) nous imposent, entre deux élections, un tunnel dobéissance de cinq ans sans aucun moyen réel de
résistance, quels que soient les résultats des élections intermédiaires.
Un prochain progrès de la démocratie sera, mais seulement si nous sommes
assez forts pour limposer, la
création de droits dinitiative
populaire, soit pour révoquer un élu, soit pour créer une loi, soit pour
supprimer une loi, en démocratie directe,
cest-à-dire en court-circuitant nos représentants quand nous sommes très
nombreux à le vouloir.
Car il nest évidemment pas douteux
que, lorsque les citoyens décident de reprendre la parole,
la voix directe des citoyens a
plus de valeur que la voix des représentants des citoyens.
Tout indique, en ce moment, quil est vraiment temps de rappeler cette évidence
à nos dirigeants.
Les matins de France-Culture (8 juin)
Décidément, « Les matins » de France-Culture (de 7 h à 9 h) sont parfois très intéressants :
ce mercredi matin, 8 juin, un journaliste vraiment impertinent, et pourtant très pertinent,
houspille Jean-Luc Dehaene,
ancien premier ministre belge ayant participé à la rédaction du TCE, et
manifestement peu démocratique : JL
Dehaene considère que lexigence dappel direct au peuple à propos des
institutions nest que du populisme
et oppose le Non des certains peuples
avec les Oui des parlements
comme sils étaient de même poids. http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=32120 (Boutons écouter lémission, 1ère
et 2ème parties, en haut de la page).
Le journaliste qui linterroge, Nicolas
Demorand, est vraiment
critique et on a presque limpression dun débat contradictoire, ce
qui ressemble enfin à un journalisme libre qui permet, par confrontation,
un éclairage complet des points de vue.
La chronique dOlivier
Duhamel, par contre, est triste à mourir, défaitiste et facilement
contestable sur presque tous les points. Quand est-ce que ce grand cerveau
va nous rejoindre enfin, et basculer sur une pente intellectuelle positive,
sur un projet inédit, historique, pour construire
une autre Europe politique, voulue par les peuples et authentiquement
démocratique, qui ne soit pas un prétexte pour institutionnaliser le
néolibéralisme ?
Au lieu de nous servir une douche froide tous les
jours, les grands éditorialistes pourraient peut-être mettre leur
ingéniosité, leur inventivité, leur savoir, leur énergie, au service de ce
projet qui na rien de honteux et qui les aurait sûrement enthousiasmés sils
lavaient eux-mêmes mis en route et promu.
On commence à sapercevoir que ceux qui utilisent le mot populisme pour
refuser aux peuples leurs droits les plus élémentaires sont souvent les mêmes
qui ont renoncé à la démocratie, au nom du réalisme.
On a
là un vrai débat, essentiel, loin dêtre clos.
Merci
pour tous vos mails passionnants (plus de cent par jour), de plus en plus en provenance
de létranger où la contagion gagne, qui montrent bien que léveil continue et
que lélaboration dun projet alternatif est en route.
Fondamentalement,
il faut dabord interroger les peuples
eux-mêmes, cest évident : je veux bien me marier avec
lAllemagne, évidemment, je le souhaite ardemment, mais si elle ma dit elle-même
quelle le voulait aussi, et pas seulement son papa (son parlement). Et cest
la même chose pour tous les peuples dEurope : les parlements ne peuvent pas décider pour les peuples sur des sujets
aussi graves. La lumineuse
parabole touche à lessentiel, vraiment.
Nous
sommes heureusement réveillés, ne nous rendormons pas :o)
Les français (environ 16 millions de citoyens sur les 29
millions qui sont allés voter) viennent de sopposer clairement au
texte du TCE.
Les autres peuples du monde sont surpris de ce Non imprévu, et sinterrogent.
Les Européens qui
consultent la presse française pour comprendre ce Non lisent partout que nous sommes devenus xénophobes et racistes,
que nous abandonnons lEurope et que nous nous replions sur nous-mêmes.
Ils sont évidemment
dégoûtés de ces explications et commencent à nous en vouloir.
La plupart de nos propres journalistes français donnent de nous
une image mensongère et détestable. Ces
commentateurs, soi-disant responsables, sont en train de monter les peuples les
uns contre les autres.
Messieurs
les éditorialistes et chroniqueurs, vous navez pas le droit de donner de nous
cette image dégradante qui na rien à voir avec la réalité : par principe
même, jaime les Polonais, les Italiens, les Allemands, les Tchèques, les
Estoniens, les Danois, les Turcs, et tous les autres, avec qui je ne rêve que
de fraterniser durablement.
Mais
le texte que jai lu très attentivement na précisément de fraternel que
lapparence, et je suis fier de lavoir refusé malgré vos menaces. Cette prise de conscience citoyenne est donc
une opportunité pour lEurope, et pas du tout un malheur.
Je métonne de vos interprétations infamantes qui sont
elles-mêmes teintées de la haine ou du mépris de lautre que vous condamnez si
bruyamment.
Avez-vous donc complètement perdu lhabitude dêtre
contredits ?
Comme vous êtes intolérants, Messieurs les éditorialistes et
chroniqueurs, incapables que vous êtes dimaginer que, peut-être, cest vous
qui vous trompez. Utilisant votre position de faiseurs dopinion, vous jetez de lhuile
sur le feu en opposant encore les protagonistes malgré larbitrage de la
majorité, au lieu de favoriser la réconciliation indispensable qui, seule,
évidemment, permettra maintenant de progresser.
Et surtout, vos analyses et commentaires soulèvent les autres
peuples contre les français, cest
consternant.
Je parle maintenant aux autres, les 16 millions de citoyens qui
ont résolument voté Non à ce texte,
et aussi à ceux qui ont voté Oui en
se pinçant le nez, à tous ceux qui, en
fait, rêvent dune Europe vraiment fraternelle, vraiment démocratique, vraiment
protectrice, vraiment voulue par nous, et qui la croient possible si un fort
mouvement des peuples eux-mêmes lexige.
Vous nen avez pas assez de lire tous les jours ces torrents de
médisance pessimiste ? Vous ne vous sentez pas insultés par ces calomnies,
cette diffamation quotidienne, dans vos journaux habituels ?
Il y a un journal qui défend intelligemment une démocratie
authentique et la résistance contre les excès du néolibéralisme :
cest Politis. On peut laider
en le lisant, lui plutôt que les autres :o)
Est-ce quon nest pas assez déterminés pour rassembler les gens de
gauche et de droite sur ces objectifs
communs ?
Est-ce que les modérés
de tous les bords (de gauche à droite) sont aussi irréconciliables que ça ?
Quest-ce que veut dire gauche ?
Quest-ce que veut dire droite ?
Jai du mal à le dire aujourdhui.
Je cherche lissue constructive que mon
vote a permise et que les arapèdes interdisent.
"Cohérence"
ou malhonnêteté des arapèdes (4 juin)
La direction du PS vient dexclure du
secrétariat les quelques dirigeants du parti qui défendaient le Non au référendum. Il ny a donc plus à
la direction du PS que des gens qui prônaient le Oui. Et le chef de parti qui prend cette décision prétend que cest
au nom de la "cohérence", tu parles
On marche sur la tête, évidemment : la cohérence
élémentaire, pour ceux qui donnent un sens au mot démocratie, aurait dû
conduire la direction du PS à respecter lévidence du vote en ouvrant le
secrétariat à quelques personnalités qui défendaient le Non (Emmanuelli, Mélenchon, Filoche, Montebourg
) afin de
représenter correctement sa base électorale actuelle.
Cette décision en dit long sur la malhonnêteté
des arapèdes.
Je reçois des mails inquiets. Je les comprends car je ressens (un peu) la même chose,
au moins la peur de linconnu. Il va
falloir être forts. Mais ensemble, nous
sommes TRÈS forts :o)
Nous sommes des gens simples, normaux, qui avons eu le courage
daffronter les projets et les menaces des puissants, qui nous sommes levés
malgré tout et qui avons résisté. Nous avons dit Non à un texte que nous jugions mauvais, dangereux, pas démocratique
du tout.
Un texte qui révélait lurgence de se réveiller et de vraiment
contrôler les pouvoirs en place.
À
mon avis, les citoyens réveillés qui ont peur regardent trop la télé :o)
En effet, les journalistes qui nous ont imposé le Oui pendant des mois et qui ont
aujourdhui perdu veulent sauver la face
en essayant de prouver quils avaient raison.
Ils voudraient nous punir.
Alors, bien en place à leurs postes de faiseurs dopinion, ils
ressassent leurs anathèmes et leurs reproches, au lieu de construire lavenir ensemble, puisquil est désormais
possible de le changer.
Mon
conseil : regardez peu ou pas la
télé, choisissez bien vos journaux,
et surtout informez-vous sur Internet.
Et puis rassurez-vous : tout ne va pas reposer sur nos
petites épaules de citoyens, quand même
Il faut faire confiance à nos hommes
politiques, aux meilleurs dentre eux en tout cas : ceux qui nous ont appelé à résister à ce texte inique sont moins
suspects que les autres, et il y en a sur tout léchiquier politique, de gauche
à droite, nous avons donc lembarras du choix :o) Il faut laisser passer un peu de temps pour
que nos idées remontent à eux et quils les concrétisent.
Il faut surtout que nous soyons très exigeants sur le contrôle des
pouvoirs, aussi bien en France quen
Europe, sur la démocratie directe qui nous permettra de résister en cas de
besoin, sans pour autant consacrer toute notre vie à la
politique :o)
Le décalage entre les
citoyens et leurs responsables politiques
devient parfois une opposition et montre bien que nos démocraties (nationales) manquent de moyens de contrôle. On
dirait que, dans tous les pays dEurope, les peuples correctement informés et
ayant pris le temps de débattre auraient refusé le TCE, alors que tous leurs
parlementaires vont valider ce texte, presque unanimement.
Le
TCE est bien un révélateur dun mal profond.
Le décalage entre les
citoyens et leurs médias est également
consternant : quand presque tous les journaux (papier, radio, télé)
vilipendent la moitié de la population, on peut se demander qui ces journaux
représentent.
Lisez les articles décapants de Mona Cholet et Frédéric Lordon cités dans ma
page Liens.
Les arapèdes (ou patelles, ou berniques) sont des petits coquillages en forme
de cônes pointus qui saccrochent fortement aux rochers pour résister aux
vagues et aux prédateurs :o)
Tous les responsables
saccrochent à leur pouvoir comme des
arapèdes, malgré les désaveux populaires les plus évidents.
Les RIP (référendums dinitiative
populaire) semblent bien être une solution idéale pour garder le contrôle des chefs, à tous les niveaux
de décision.
Dans les partis :
les adhérents devraient pouvoir changer de chefs de leur propre initiative. Au
PS, cest urgent.
Dans les États :
les citoyens devraient pouvoir révoquer leurs chefs (parlementaires, président,
divers élus
) de leur propre initiative. En France, cest urgent.
On peut sans doute étendre la réflexion à tous les lieux de pouvoir, de lentreprise à lEurope.
On a rappelé les
différentes démonstrations (voir Liens
et Biblio) du lien direct entre la
politique anti-inflationniste de la Banque Centrale Européenne (BCE) et le
chômage élevé de la zone Euro.
Combien de temps va-t-on nous mener en bateau en prétendant
lutter contre le chômage tout en laissant perdurer cette aberration économique
de la BCE, chef duvre de cynisme ?
Je suis sûr que cest Keynes qui avait raison et quune
politique ambitieuse de grands travaux
relancerait toute notre machine, au lieu de cette sinistre politique de
rentiers, protégeant leur tas dor contre linflation
Est-il exagéré dobserver que les plus
grosses entreprises, à partir dune certaine taille, menacent la démocratie ?
Dans le même ordre didées, traiter les médias comme des
marchandises, quon peut vendre au plus offrant, permet et favorise leur
concentration, et facilite la manipulation des foules par le rabâchage dune
pensée unique.
Les entreprises géantes ne trouvent même plus dÉtats en face
delles puisque nos dirigeants acceptent de se dépouiller eux-mêmes des moyens
de résister (dérégulation méthodique observée à travers lOMC, lAGCS, le
TCE, etc.).
Est-ce que notre prise de conscience
citoyenne peut suffire à mettre au pouvoir des hommes (de gauche ou de droite,
peut-être une coalition des deux ?) vraiment déterminés à lutter contre ce
processus orwellien ?
Lidée qui simpose en ce lendemain de
NON, cest la démission des responsables
désavoués : Chirac et
Hollande, qui sont dauthentiques démocrates, et après un désaveu populaire
aussi criant, vont sans aucun doute démissionner ;o)
Mais le Président serait gentil quand même dattendre un peu car une élection
aujourdhui serait une catastrophe : le PS est un champ de ruines avec des
chefs totalement discrédités (voir limpardonnable révélation de François
Hollande de jeudi, je ne men remets pas) et personne ne voterait aujourdhui
pour ces hommes-là (ou si peu).
Laprès non fait peur : on nous dit « avec qui allez-vous renégocier ? »
Qui parle de
négocier ? Ce concept de négociation suppose quon continue à
construire lEurope par les États, donc sans les citoyens. Cest précisément ce quil faut
éviter : on doit changer de
chemin et construire lEurope par les peuples et pour les peuples (comme
partout dans le monde) : demandons aux peuples (et pas à leurs parlements)
« qui veut faire lEurope ? » et créons ensuite des institutions
démocratiques pour ces nouveaux pays fondateurs dune Europe politique. Les
autres rejoindront les pionniers quand ils le voudront.
Pour moi, lobjectif urgent de cet après Non est donc la réflexion
citoyenne (avant que les hommes politiques professionnels ne sen mêlent,
plus tard) sur nos institutions :
celles de lEurope mais aussi celles
de la France.
Il
est peut-être temps dimposer à nos acteurs politiques les institutions
capables de mettre en jeu réellement leur responsabilité, bien au-delà des
seules élections, nécessaires mais pas suffisantes pour contrôler les pouvoirs.
Le tunnel néolibéral de cinq ans que nous vivons en ce moment
est la preuve de la faiblesse de nos institutions françaises en terme de
contrôle citoyen des pouvoirs institués : aucun désaveu national (voir
toutes les élections récentes), aussi cinglant soit-il, narrive à déstabiliser
les pouvoirs en place. On comprend pourquoi la Constitution de 58 passe souvent
pour une des plus archaïques dEurope.
Il nest pas normal quil soit possible de gouverner avec
seulement 28 % dopinions favorables : il faut mettre en place, en France
comme en Europe, des contre-pouvoirs réellement efficaces.
En ce moment, je pense surtout aux référendums
dinitiative populaire.
Certains vont sans doute parler de "populisme", comme dhabitude quand on donne de limportance au
peuple, cest-à-dire vous et moi. Pourtant, chacun sent bien que ce mode-là
dexercice de la démocratie protège bien les hommes contre les dérives des
pouvoirs.
Trois référendums dinitiative populaire, des vrais, paraissent
très séduisants :
Le référendum révocatoire qui permet dimposer
la démission (suivie dune élection) à tout
élu (sans aucune exception), au terme de la moitié de son mandat et une
seule fois par mandat (pour éviter toute instabilité politique).
Ce contrôle citoyen fonctionne bien au Venezuela (voir mon
message du 16 mai) sans déclencher de troubles : le président (Chavez) a
ainsi été mis en cause mais il a ensuite été protégé par une large majorité, ce
qui a lui a donné une nouvelle légitimité. Je vois dans ces institutions un véritable
exemple de respect des peuples qui
donne tout son sens au mot démocratie.
Le référendum législatif qui permet dimposer
une loi, par-dessus toutes les autres institutions, et en vertu de
lévidente primauté du peuple sur les représentants du peuple.
Le référendum abrogatoire qui permet de
supprimer une loi dont le peuple ne veut pas.
Certes, il faut réfléchir aux garde-fous nécessaires pour éviter quelques dérives prévisibles
(par exemple, pas de référendum sur la peine de mort, ni sur les impôts, etc.),
mais je ne vois pas du tout au nom de quoi on pourrait refuser aux peuples ces
outils élémentaires dune démocratie authentique.
Ces règles permettraient enfin dassurer une réelle
responsabilité des acteurs politiques.
Déjà de nombreuses voix sélèvent pour réclamer une réflexion
sur la 6ème République française, et cest
vrai que cette période dintense réflexion citoyenne que nous venons de vivre
sur les problèmes institutionnels de lUE se prête bien à ce chantier français,
complémentaire du chantier européen.
Encore un beau combat qui devrait réunir tous les
citoyens, de gauche comme de droite.
Cest la Politique
avec un grand P : les citoyens debout essaient dorganiser leur
Cité :o)
Je sens que de nombreux citoyens prennent leur sort en main.
Je sens que les jeunes,
enfin ! se politisent, et cest sûrement un signe de maturité.
Je sens que cest contagieux et que les peuples européens vont
bientôt rejoindre ce mouvement.
Cest fort.
Ma joie est pourtant ternie par la peine des partisans du Oui que je respecte sincèrement et que
je sais souvent très proches. Je sens
leur tristesse et leur peur du chaos et du gâchis, je pense à Laurent (Wauquier). Je voudrais
les rassurer.
Ce refus dun texte (qui nest pas un refus de lEurope,
évidemment) est porteur despoirs de changements positifs : nous pouvons
maintenant participer à la construction dune autre Europe qui sera meilleure
pour eux aussi, ceux qui croyaient au TCE.
Ce que ce Non massif
rend possible, cest la création dune entité européenne voulue et organisée par les peuples eux-mêmes, sans les tenir à lécart. Cest beau, et je suis sûr que ça peut
séduire de nombreux partisans du Oui.
Il est important de ne pas laisser confisquer cette victoire par
ceux-là mêmes qui viennent de proposer (et même souvent dimposer) des
institutions peu démocratiques. Un plan B a toutes les chances davoir les
mêmes défauts que le plan A si ses auteurs sont les mêmes.
Il faut bâtir un nouveau
plan de toutes pièces sur les bases de cette situation politique complètement
nouvelle.
Il faut surtout
abandonner, ou au moins amender profondément, tous les « traités institutionnels »
qui ont été imposés sans consulter les peuples : par exemple, est
absolument inacceptable cette montée au niveau international des choix
de politique économique (libérale en loccurrence) qui a pour principale
conséquence de priver les peuples de tout moyen de contrôle et dévolution
réelle.
Les citoyens européens
doivent récupérer le contrôle des politiques qui leur sont imposées.
Nous venons de refuser de fermer nous-mêmes
la porte de la prison de Nice.
Il faut maintenant sortir de la prison de Nice.
Mais il est aussi important dinviter fraternellement ceux qui
croyaient au TCE comme la seule voie raisonnable à se joindre à ceux qui
veulent proposer eux-mêmes une
Constitution européenne citoyenne.
Je ne sais pas ce que ça deviendra, il y a quelque chose
dimprévisible dans le désordre, mais les évolutions majeures naissent plus
souvent du désordre que de lordre, nest-ce pas ?
Il faut surtout rester respectueux des hommes.
Quand aux médias, (je pense
précisément à Radio France mais tous
les journaux et télés sont aussi concernés), on rêve quils se démocratisent
aussi, en doublant leurs
chroniqueurs pour présenter des confrontations, des débats, plutôt que
des chroniques à sens unique ;o)
Jai enfin revolé cet après-midi. Lair
sentait bon le romarin. Jétais confusément un peu inquiet de perdre cette bataille
devenue si importante, mais en jouant à me reposer au décollage, puis à
redécoller doucement sans reposer mon aile, en jouant à loiseau, jai oublié
tout ça quelques heures :o)
En rentrant à la maison, il allait falloir attendre ces fichus
résultats : je suis passé au bureau de vote de Trets (prononcer le t et le
s, avé laccent sil vous plaît :o) et on était à 70 % de
participation ! Yesss
Les Français se réveillent
Et puis la maison et ma boîte à mails
Ah ! Que vous êtes
gentils
Cest chaud de vous retrouver là, et cest vrai que cest triste de
sentir que ça ressemble à une fin, et on voudrait bien que ça ne finisse pas.
Quelle tranche de vie, vraiment.
Et puis les résultats à la télé : 55-45
Hum
Moi, jaurais
préféré 70-30
Quel goinfre :o) Je suis sûr quavec un mois de plus pour
expliquer, on y serait arrivé
Mais cest bien comme ça.
Comment a-t-on fait pour gagner avec tous ces handicaps ?
Comment a-t-on pu y croire jusquau bout alors que tant de gens respectables et
influents nous annonçaient les pires conséquences et nous faisaient très
peur ?
Il faut réaliser le travail de fourmi de ces milliers de Comités du Non, de gauche comme de
droite, dans chaque petit village, tout ce temps personnel de ces gens qui ont
accepté de griller tant de soirées pour expliquer aux autres, pour les
réveiller un à un
LInternet nous a aidé à rester ensemble, à nous passer entre
nous les précieuses infos, à une échelle nationale (et internationale) et à une
vitesse nouvelle.
Cette démocratie vivante où
les citoyens se lèvent et rappellent fortement quils veulent garder le
contrôle des politiques qui leur sont imposées, cest fort, cest historique.
Il faut organiser la suite de laction citoyenne, mais pour le
moment, il faut que jécoute ce quils disent à la télé, et puis je vais faire
un tour sur la Cannebière, hé pardi
À plus tard ;o)
Jai eu hier une forte conversation avec
un tout jeune homme, Luc, un ami de mon fils aîné, convaincu du danger du
TCE depuis longtemps, mais complètement ébranlé dans sa certitude par le
spectacle à la télévision dun acteur politique trop violent, nationaliste,
xénophobe, à qui il ne veut en aucun cas être identifié.
« Je ne suis pas
nationaliste, je ne suis pas raciste, jai peur en votant non quon se trompe
sur le sens de mon vote », me disait-il.
Je lui ai expliqué que le Non vient de toute la France, pas
seulement des nationalistes. Je reçois par centaines, tous les jours, des
messages enthousiastes de tous les bords de léchiquier politique, de lextrême
gauche jusquà lextrême droite, en passant par toutes les nuances du centre le
plus modéré et humaniste.
De tous les bords. Pas un ne manque à lappel.
Rien détonnant, donc, quon y retrouve aussi les nationalistes.
Rien dinquiétant non plus.
Cest même rassurant, que tout le monde se retrouve sur cette
position, même ceux quon considère comme des affreux. Ça ressemble bien au
signe que lon est au-dessus ou au-delà des positions politiques habituelles.
On est sur un vrai grand sujet.
Par exemple, si un leader nationaliste se met en lutte contre la peine de mort et la
torture, je ne vais évidemment pas revoir ma position et mon opinion
personnelle et me mettre à militer pour
la peine de mort et la torture.
Il ne faut pas se laisser embobiner par des arguments
moutonniers qui voudraient nous faire penser toujours comme tout le monde, ou
toujours contre certains, plutôt que par nous-mêmes. Il faut préserver notre
esprit critique. Je ne forge pas mon opinion en fonction dun parti ou dun
autre. Je prends "le meilleur", à mon goût, de chaque parti, sans
exclusive, et je crée moi-même ce qui me manque :o)
Il faut admettre quon a
des points communs avec ceux quon considère comme des affreux. Cela ne suffit pas à nous confondre.
Je voudrais revenir aussi sur lexpression « ceux quon
considère comme des affreux ». Cette façon de diaboliser des personnes au lieu de diaboliser des idées tue le débat
et interdit de progresser. Ça radicalise nos échanges.
Je ne peux pas croire, je ne veux pas croire, que les hommes
politiques nationalistes soient complètement noirs. Personne nest tout noir ou
tout blanc. Ces nationalistes, parfois xénophobes, ont des positions évidemment
critiquables, parfois même détestables, sur certains points, mais peuvent très
bien avoir parfaitement raison sur dautres et défendre vraiment les gens sur
des sujets importants.
En diabolisant un parti tout entier ou un homme, on humilie tous
ses sympathisants, qui peuvent être des millions, et on renonce au débat.
Or le débat est notre seule chance de progresser. Sans débat,
les positions se cristallisent, chacune de son côté, et cest une guerre qui se prépare en douce.
Jai des amis chers, de vrais amis, qui votent ou ont voté pour
des partis xénophobes (il y en a vers Marseille). Jen ai longuement parlé avec
eux, et de cette discussion ont pu naître des progrès : nos points de vue
peuvent se rapprocher, mais seulement en parlant, et seulement en respectant
lautre et ses peurs.
Ils mexpliquent pourquoi ils ont peur de « tous ces
étrangers » et le sentiment que personne ny fait rien. Jessaie dimaginer ce quon peut faire.
Je leur explique cette phrase essentielle : un étranger est un ami que je ne connais pas.
Jexplique que cette idée formidable est une graine
artificielle, quon décide délibérément dentretenir dans sa tête, qui
sarrose tous les jours et qui grandit si on sen occupe bien.
Je leur explique que la peur de létranger est comme un
instinct, une pulsion naturelle. Je souligne que les seules fois où je suis fier, dans ma vie, ce sont les fois où jai
dominé mes instincts, les fois où jai été plus fort que la nature. Cest
chaque fois que jai dominé mon égoïsme, cest quand jai eu le courage de
surmonter ma peur, cest quand jai patiemment construit ce que la facilité
naturelle ne montrait pas, que jai été fier dêtre un homme, avec un cerveau
qui domine ses instincts.
Il ny a pas dexception : cette observation-là est
fondamentale. Il faut arrêter de trouver des justifications à nos comportements
dans létat de nature. Rien nest plus suspect que cet état de nature qui nous
ravale au rang de bêtes.
Bref, jen parle. Et cest en se parlant que les points de vue
peuvent se rapprocher.
En diabolisant les partis dextrême droite, on se met en danger
au lieu de se protéger car les peurs originelles perdurent et le mal xénophobe
grandit.
Moi, je ne diabolise
personne. Je ne rejette que des idées.
Je pars voler. Je vous retrouve ce soir ;o)
François
Hollande sur France Culture le 26
mai à midi : « si Chirac avait mis en jeu son
mandat, le PS aurait naturellement
appelé à voter NON, comme pour De
Gaulle en 69 »...
Et quand le journaliste, médusé, demande de reformuler, le
patron du PS en remet une couche.
On mesure là dans toute son indécence, la position politicienne du PS, intéressé exclusivement par le
pouvoir, très loin du texte pour qui on peut finalement aussi bien appeler à
voter Oui que Non en fonction de considérations tactiques.
Cest simplement consternant.
On est au degré zéro du respect des citoyens : le texte suprême, (dont je rappelle quil consacre à la fois des
institutions non démocratiques, la privation du droit des peuples à disposer
deux-mêmes sur le plan économique et linstrumentalisation du chômage par une
politique forcée de lutte contre linflation) on sen fout : ce texte aujourdhui ardemment défendu par le PS comme
une urgente nécessité, ce texte aurait pu aussi bien être rejeté par le PS si
le pouvoir sétait offert rapidement à ce prix.
Pour le PS, on peut donc aussi bien dire Oui ou Non : ce qui
compte, cest faire tomber ladversaire politique du moment et reprendre le
pouvoir. Moi, ça me laisse pantois.
Lire et écouter à : http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2384
Et
il faut faire confiance à ces gens-là ?
Non merci.
Allez aussi lire sur ma page Liens
et docs le florilège de la prose utilisée depuis des mois pour nous
convaincre de voter Oui. Cest une raison de plus, sil en était
besoin, pour être certain quil faut absolument dire Non.
Dernière ligne droite (28 mai)
Fatigué, je rentre ce matin de Paris et je trouve plus de 500 mails (en deux jours)
Désolé de ne plus
faire face à tout. Je dois dormir un peu. Ce soir, encore quelques liens,
peut-être.
Ne ratez pas la merveilleuse parabole
que jai reçue, et publiée dans ma page Liens
et docs :o)
Voici deux citations
intéressantes trouvées aujourdhui dans ma boîte aux lettres, chers amis qui
maidez tant à progresser :o)
« Un homme révolté est un homme
qui dit non. Il refuse mais ne renonce pas... Apparemment négative, puisqu'elle ne crée rien, la révolte est
profondément positive, puisqu'elle révèle ce qui, en l'homme, est toujours
à défendre... La révolte est le fait de l'homme informé, qui possède la
conscience de ses droits, ou plutôt la conscience de plus en plus élargie que
l'espèce humaine prend d'elle même. » Albert
Camus - L'homme révolté.
« (...) par le moyen de méthodes toujours
plus efficaces de manipulation mentale, les
démocraties changeront de nature. Les vieilles formes pittoresques -
élections, parlements, hautes cours de justice - demeureront mais la substance
sous-jacente sera une nouvelle forme de totalitarisme non violent. Toutes les
appellations traditionnelles, tous les slogans consacrés resteront exactement
ce qu'ils étaient aux bon vieux temps, la démocratie et la liberté seront les
thèmes de toutes les émissions radiodiffusées et de tous les éditoriaux mais (...)
l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de
policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs mentaux mènera tout et
tout le monde comme bon lui semblera. » Aldoux Huxley - Retour au meilleur
des mondes - 1959
Je ne crois pas à la perspective heureuse dun plan B :
pourquoi le plan B ou C ou D, conçus par les mêmes
personnes, seraient-ils plus respectueux des peuples que ne létait le plan
A ?
Je pense quil faut que les
peuples européens, décomplexés par un beau Non
français, fort et pas timide, disent Non
à leur tour et imposent un plan 2,
nouveau, inédit : ce plan pourrait consister à commencer par demander aux peuples « Qui veut faire
lEurope » (respect de base : on demande aux gens sils sont
daccord pour ce choix de société).
Une fois que certains peuples (on ne peut pas encore savoir
combien vont le vouloir) ont dit quils voulaient une république européenne forte
et unie (ça a quand même une autre allure quand ça vient des peuples eux-mêmes,
non ?), on organise lélection dune assemblée constituante dans les x
pays volontaires.
Puis, après un vrai débat contradictoire, où les conflits et les
choix soient bien mis en scène et publiquement argumentés, les peuples
voteraient le même jour sur un texte court et lisible et connu de tous depuis
longtemps avant le vote.
On peut rêver ?
Jai reçu un texte dun haut fonctionnaire (désirant rester
anonyme mais sétant présenté à moi) qui sintitule Dire
oui au non.
Jeudi 26, de 11 à 12, je devrais
échanger quelques idées avec des internautes en compagnie dun député
(charmant) dont jai fait la connaissance ce soir (à Aix en Provence). Le respect mutuel qui nous anime tous les
deux permet comme je lai maintes fois constaté dans mes échanges de courriels,
malgré nos désaccords multiples, un échange réel, des progrès de la pensée de
chacun, un rapprochement et une dédramatisation tout à fait bienfaisants.
Le site du "chat" est :
http://www.linternaute.com/actualite/constitution-europeenne/chat-oui-non.shtml
(27 mai) Le texte du "chat" est à :
http://www.linternaute.com/actualite/constitution-europeenne/wauquiez-chouard.shtml
Remarque sans
importance : dans le texte du
"chat », une phrase de Laurent ma été attribuée à tort : " Le blog c'est la chance d'une
démocratie plus participative, plus interactive, il va y en avoir besoin pour
faire face au désenchantement."
Cette phrase est donc de lui, mais je la partage tout à fait :o)
Dans ces conditions déchange, je naurai aucun mal, au
lendemain du vote, à fraterniser avec Laurent.
Tiens, à propos, jai rencontré Bastien
François. Nous avons pris un pot place de la Sorbonne vendredi. Ce fut vraiment une très intéressante
conversation.
Quand un juriste rencontre un autre juriste, quest-ce quils
sracontent ? Des histoires de juristes :o)
On se reverra sans doute à propos dune Convention pour une 6ème
République.
Plus ça va, plus je crois que le Non est fort, quil est un geste de
citoyen debout, mature, volontaire, européen réfléchi, déterminé. Il y a peu de peuples européens qui ont la
chance que nous avons de réfléchir et de résister. Tout ça est historique :
quelle que soit lissue du vote du 29 mai, quelque chose change dans notre
pays, et la contagion rapide dépasse déjà nos frontières. Cest beau.
Steeve me fait
remarquer que le système politique qui intègre le sort dans la nomination des
hommes politiques porte un nom, la stochocratie, et que Montesquieu avait aussi planché
là-dessus :
"Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie.
Le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie.
Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne;
il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie."
Montesquieu - Esprit des lois
Steeve me signale aussi un site : http://stochocratie.free.fr/
Cest vraiment très
intéressant.
Force dInternet et plaisir de réfléchir à plusieurs
Merci Steeve.
Pour expliquer ce Oui de gauche apparemment complètement
incohérent, javais trouvé comme explication quayant construit
eux-mêmes cette Europe-là (ils croyaient encore, à lépoque, à la possibilité
dinfléchir, plus tard, la tournure libérale du texte vers plus de social), il
était difficile pour eux de sy opposer aujourdhui sans se renier eux-mêmes.
Pour appeler à voter Non,
il aurait fallu accepter davouer quils sétaient trompés, quils avaient cru
pouvoir changer le cours libéral des institutions de Maastricht sans y être parvenus. Les hommes de gauche qui appellent
à voter Oui seraient, avec cette
explication, ceux qui narrivent pas à admettre quils nous ont conduits
(involontairement) dans une impasse.
Thibaud ma fait entrevoir, par une seule phrase, une autre
explication que je navais pas du tout imaginée : la "stratégie"
des ténors socialistes et verts qui soutiennent ce TCE (très concrètement
néolibéral et très symboliquement social), pourrait être simplement la politique du pire : une fois ce piège néolibéral
refermé, les hommes politiques de gauche pourraient enfin se présenter et
paraître comme le seul recours, seul
moyen, pragmatique, de revenir au pouvoir.
Si cétait le cas, ce plan densemble serait quand même assez
cynique.
On est ici dans le procès dintention car bien malin qui dira
pour quelle raison intime tel ou tel acteur agit : aucune certitude, et
encore moins aucune généralité, nest donc possible, évidemment, mais je trouve
ça plausible, et ça rendrait enfin compréhensible ce choix dun Oui de gauche incompatible avec la
dérégulation confirmée et renforcée par le TCE.
Pour mémoire,
on peut rappeler les sept exigences
pour une Constitution démocratique et
sociale telles qu'elles avaient été adoptées lors du conseil national du PS du 10
octobre 2003 (http://www.parti-socialiste.fr/list_theme.php?theme=MTY0).
On y mesure point par point labandon intégral, le reniement
profond quimpose lappel à voter Oui
de ces gens-là.
Les socialistes
exigeaient fermement (à
lépoque) :
1. Une base juridique claire pour la protection et le développement
des services publics doit être posée ;
2. Des mesures d'harmonisation de la fiscalité doivent pouvoir être
adoptées à la majorité qualifiée. Ce doit être aussi le cas en matière sociale.
Les critères de l'emploi et de la croissance seront introduits pour guider les
interventions de la Commission et de la Banque centrale européenne. L'Europe
doit être dotée d'un gouvernement économique, disposant d'un budget suffisant
et d'un impôt, pouvant recourir à l'emprunt pour financer des grands travaux...
;
3. La majorité qualifiée doit aussi devenir la règle pour la politique
extérieure et de sécurité commune, l'unanimité étant l'exception ;
4. La diversité culturelle doit être garantie. Nous souhaitons que la
Constitution renforce les valeurs de la démocratie européenne et qu'elles
permettent l'évolution des institutions ;
5. Le caractère laïc de la construction européenne est un principe à
nos yeux fondateur ;
6. Les mécanismes de coopérations renforcées entre les États membres
doivent être assouplis ;
7. Les révisions futures de la Constitution doivent pouvoir être
adoptées, si possible par référendum européen organisé le même jour dans toute
l'Union, à la majorité qualifiée de la population et des États.
Les responsables
politiques de gauche qui défendent le TCE ont donc abandonné absolument toutes
ces belles convictions et soutiennent
aujourdhui, presque violemment, un texte qui contredit profondément tout ce
quils exigeaient fortement il y a un an.
Et cest même un comble : ces lâcheurs accusent les
autres leaders de gauche, ceux qui sont simplement restés fidèles à leurs
engagements, davoir des arrière-pensées politiciennes, des vues sur le
pouvoir
Le moins quon puisse dire est quils ne manquent pas
dair.
Pas étonnant que les vieux militants parlent souvent de
trahison dans les mails que je reçois tous les jours.
Ce jeune homme a écrit là un texte
remarquable, un texte qui métonne.
Chaque mot
compte, zéro pour cent de matière grasse, un style précis et une belle rigueur
intellectuelle. Quelques incorrections de détail peut-être, (qui nen commet
pas ?), mais une analyse vraiment intéressante.
Impressionnante prise de conscience.
Cest publié là : http://www.ineditspourlenon.com/.
Un lecteur vient de menvoyer la Constitution du Venezuela.
Jy ai trouvé des exemples
académiques (vivants) de démocratie authentique : ainsi larticle 72 qui permet à 20 % des
électeurs inscrits de demander, et à 25 % de provoquer, la révocation de
nimporte quel élu et le rappel aux urnes.
Il faut un certain courage politique
et un réel souci démocratique, je trouve, pour exposer ainsi à tout moment son propre pouvoir à la censure citoyenne.
Linstabilité quon pourrait
craindre est pourtant évitée car cette révocation dinitiative populaire nest
possible quaprès un demi mandat et une seule fois par mandat.
Cette procédure a déjà fonctionné
plusieurs fois sans semer le trouble : le Président a ainsi été
facilement réélu.
Dautres référendums dinitiative populaire
sont également prévus, au Venezuela, (articles 73 et 74), pour créer ou supprimer des lois.
Des limites (sujets interdits) sont
prévues pour éviter les excès.
On est bien loin, en Europe, dune
telle responsabilité politique des
acteurs institutionnels, aussi bien au niveau national quau niveau de
lUnion.
Oui, vraiment, larticle I-47.4 du
TCE et son humiliant droit de pétition est bien affligeant.
En
cherchant un peu autour du Venezuela, jai trouvé un article intéressant sur ce
pays, signé Danielle Bleitrach :
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=1729
Je reçois aussi des messages
proférant des accusations contre Chavez quon traite de tyran populiste
Mais
je ne vois pas du tout sur quels faits, sur quels événements, ces accusations
sappuient. Il paraît difficile, en France, davoir avec certitude une
information fiable sur ce pays apparemment emblématique de luttes politiques
acharnées.
En tout état de cause, les articles
de cette Constitution organisant la participation directe des citoyens aux
processus normatifs me semblent tout à fait édifiants, et jy trouve de quoi
alimenter ma réflexion sur ma propre Constitution.
Une passionnante
conversation avec un jeune journaliste (Raphaël) a semé une graine
inattendue dans mon vieux cerveau :o)
On nécoute plus nos hommes politiques parce quon les suspecte
souvent de ne pas être honnêtes du simple fait quil gagnent leur vie à partir
de leurs positions politiques.
Cette méfiance est un mal qui affaiblit notre démocratie.
Pour renouer la confiance, ne faudrait-il pas
déprofessionnaliser (au moins un peu) les fonctions politiques ?
Et pour atteindre ce résultat, nest-il pas intéressant de nommer les hommes politiques (en tout
ou partie) par tirage au sort parmi les
citoyens ? (à condition quils acceptent, bien sûr)
Un dénommé Hervé Chaygneaud-Dupuy,
« innovateur sociétal » (intéressante étiquette), a semble-t-il déjà
écrit quelque chose sur une hypothèse de "députés tirés au sort".
Jai retrouvé trace de cet homme à http://www.ateliersdelacitoyennete.org/Aparticipant.php...
À suivre ?
À propos de cette idée, jai reçu quelques messages mettant en
cause le sérieux de cette idée
Cest une piste, rien quune piste : on
réfléchit
Jimagine bien quon ne va pas tout régler au sort, bien
sûr :o) Mais lidée dintégrer de
simples citoyens dans les rouages politiques, à tour de rôle, (comme on le fait
pour les jurés dassises malgré la technicité et le risque des débats), me
semble intéressante pour renouer la confiance entre représentants et
représentés.
Frédéric Lordon est
vraiment passionnant.
Dans son article « Le mensonge social de
la Constitution » (voir ma page Liens), il rappelle fort
opportunément la genèse de cette
expression trompeuse.
Lexpression
« économie sociale de marché » désigne un libéralisme extrême, plus encore que celui dHayek lui-même, et où le mot social na rigoureusement rien à voir avec ce que
les français y devinent.
Il faut lire au moins ce passage du texte de Lordon (page 8 et
suivantes).
Dépit amoureux :
Face au reproche de partialité, les chroniqueurs
de Radio France revendiquent leur liberté de parole. "Un chroniqueur n'est pas impartial :
par définition, il prend position, c'est son boulot".
OK, admettons.
Mais la chaîne, la radio de service public toute entière, n'est-elle pas
évidemment partisane si elle ne présente
que des chroniqueurs d'un bord et
pas de l'autre ?
Plus de 70% des temps
pour le Oui, moins de 30% pour le Non, et toutes ces questions
bienveillantes quand on questionne un ouiste, toutes ces questions
malveillantes quand on questionne un noniste
Consultez un dossier assez riche
à http://www.acrimed.org/article1950.html.
Et même le chef de l'État, soi-disant fédérateur de la Nation,
prétendument au-dessus de la mêlée politique, qui prend carrément part au jeu
et qui se comporte comme un arbitre qui taperait dans le ballon pour marquer un
but contre une des équipes
Sur France Inter,
tous les matins, j'ai droit à ma chronique ultralibérale, puis ma
chronique eurolâtre, puis ma chronique centriste libérale (celle
qui diabolise méthodiquement les "extrêmes" de l'échiquier politique
français alors qu'aucun parti du centre ne se bat plus contre le
néolibéralisme)
Je pose cette question : pourquoi ne pas ajouter, tous les matins, (et pas
seulement pendant la campagne référendaire), un chroniqueur altermondialiste et
un autre eurocritique ? Pourquoi pas ?
Je réalise aujourd'hui, naïf que je suis, le bourrage de crâne
qu'on m'impose depuis des années.
J'en ai assez de la propagande d'État.
Je vis bien des désillusions ces temps-ci.
Daniel Mermet, l'indispensable Daniel, et quelques
autres humanistes authentiques, sont la bonne conscience de la chaîne France Inter, à une heure où tout le
monde travaille et où lécoute est faible. Je n'écouterai plus qu'eux, quand je
pourrai.
Je quitte France Inter pour quelque temps.
Je cherche une équipe de journalistes radio honnêtes (sans
publicité).
Quel dépit.
Le Figaro, 11 avril 2005, Alain Minc
parle : "Valéry Giscard d'Estaing n'a commis qu'une
seule erreur : nommer le texte du traité «Constitution». C'est précisément
cette dénomination qui a empêché une ratification par la voie parlementaire. Le référendum est pareil à une
«vérole» antidémocratique que la France aurait propagée dans l'ensemble de l'Europe."
Cette phrase résonne dans ma tête depuis, elle prend son sens,
comme un aveu.
Tout commence à prendre un sens nouveau. Ces gens-là qui me
répètent à l'envi qu'ils veulent mon bien, qu'il faut leur faire confiance
Ces
gens-là semblent bien mépriser le peuple, vous et moi, tout le monde.
Je vais continuer à lire le TCE
avec ce prisme-là, pour contrôler, pour essayer de comprendre, sur
pièces, les intentions réelles de ses auteurs.
Contrôler le poids qu'on donne aux représentants du peuple dans
ces institutions, contrôler la responsabilité des acteurs politiques pour leurs
actions, contrôler les outils de résistance en cas de dérive, contrôler la
réelle maîtrise des politiques menées en fonction des élections
Comment faire confiance après de telles paroles ?
Dans les batailles de blogs et dans les
éditoriaux, je vois passer lexpression « grossières erreurs
juridiques » à mon sujet pour disqualifier en bloc tout mon texte.
Laccusation est tellement fragile, en fait, que je nai pas réagi vite, mais
je my mets aujourdhui :o)
Nota : à la demande de
plusieurs lecteurs, je précise le sens du signe placé à la fin du paragraphe
précédent. On appelle ça un smiley. Ça représente une tête
souriante vue de côté et cest tout sauf une mode inutile : il ny a aucun
signe simple, en français, pour montrer quon sourit, et le fait de sourire
nest pas inutile du tout. Le sourire
apaise un message qui pourrait être mal pris à tort, il dédramatise un
thème qui pourrait être trop sensible
À tel point quaujourdhui, jaurais
beaucoup de mal à me passer de ces petits signes de sympathie. Avec un point-virgule, cest un clin
dil ;o)
Je viens de terminer et je publierai dimanche (sur une nouvelle
page Échanges) une réponse au texte de Monsieur Bastien
François qui maccuse donc dimposture et de diffusion de
« grossières erreurs juridiques », (comme si tout le monde dans ce
débat, jusquau Président, était irréprochable :o) On verra dans ma réponse que les erreurs les
plus graves ne sont pas celles quil dénonce : je me trompe parfois sur
des détails, mais sur lessentiel, je me sens au contraire de plus en plus
fort :
Traité ou constitution ?
La première de mes erreurs impardonnables serait de ne même pas
avoir compris que le TCE, comme ses prédécesseurs, est un Traité, et que
lUnion, benêt que je suis, nest pas un État.
Mais lerreur juridique majeure nest-elle pas précisément
daccepter sans esprit critique laffirmation de celui qui a écrit le texte et
qui sautoproclame constituant ?
Quand un groupe de gouvernements,
profitant dune conjonction politique heureuse, vous reprennent la démocratie
qui a pourtant 200 ans en créant de nouvelles institutions plus dangereuses les
unes que les autres faute de contre-pouvoirs et de contrôle réel des décisions
politiques, sans vous lavoir demandé, sans vous avoir intégrés au processus
constituant, en demandant réellement leur accord à seulement cinq peuples sur
vingt-cinq, sans vous permettre de changer vous-même ces règles plus tard,
êtes-vous tenu par la qualification de « Traité » quils donnent
eux-mêmes à la Constitution quils proclament sans vous ?
Déminents professeurs de droit public à la Faculté soutiennent
courageusement cette thèse de bon sens que la mise en place dinstitutions à
coups de traités est un abus de pouvoir.
À quoi sert le droit si ce nest à protéger les hommes contre
larbitraire ?
À quoi servent les professeurs de droit sils ne soulignent pas
la dangerosité des nouvelles institutions ?
Et tout compte fait, qui commet une « grossière erreur
juridique » ?
Conseil des ministres : deuxième chambre
parlementaire ou pouvoir exécutif masqué ?
La plus grosse tartufferie des institutions européennes, cest
bien de présenter le Conseil des ministres comme un organe législatif, une
« deuxième chambre », à linstar du Sénat français.
Si on écoute mes détracteurs, ce serait encore une
« grossière erreur juridique » du père Chouard de considérer le
Conseil des Ministres comme un organe exécutif. Certains experts prétendent que
les charlots comme nous ny comprennent rien : le CM est un organe législatif
on vous dit, laissez les experts réfléchir, circulez, y a rien à voir
Là encore, faut-il se laisser
berner par une qualification trompeuse ? Qui commet une erreur
grossière ?
Quen est-il ? Le Parlement est un pouvoir, et comme tous
les pouvoirs, il est dangereux. Un mécanisme courant pour limiter ses possibles
excès consiste à le décomposer en deux chambres distinctes qui, par le simple
jeu de la discussion parlementaire (navette) se tempèrent mutuellement.
Le Sénat français est
bien sûr élu, et ne dispose évidemment daucun pouvoir exécutif. Son élection
est indirecte : les sénateurs sont élus par les élus. En cas de litige
avec lAssemblée nationale, il na pas lavantage, et en contrepartie, comme il
na pas de grand pouvoir, il ne craint pas la dissolution.
On aurait pu, en Europe, prévoir une deuxième chambre élue qui aurait représenté les Parlements nationaux :
chaque Parlement national aurait pu élire quelques « sénateurs ».
Une autre possibilité aurait été quelle représente les régions : chaque Région
pourrait élire quelques « sénateurs ».
Ces idées sont séduisantes car porteuses de démocratie plus directe, plus proche des citoyens.
Mais alors, prévoir une deuxième chambre "parlementaire" qui représente les États et où siègent alternativement
(jamais au grand complet) les membres des gouvernements !
De qui se moque-t-on ? À peine ces "ministres législateurs"
ont-ils quitté la salle européenne, quils rejoignent leur pays, ils y
récupèrent leur costume de Ministre avec les attributs de lexécutif (maîtrise
de la force armée, de la police..) pour y faire appliquer les lois nationales
qui sont la transposition mécanique (sans débat) du droit quils ont écrit
eux-mêmes « là-haut ». On
organise là, à lévidence, une dangereuse confusion des pouvoirs.
La séparation des pouvoirs nest pas un principe creux,
académique, cest une règle de bon sens qui sert à protéger les humains : on ne donne jamais au même organe à la fois
le pouvoir décrire le droit et de lexécuter (sinon on court un risque car il
est trop puissant à lui seul).
Alors il est vrai que chaque Ministre nest pas seul et que le
fait de décider en Conseil, à plusieurs, limite beaucoup le risque de
despotisme. Mais les intérêts des ministres sont quand même très convergents
et, par exemple, leur tentation de saffranchir
du contrôle parlementaire est toute naturelle et bien réelle : on en
voit les effets dans ces institutions quils ont écrites eux-mêmes.
Ce Conseil des Ministres
est en effet finalement irresponsable : il nest prévu aucune
procédure de révocation au niveau européen.
Pourtant, le Conseil des
Ministres écrit le droit, il est même capable de lécrire seul, sans
contre-pouvoir, dans une série de domaines importants (et inavouables,
semble-t-il).
Contrairement
au Sénat dont le pouvoir est limité,
le Conseil des Ministres devrait pouvoir être censuré, du fait de son grand
pouvoir.
Mes détracteurs invoquent alors mon ignorance de la
responsabilité des ministres au niveau national. Mais cette responsabilité est toute théorique : en morcelant la
responsabilité et la mise en cause de la politique européenne du Conseil, on le
met, de fait, à labri de la censure (suivant le vieux précepte "diviser pour régner").
Voyons en effet comment les citoyens peuvent agir contre un
Conseil des Ministres qui leur semblerait démériter gravement :
Il faut dabord que les citoyens arrivent à savoir que le CM a démérité car le CM délibère bien loin des
peuples, encore à huis clos en dehors de son rôle strictement "législatif"
: mes détracteurs oublient de préciser que la publicité des travaux du CM ne concerne que les actes législatifs.
Les "actes non législatifs" (dénoncés comme antidémocratiques par les
conventionnels qui ont refusé de signer le TCE) restant discutés et votés à
huis clos, on se demande bien pourquoi.
Et puis cette publicité des débats législatifs du CM ne concerne
probablement pas tout le travail de préparation qui se fait sans doute loin des
caméras, en petit comité. Il ne faut donc pas surestimer lavancée que
constitue cette publicité (partielle).
Une fois informés, les citoyens en
colère devront convaincre une majorité de leurs parlementaires nationaux de
voter une censure de leur
gouvernement national au grand complet
(seule possibilité de contrôle politique en France), censure qui aura
finalement comme effet de changer un seul ministre sur vingt-cinq au niveau européen
Un immense effort pour un résultat quasi
nul.
Moi qui cherche à peser
mon pouvoir de citoyen, jai le sentiment que les peuples perdent, avec ces
institutions, toute influence réelle sur la politique menée en leur nom.
Ce qui rend encore plus
imbuvable laspect libéral de la politique imposée par la partie III, puisquon
naura vraiment aucun moyen de résister, même en devenant majoritaires !
Libéralisme ou néolibéralisme ?
Le camp du Non lutte à mort contre le néolibéralisme.
Le camp du Oui lutte à mort pour la garantie du libéralisme.
Lopposition ne devrait donc pas exister puisquils ne parlent
pas de la même chose.
Alors que le libéralisme modéré, tempéré par une certaine
solidarité, est sans doute bon pour tout le monde, le néolibéralisme est, lui, un excès mortifère, dogmatique,
régressif.
Pour mieux nous comprendre, nous devrions respecter un
vocabulaire qui évite les malentendus : souvent, quand on dit lutter
contre le libéralisme, cest pour aller vite, mais cest le néolibéralisme qui
est en cause, cest lexcès, le dogmatisme, qui est dangereux.
Tout le monde pourrait sans doute se satisfaire dun libéralisme
intelligent, modéré, qui est le contraire du dirigisme, étroit, dogmatique lui
aussi, liberticide.
Est-ce que tout le monde nest pas libéral, au moins au sens
modéré du terme ?
Et cest vrai que les institutions européennes portent en elles
depuis lorigine le libéralisme, mais lequel ?
De fait, les États européens ont toujours fait comme ils voulaient, malgré la
lettre des textes fondateurs, et ils sont copieusement intervenus dans la vie
économique.
Ce
nest que récemment que la Commission européenne sest mis en tête dimposer,
non pas le libéralisme, mais le néolibéralisme, cest-à-dire une dérégulation
systématique et profonde, une dépossession progressive de tous les pouvoirs
économiques des États, pour ne leur laisser que les fonctions régaliennes (police,
justice, armée
).
Cette
entreprise de dérégulation aveugle, qui avance en appliquant mécaniquement une doctrine (comme dit Fitoussi), est à
luvre au niveau planétaire, via lOMC, lAGCS et lADPIC (voir ces mots
dans ma bibliographie).
Et
cest cette mécanique économique (relativement discrète), qui ne sert pas
lintérêt général mais lintérêt de quelques uns, qui trouve sa traduction
institutionnelle dans le TCE. Et elle le fait en nous privant des rouages
démocratiques qui permettent habituellement de résister aux despotes.
Cest
ça qui est inacceptable.
Pour assurer la suprématie dun système économique, (et pour
garder le pouvoir ?), nos dirigeants sont en train de laisser perdre la
démocratie.
Faut-il valider, au nom dun rêve eurolâtre (en fait trahi),
ce verrou juridique qui pérennise la dépossession des pouvoirs économiques des
acteurs politiques ?
Ou faut-il, une fois conscient du danger historique que serait
une caution populaire à cette dérive (qui se décide dhabitude loin des
citoyens), résister, sopposer, pour garder la possibilité de construire
nous-même lEurope que nous voulons, plus politique quéconomique, plus
respectueuse des hommes que des États, plus responsabilisantes pour ses acteurs
politiques ?
Moi, je me réveille, et poussé par ladversité je progresse
vite : je vois bien que, pour changer le cap du gros paquebot, il ne faut
surtout pas valider le TCE qui est un mauvais texte, un texte dangereux et
rigide qui navoue pas ce quil vise vraiment.
Le
TCE est un piège juridique à vocation économique, il ne sert pas lintérêt
général.
Guerre militaire ou guerre économique ?
Les vieux de la vieille, nos chouchous, à qui on donnerait le
bon dieu sans confession, ceux qui ne peuvent pas mentir (mais qui peuvent se
tromper), Jacques Delors et Simone Veil, montent au créneau pour
défendre, lun cette Europe-là quels que soient ses dangereux rouages, et
lautre la paix pour éviter le retour aux camps nazis.
Mais je ne comprends pas pourquoi ces deux personnalités formidables
ne donnent aucun poids à largument des méfaits
prévisibles de linstitutionnalisation de la guerre économique, du recul de
lÉtat providence et donc des solidarités.
La concurrence, cest la compétition. En en faisant une
« valeur », on institutionnalise la guerre économique, chacun pour
soi et contre tous
"La concurrence est un alcali : à dose modérée, cest un excitant, mais à forte
dose, cest un poison" (A. Detoeuf,
vers 1933).
Alors je trouve
paradoxal quon nous vende le traité qui organise la guerre économique (la
concurrence libre et non faussée) entre les États via leur fiscalité et leur
droit social, la guerre économique qui monte les peuples les uns contre les
autres (exemple de la directive des services avec cette règle du pays dorigine),
quon nous vende la guerre économique
érigée en système au nom de la lutte contre la guerre militaire
Oui vraiment, cest paradoxal.
Et après le non ?
Je trouve que les nonistes
(je préfère nonistes à noniens) sont plus cohérents que les ouistes (jutilise ces termes par
commodité et sans aucune agressivité ou connotation péjorative, cest un peu un
jeu, un clin dil à ceux dont je sens que nous sommes finalement assez
proches).
Le point commun des nonistes, cest de rêver à un monde meilleur,
et seul le Non laisse de la place à lespoir dune utopie.
Le Oui est souvent plus désabusé, plus réaliste, plus résigné, et ils
sont nombreux, comme Jacques Delors
on dirait, à voter Oui en se pinçant
le nez.
Alors que le Non ouvre
le champ, avec une période de turbulence
certes, à une perspective de chantier
géant, dautant plus probable quil sera quasi obligatoire (on nous dit tant de
mal de « Nice le calamiteux » :o)
Si on arrive à 80 %, (on la déjà fait), cette force politique majeure qui monte
de la base ne pourrait plus être ignorée par nos hommes politiques qui seraient
contraints de sunir autrement ou de faire émerger de nouveaux chefs pour bâtir
une Europe enfin crédible puisque vraiment voulue par les hommes.
Ce nest
pas utopique si on est effectivement très nombreux et au-delà de la France,
partout en Europe.
Décisions en discussion (1er mai)
Un avocat ma envoyé un message pour calmer mes élans à propos des décisions.
Il travaille
tous les jours depuis des années sur ces décisions et me donne quelques
exemples.
Encore un riche échange (en cours, peut-être allons-nous nous
parler). Jai tout de suite modifié les paragraphes qui évoquent ce point, pour
mieux cibler mes questionnements.
Je n'arrive pas à accepter que la Commission, le Conseil des
ministres et les autres organes prévus (art. I-35) puissent, en certaines
matières (non listées), faire le droit et lexécuter. À suivre
Une nouvelle version, avec deux nouveautés et une correction :
La correction, cest
la portée de lart. 111-2 qui
ne « stérilise » pas la Charte (une erreur repérée par Rodrigo. Merci Rodrigo :o) : celle-ci peut avoir une valeur
contraignante, si la CJE le décide ainsi (valeur conditionnelle donc), sur le
droit communautaire, et sur lui seulement (cest ça, le sens du 111-2).
Première nouveauté : jai progressé sur la Cour de Justice Européenne (CJE),
cest é-di-fiant : les juges sont nommés (discrètement) par les exécutifs
(un par État) pour 6 ans renouvelables, ce qui rend les juges dépendants de
ceux qui les nomment et déterminent leur carrière
Alors quils ont un pouvoir immense, sans recours, absolument sans
contre-pouvoir.
Les délibérations se déroulent à huis clos
Je trouve ça simplement effrayant, voilà.
Deuxième nouveauté : les
« décisions européennes », à ne pas confondre avec les
règlements, qui ressemblent à des
« lois sans parlement », à usage des deux Conseils, de la
Commission
et
de la BCE (je vous jure). On appelle ça des « actes non législatifs ». Je trouve ça consternant.
Il faudrait quon explique ça aux citoyens, vraiment.
Appel au peuple :o)
Quelquun est-il capable de
justifier lexistence des « décisions » ?
Il faudrait vraiment que jarrive à prendre
un peu de distance après ces 20 jours « coup de grisou ».
J'ai reçu à la fois des félicitations de certains profs de fac
et des insultes d'autres profs de fac.
Les profs de fac (les "vraies" références) ne sont pas
d'accord entre eux sur l'essentiel.
Certains ont vu en moi un trotskiste affublé dun faux-nez,
dautres ont vu le complice des pires réactionnaires, nimporte quoi en fait.
Moi, cest simple, je ne diabolise personne, et je suis prêt à écouter une
bonne idée doù quelle vienne. Mêmes les étiquetés "affreux" peuvent
parfois avoir de bonnes idées. Je filtre toutes les idées dans ma cornue
personnelle et je distille ça comme je peux
:o)
Selon les enjeux des uns et des autres, peut-être, on me prête
des intentions différentes qui modifient évidemment la perception du message.
Mais qui peut jurer des intentions dautrui ?
De mon côté, je ne peux pas faire
mieux que vous dire "Voilà ce que je
crois, et voilà pourquoi je le crois, je sais que je peux me tromper, si vous
sentez que vous pouvez m'aider à progresser parlons-en, et de toute façon continuez
comme moi à réfléchir sur cet immense sujet de conversation
"
La prochaine étape est la réflexion
sur un projet crédible pour laprès non. On pourrait aider nos hommes politiques
à se regrouper autrement et inventer
ensemble un projet alternatif.
Les internautes qui travaillent sur la formidable encyclopédie Wikipédia, monument de travail
collaboratif généreux, pourraient peut-être nous aider à mettre en place
des outils informatiques de mise en commun et validation didées pour proposer un
projet de Constitution dinitiative citoyenne. On pourrait se donner 5
pages maximum, prévoir dinstitutionnaliser un vrai référendum dinitiative
populaire, de donner toute sa place à une démocratie des régions (des
communes ?) au sein de la démocratie européenne, mettre au premier plan
les citoyens plutôt que les États
Rien quy réfléchir vraiment ensemble serait déjà un progrès
majeur de notre civilisation.
Continuez à mécrire, la richesse de vos messages est un
enchantement. Si vous y pensez, dites-moi quel est votre métier et quel est
votre coin de planète.
Vous vous souvenez de ma question,
récurrente : « à quoi servent les profs de droit ? ».
Jai reçu hier, enfin, un petit
livre que jattendais impatiemment (je savais que jallais recevoir du
renfort).
Les professeurs de droit montent au
créneau pour défendre les fondements du droit, ceux qui protègent plus les
hommes que les États ou les unions dÉtats.
Un petit livre, intitulé « La nouvelle Union européenne.
Approches critiques de la Constitution européenne », (éd. XF de
Guibert, avril 2005), sous la direction dO. Gohin et A. Pécheul (professeurs à
lUniversité de Paris II et dAngers), regroupe lanalyse de jeunes
constitutionnalistes universitaires.
Je vous livre quelques passages de
la préface :
« (
)
Dans le nombre des inscrits sur les listes électorales, la proportion de
juristes est infime ; or, même de bons juristes ont peine à se reconnaître
dans un document qui, dans le journal officiel de lUnion européenne, occupe
201 pages. Limpression en petits caractères nen améliorera pas la lisibilité.
Or, je nhésite pas à lécrire,
aucun moyen nest épargné, à Paris comme à Bruxelles, pour en dissimuler le
véritable contenu. La propagande en faveur du oui était jusqualors inconnue
dans ce type de consultation. Cette propagande est tout simplement
catastrophique. On se garde bien dexpliquer de quelle manière et dans quelle
mesure la Constitution proposée changera lEurope en mieux. On leur représente
le non comme une épouvante. Il entraînerait la chute de la construction
européenne ! Il éliminerait une Europe porteuse de paix !
Tout cela nest que baliverne et
mensonge.
LUnion européenne existe, elle
mérite dêtre sérieusement réformée, mais autrement que par le projet de
constitution proposé au référendum. Si le non lemporte, lunion ne disparaîtra
pas. Elle demeurera telle quelle est, tant quune réforme meilleure ne sera
pas intervenue. Au printemps 1946, les français et les françaises ont rejeté un
projet de constitution au référendum, la France nen est point morte. Tout au
contraire.
En 1851, le Prince-président
faisait campagne sur le thème « Lempire, cest la paix ». Les partisans
du oui nous disent ou nous répètent, car le slogan a déjà servi,
« LEurope, cest la paix » : que la communauté économique ait
eu des effets économiques heureux tant quelle na pas cédé aux impératifs
américains de mondialisation, cela est un fait incontestable, mais attribuer
aux institutions européennes le mérite des cinquante années de paix que notre
continent vient de connaître, est contraire à la vérité. Les institutions
européennes ny sont pour rien. (
)
La disposition la plus grave de
la prétendue Constitution est larticle 1-6 selon lequel la Constitution (celle de lEurope) et le droit adopté par les
institutions de lUnion dans lexercice des compétences attribuées à
celles-ci priment le droit des États
membres, cest-à-dire jusquà la constitution de ces derniers.
Affirmation dune gravité
majeure. Dans sa République, Jean Bodin énonce les marques de vraie
souveraineté. La première, qui comprend en quelque sorte toutes les autres, est
le droit de faire les lois par lesquelles les sujets de droit doivent être
régis et gouvernés. Si le traité était
ratifié, la loi constitutionnelle de la France serait dune force juridique
inférieure à celle dune simple directive de lUnion européenne. (
) À
juste titre, Frédéric Rouvillois peut parler dun séisme juridique.
Ajoutons : et politique. »
Et ça continue, fermement. Un livre
court mais plein darguments importants, très techniques.
Au menu de ce petit bouquin qui me
regonfle le moral :
Chapitre
1 : le contrôle de constitutionnalité du traité : le double jeu du
conseil constitutionnel, par Frédéric
Rouvillois, professeur à lUniversité de Paris V. 12 pages importantes pour comprendre les
défauts du Traité que le Conseil Constitutionnel a "oublié" de
détailler dans son arrêt du 19 novembre 2004.
Chapitre
2 : La souveraineté comme principe dimputation, par Michel Troper, professeur à lUniversité de
Paris X, membre de lInstitut Universitaire de France. Ce principe est ce
qui permet de comprendre et daccepter la nécessité de lobéissance. Absolument passionnant, on est aux sources
du droit. Tout le monde est concerné.
20 pages.
Chapitre
3 : La primauté du droit communautaire sur la constitution française :
labrogation implicite de la Constitution, par Armel Pécheul, professeur à lUniversité dAngers. 20 pages.
Chapitre
4 : La nature de la nouvelle Union européenne, par Olivier Gohin, professeur à lUniversité de Paris II. Le nouveau Traité est une véritable
Constitution dès lors quelle correspond à la définition matérielle de
toute constitution : organisation des pouvoirs publics et garantie des
libertés fondamentales, avec identification dun pouvoir constituant (
) la
nouvelle Union européenne réunit, dès à présent, les éléments nécessaires de la
définition de lÉtat (
). 20 pages.
Chapitre
5 : La personnalité juridique de lUnion, par François-Guillhem Bertrand, professeur émérite à lUniversité de Paris
XI. La personnalité donnée à lEurope efface celle des États membres
lorsque lEurope sexprime. 6 pages.
Chapitre
6 : la place des États membres au sein de lUnion et dans le concert des
nations, par Michel Clapié, professeur
à lUniversité de Montpellier I. Le traité conduit naturellement à la
dépossession des États membres de leurs compétences originelles et les soumet à
limplacable tutelle de lUnion sous le double effet dune emprise technocratique accrue et dun véritable carcan idéologique.
Il ne garderont de lÉtat que lapparence et le nom. 31 pages.
Chapitre
7 : Les valeurs et objectifs de lUnion, par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur à lUniversité Rennes I. 14 pages au vitriol.
Chapitre
8 : Le déficit démocratique du traité établissant une Constitution pour
lEurope, par Alain Laquièze, professeur
à lUniversité dAngers. Méfiance envers les peuples et démocratisation toute
symbolique. 20 pages.
Chapitre
9 : La charte des droits fondamentaux contre les droits de lhomme, par
Jean-Philippe Feldman, professeur à
lUniversité de Vannes. Loin de promouvoir les droits de lhomme, la Charte
risque
de les affaiblir dangereusement.
Le petit prof de
droit en BTS se sent moins seul.
On trouvera dans
ce livre la plupart des réponses à
ceux qui réfutent mes craintes en prétendant que le TCE est un traité (pas une
Constitution) et que lUnion nest pas un État.
On a bel et bien, avec le TCE, un grave problème de respect de la démocratie.
Manifestement, les avis sont partagés,
même à lUniversité.
Tout le monde, absolument tout le
monde, peut se tromper.
Ce nest pas grave : ce qui
compte, cest de ladmettre simplement et de progresser sereinement.
Encore merci pour le fleuve de
gentillesse et denthousiasme qui inonde ma boîte aux lettres :o)
Je viens dapprendre que des hommes
politiques se font interpeller dans leurs meetings
par des citoyens qui leur demandent : « Que
répondez-vous à Étienne Chouard, prof de droit à Marseille qui dit
(citation de Chouard) »
Je viens aussi de recevoir un fichier
pdf carrément intitulé « Fac de
droit Marseille » avec, derrière ce titre inventé par je ne sais qui,
la version du 25 mars, cette première version qui contenait encore de
gênantes erreurs (sur la Turquie et la durée du traité de Nice, notamment).
Je comprends
mieux les messages furieux de quelques profs de fac qui crient à limposture.
Si ça tourne
comme ça, ils ont raison, il ne faut pas du tout me lire comme si jétais un
spécialiste de droit international, il ne faut pas me présenter comme ça, cest
un malentendu : je nai
rigoureusement aucune autorité pour dire le droit communautaire, et je
commets, comme tout le monde en ce moment (même en fac) parce que le texte
nest pas simple, des erreurs.
Depuis le début, je précise dès mon
introduction quil y a encore six mois, « comme tout le monde », je
moccupais peu de lEurope et je ne connaissais donc pas grand-chose au droit
communautaire. Je dis partout que je peux me tromper et que je cherche
précisément à progresser. Il est
paradoxal, et cest vrai, dangereux pour la qualité de linformation de tous,
que je passe après seulement 15 jours pour « le prof de fac de droit
public qui fait autorité ».
Ce malentendu mest imputable par le
style que jemployais au début, mais ce document, somme toute une synthèse
personnelle temporaire dun citoyen en train de progresser, nétait pas destiné
à la terre entière. Lenchaînement rapide des faits a, lui aussi, créé ce
malentendu.
Il est essentiel de rétablir la
réalité de mon message qui est en train daller, sans que jy puisse
grand-chose, bien au-delà de ce que jimaginais au départ : voyez, pour me
comprendre, les explications que jai actualisée hier matin (19 avril).
Les
interpellations publiques des hommes politiques devraient plutôt être ainsi
formulées : « Que répondez-vous
à Étienne Chouard, citoyen à Marseille qui dit (citation) ».
Je parle en citoyen. Jai dailleurs retiré dans la prochaine version de
mon texte (trop tard, je le reconnais, je navais pas vu le problème) cette
litanie « Nest-ce pas la mission des profs
? ». Je devrais
publier ça ce soir.
La présente mise au point sera
également incluse dans le document même.
Jinsiste : il y a en ce moment un grand débat entre citoyens, pour
mieux décrypter ce texte complexe qui sera peut-être notre Constitution. Je
vois tous les jours, à travers des centaines de messages, des gens qui réalisent
aujourdhui limportance dune Constitution dans leur vie quotidienne et qui se
plongent dans le TCE.
Je trouve remarquable que les
citoyens de base sinvestissent autant dans le texte qui dit pour eux le droit
du droit.
Je regrette que le temps nous manque
pour mieux échanger entre nous.
Sil vous plaît, faites
disparaître les anciennes versions de mon texte et discutons de bonne foi
sur létat actuel de nos réflexions respectives.
Vous remarquerez dans le texte du 21 avril un changement notable, par
rapport aux versions précédentes, dans
mon jugement sur laffaiblissement
du pouvoir parlementaire qui est limité finalement à quelques
domaines précis (et choquants). Notre
échange me fait vraiment évoluer, cest une réalité. Pour les autres domaines,
je crois avoir découvert, au contraire, un risque de force excessive du
Parlement (à confirmer, il faut encore
travailler ça).
Mais surtout, je prends conscience
d'une irresponsabilité quasi générale dans cette "Europe-qui-a-besoin-d'une-Constitution-pour-être-plus-forte".
Oui, nous avons évidemment besoin d'une Constitution. Mais celle-là protège-t-elle
vraiment les peuples censés s'unir pour se renforcer ?
On a vraiment un problème de rapport
démocratique entre les peuples et leurs élites.
Que ce texte est compliqué à
évaluer, mais comme il paraît dangereux.
Ça
devient fou, exagéré.
Après les journalistes au téléphone, à la maison,
la télé qui veut me voir, je reçois maintenant des messages méprisants,
sarcastiques, violents
Ces gardiens du temple qui montent au créneau,
spécialistes qui se moquent méchamment de mes erreurs de débutant (comme
beaucoup dautres, je ne connais pas grand-chose au droit communautaire).
Certains messages sont terrifiants, pleins de
haine.
Que sest-il passé ?
Je ne reviens pas sur mon réveil naïf de septembre
2004 et mes lectures boulimiques depuis. Après des heures de lecture et de
discussion, javais la conscience, malgré dévidentes lacunes, que des règles
fondamentales, des règles de bon sens dailleurs, étaient maltraitées par le
TCE.
Alors, comme personne nen parlait, jai dabord
essayé den parler à mes collègues, profs de droit en lycée comme moi, sur une
liste de diffusion professionnelle. Jai résumé quelque 150 pages manuscrites
en cinq ou six, en essayant dasseoir chaque idée sur larticle correspondant,
en me concentrant sur le plus grave à mes yeux. Mais certains profs de la
liste, peut-être avaient-ils raison, mont reproché cette lettre : « Arrête Etienne, cest de la
propagande politique, pas de ça ici ».
Jai insisté : « Cest vrai que cette réflexion a un aspect politique, au sens
fort, mais les arguments que je mets en avant ne sont pas de gauche ou de
droite, ils ne sont pas politiciens, et cest quand même un vrai grand sujet de
droit, et pour des profs de droit, le TCE est un vrai sujet de conversation,
non ? ». Cest pour insister sur ce lien entre ma réflexion et
notre métier que jai martelé à chaque partie « Nest-ce pas une mission des profs de droit
? ». Ce
nest pas du tout de la prétention, en tout cas, je comprends aujourdhui que
ça peut être pris pour de la prétention, surtout quand je vois la force que les
gens mettent dans lexpression « prof de droit », mais ça nest
pourtant pas de la prétention.
Rien à faire, « pas
de ça sur cette liste » me répondit-on. Alors, je me suis tu, mais
javais toujours ce besoin de confronter cette crainte toute récente et très
aiguë avec un grand nombre de contradicteurs, javais besoin de débat.
Or, jai un "site perso" depuis
longtemps, alors jy ai simplement ajouté une page Europe, et jy ai collé mon texte, tel quel. Rien, absolument rien ne pouvait permettre dimaginer
alors lincroyable succès de ce document. Je voulais parler avec mes collègues déco-gestion
de France par un autre moyen que notre liste de diffusion. Jai malheureusement
laissé dans le texte ces questions lancinantes sur la "mission des profs
de droit", questions martelées avec ce qui peut évidemment être
aujourdhui analysé comme une emphase ridicule, à léchelle qua pris le
document.
Étant au départ dans la perspective de léchange
entre profs déco-gestion, il ne mest pas venu à lesprit de rappeler que je
ne suis pas prof de fac, pas prof de droit public, etc. Cela va de soi, entre nous, cette précision
aurait été incongrue.
Et puis, ça sest emballé, en quelques jours, il y
avait des milliers de visites sur le site, et je recevais des dizaines de mails
par jour. Très vite, dès le lendemain je crois, des lecteurs bienveillants
mont signalé des erreurs. OK, très bien, cest précisément ce que je
cherchais, je corrigeais au fur et à mesure et publiais le texte corrigé pour
avancer.
Mais le texte dorigine, celui du 25 mars, avec ses
erreurs, notamment sur la Turquie et la durée de Nice, était déjà celui qui
circulait le plus : comme un virus, il avait sa vie propre, sa force
interne, malgré toutes ses erreurs, et je crois bien que cest lui qui circule
encore, malgré tous mes efforts pour le corriger honnêtement.
Aujourdhui, même sous les coups de poing dans le
ventre, souvent sous la ceinture, que je reçois en ce moment de la part des
gardiens du temple, des grands spécialistes du droit communautaire outrés de
tant doutrecuidance de la part dun petit prof de BTS aussi présomptueux
quincompétent en droit communautaire, je continue à trouver la démarche
intéressante : un citoyen qui réfléchit à sa Constitution projetée sans
lui à léchelle européenne, ce texte fondateur à qui il donne beaucoup
dimportance comme rempart contre larbitraire, qui sait quil se trompe sans
doute sur certains points, qui veut confronter ses idées, qui ne voit aucun
débat digne de ce nom dans les médias, qui arrive grâce au net à échanger
formidablement avec tous ceux qui jouent le jeu, et qui publie au fur et à
mesure un texte amendé, tout le monde réfléchit, on comprend mieux ce texte
inextricable.
Ça se défend, je trouve.
Alors pourquoi cette agressivité méprisante chez
certains ?
Est-ce le meilleur rôle que peuvent jouer les experts
dans ce débat citoyen : se moquer des erreurs commises par les non
spécialistes qui tentent ensemble de comprendre ce texte difficile et
ridiculiser chaque faux-pas ?
Cest sans doute de ma faute, largement. Qui
suis-je donc, atome présomptueux, pour
remettre en cause tout le travail de tous ces gens valeureux qui se sont donné
honnêtement du mal pour construire une Europe si importante pendant que je
dormais ? Qui suis-je pour interpeller ainsi les plus grands de ce monde,
les meilleurs spécialistes, les plus fins diplomates ?
Rien du tout, assurément.
Je respecte leur travail à tous et je les remercie
sincèrement pour tout ce quils ont bien fait pendant que moi, inconscient,
négligent, je ne men occupais même pas.
Je regrette aussi cette suspicion blessante, trop
générale, contre les acteurs politiques qui existe dans mon texte et je vais
tâcher de la nuancer.
Mais comme citoyen, je tiens au contrôle des
pouvoirs et à la légitimité des constituants, et jai beaucoup de mal à me
faire à lidée dune politique économique imposée sans plus tenir compte des
élections. Les spécialistes sauront-ils entendre ces préoccupations dun
citoyen de base, je dis bien de base,
même si ça va être dur aujourdhui de faire oublier que je suis aussi un petit
prof de BTS ?
Alors, je vais relire attentivement ces messages
hargneux, ce nest pas facile, pour y trouver leur part de vérité, lindication
de mes réelles erreurs, puis je vais intégrer ces corrections dans mon texte,
même si jai plutôt envie en ce moment de me recroqueviller dans ma coquille.
Je leur signale quen me parlant respectueusement, ils auraient obtenu le même
résultat, sans me blesser.
Et puis je vais faire une dernière mise à jour,
importante parce que jai repéré hier une erreur (cest si difficile à
analyser) que je veux corriger, dans lanalyse du pouvoir du Parlement qui est
à la fois nul par endroits et trop fort ailleurs. Je la publierai ce soir ou
demain, et puis je vais éteindre mon ordinateur parce que ça me ronge
profondément maintenant, cette histoire. Il faut se rappeler que je suis seul,
un clampin Dupont, pas du tout préparé à tout ça. Et puis je dois rendre des
copies lundi.
Sil vous plaît, ceux qui maiment bien et qui
commencent à protester pour me défendre sur les forums et autres blogs, je vous
en prie : ne soyez pas violents
comme eux, évitez lescalade verbale, montrez que le vrai respect dans une conversation est le meilleur gage dêtre
entendu et qualors tous progressent.
Encore merci pour le soutien chaleureux de ces centaines
de personnes qui mécrivent tous les jours et à qui je ne peux pas répondre
faute de temps.
Ne me faites pas tant
confiance, je ne suis pas une référence.
Continuez
à analyser, lire et dialoguer, peser le
pour et le contre.
Et vraiment, les experts devraient nous aider à
éclaircir nos idées au lieu de vilipender nos erreurs.
Le texte "Une mauvaise constitution..." a un succès
inattendu et certains commencent à lui reprocher (injustement) de ne pas être
ce qu'il ne sera jamais : une référence absolue, complète, impartiale,
sans erreur, sans oubli, une sorte de "guide à penser" commode pour
ceux qui sont pressés et qui n'ont pas le temps de lire le traité.
Il faut bien sûr lire, au moins un peu, ce traité,
ainsi que les arguments des deux bords :
l'enjeu est plus important que lors des autres élections européennes.
Si vous devez voter une fois pour lEurope, cest
le moment de ne pas sabstenir.
Quant à cette page, il faut la lire simplement
comme une réflexion d'un citoyen de base qui invite ses congénères à discuter
sur un sujet important, complètement écarté du débat par les médias, pour des
raisons mystérieuses.
Dès le
début, j'ai dit qu'il pouvait se trouver des erreurs dans mon raisonnement, je
l'ai dit expressément en introduction, ce n'est pas une formule creuse, et j'ai
dit aussi mon désir de progresser en confrontant mes idées à la critique. Nous
y sommes : on me renvoie des remarques, des objections, je réfléchis, je
progresse, je corrige, le texte progresse aussi, tout va bien.
On me reproche parfois de ne pas être impartial, de
ne montrer que ce qui pose problème, en cachant ce qui donne satisfaction. Mais
si je décrivais tout ce qu'il y a à dire sur le TCE, j'en écrirais 200 pages,
et personne ne me lirait, on raterait l'essentiel. Alors que j'ai repéré un danger qui me semble
immense, (peut-être à tort, on verra), je me concentre donc dessus sans
prétendre à l'impartialité, mais en appelant honnêtement au débat.
Et puis que mimportent les avancées (réelles) du
TCE si jai repéré ne serait-ce quun point dangereux et inacceptable ?
Je me concentre sur ce qui me paraît essentiel.
Parfois, dans mon texte, je simplifie la réalité,
comme chaque fois qu'on veut résumer sa pensée, et là, ce n'est plus exactement
la vérité, bien sûr. Par exemple, quand je dis "un Parlement privé de
son pouvoir normatif et de son pouvoir de contrôle", ce n'est pas parfaitement
exact (on sait donc tous qu'il n'a pas "aucun" pouvoir),
mais chacun comprend que cette image, simplifiée pour être forte, insiste sur une
tendance choquante.
Il faut
me pardonner certaines maladresses de forme et rester concentrés sur le fond :
à force de lire des milliers de pages très argumentées pour et contre le TCE,
je suis parfois en colère, et je suis probablement pollué par la masse d'info à
digérer et par la tendance souvent critique des textes que je lis. Je sens
bien, par exemple, quà force de relire la Déclaration des droits de lhomme et
du citoyen de 1789 et la Constitution de 1793, je parle plus de peuple et de tyrans quà laccoutumée. Jessaie de revenir aux sources. À chacun
ensuite de faire la part des choses.
Essayons de nous parler entre citoyens avec la
conviction sincère que l'autre est de bonne foi, qu'il nest pas mu par de
noirs desseins
Partisans
du texte et opposants au texte rêvent tous (ou presque) d'une Europe unie,
fraternelle, forte
mais nous navons
pas les mêmes craintes. Nous nous ressemblons donc
beaucoup, et pas grand-chose ne nous sépare.
Essayons de nous expliquer mutuellement nos
craintes. Mon objectif réel et sincère dans cette publication est, avec votre
aide, de contrôler quil n'y a pas de faille dans un raisonnement qui
conduit à une critique majeure d'un traité que je lis comme le révélateur
d'une grave maladie qui ronge la démocratie en Europe, une espèce de
renoncement, d'abandon des élites, dont parlent bien Jennar, Fitoussi et
dautres auteurs importants, professeurs de droit public à lUniversité ou
autres.
En effet, de deux choses l'une : si cette thèse est
erronée, il faut le démontrer et cesser de s'inquiéter sur ce point (il y aura
sans doute d'autres points à débattre). Mais si elle est valide, il faut se
mobiliser massivement pour résister, comme on résisterait à l'oppression.
Relisez-moi donc soigneusement, sil vous plaît, comme les dizaines de milliers
dautres qui vous ont déjà précédés :o)
Pour réveiller les journalistes de leur
"ronron oui-oui", je leur
ai écrit une lettre ouverte, comme on jette une bouteille à la mer, là
aussi... Mais comme je pense que ce sont des gens débordés, absolument
débordés, vraiment, ils ne liront pas plus cette lettre que les autres articles
décrivant minutieusement les dangers du traité, et ils resteront probablement
sur leur position de départ. Donc, pour une fois, c'est à nous de faire leur boulot
d'information, ou au moins dincitation à la réflexion, entre nous ;o)
Merci à tous ceux qui m'encouragent et m'aident à
progresser à travers ces échanges dune richesse indescriptible. Je reçois des
dizaines de mails par heure et je n'arrive plus à faire face car j'essaie de
répondre comme il faut à tout le monde...
:o)
Aujourdhui, 15 avril, jarrive à peine à les lire,
je ne réponds quune fois sur dix, et je nai pas le droit de quitter la maison
24 h dans prendre dun coup 350 mails de retard.
Voici donc les réponses faciles que je peux donner
ici, une fois pour toutes, à ceux qui se demandent : "Qui parle
ici ?" :
Je suis professeur en BTS dans un lycée de
Marseille. 10 ans de droit fiscal en BTS compta, 8 ans d'éco, de droit
constitutionnel, de droit civil et droit commercial en Terminale (je précise ça
parce que j'ai vu passer des messages comme 'il n'est même pas prof de
droit, il fait du parapente'...). Aujourd'hui, je suis devenu professeur
d'informatique et je suis, en plus de mes cours, l'administrateur du réseau
d'ordinateurs de mon lycée.
Le fait dêtre prof de droit en Terminale ma
conduit pendant des années à un effort pédagogique pour rendre simples et pas
trop arides des règles parfois compliquées.
Cette particularité explique mon goût de parler de la Constitution. Je
me sens, je sais que cest un peu bête,
une espèce de mission de parler de ce que crois à la fois important et
pas facile à comprendre. Cest une
maladie de prof daimer expliquer. En tout cas, rien ne minterdit (je crois)
de décrire mes craintes et dappeler au moins au débat avant de signer un texte
aussi important.
J'ai 48 ans, quatre enfants, je n'appartiens à
aucun parti, syndicat ou association, j'ai fait beaucoup plus de parapente que
de politique où je suis un débutant absolu, un bizuth, et où je ne ferai pas de
vieux os (le vol libre est une drogue dure qui me rappellera vite à elle).
Je ne suis donc le "sous-marin" de
personne, (affirmation marrante reçue plusieurs fois par mail. Par
exemple : « Monsieur, vous êtes
un sous-marin, je vous salue. » textuellement, je vous jure que cest
vrai).
J'ai une formation de juriste, une simple maîtrise
de droit suivie de la préparation du concours du CAPET, qui m'a donné le goût
de la chose publique, et la conscience de l'importance du droit pour protéger
les faibles, mais il ne faut pas
attacher d'importance à cette étiquette :
un prof de droit vous expliquera parfois des sornettes ou vous cachera une
partie essentielle, alors qu'une petite dame timide au coin de la rue est bien
capable de formuler une bonne analyse d'un texte "trop compliqué pour être honnête"... :o)
Fiez-vous donc surtout aux idées et arguments sans
vous laisser polluer par des considérations parasites (étiquettes, procès
d'intention politiciens, rancunes partisanes, etc.).
Pour répondre à certains qui raillent facilement, je
rappelle donc que je ne suis pas prof de fac, je ne suis pas prof de droit
public, je ne suis pas prof de droit constitutionnel, je ne suis donc pas du
tout un expert en la matière, et pourtant ça ne me disqualifie pas pour
réfléchir à ma Constitution, pas plus que ma fonction de prof ne me donne une
autorité particulière pour en parler. Je m'exprime en tant que citoyen de base,
et la notoriété subite de ce texte via l'Internet ne doit pas changer cela.
Je prétends que la réflexion sur l'équilibre et
le contrôle des pouvoirs n'appartient à aucun expert. Il me semble que l'exigence
de simplicité et de neutralité des textes suprêmes est une condition sine
qua non pour que ce débat puisse être universel comme il doit l'être,
et je dis que présenter un texte aussi long et compliqué, c'est en écarter les
citoyens de base, c'est en confier le contrôle à des experts, c'est gêner le
débat fondamental, ce n'est pas démocratique.
Malgré cette gêne que constitue un texte difficile,
ce débat appartient au commun des mortels, c'est la beauté de la
démocratie, ne le laissez pas confisquer par les experts. Lisez et prenez la
parole :o)
J'ai déjà reçu d'utiles et sympathiques critiques
qui m'ont permis de faire évoluer mon texte, en changeant sa date à chaque
fois. Par exemple, dans la première version, datée du 25 mars, j'avais commis
deux erreurs, et très vite, grâce à des lecteur attentifs (et bienveillants),
j'ai repéré et corrigé ces erreurs (une à propos de la Turquie, et une autre à
propos de la durée du traité de Nice). Mais le texte était déjà parti et il
m'échappait complètement, il vivait sa vie, autonome. Donc, si vous avez cette version datée du 25
mars, remplacez-la par la version la plus récente (à télécharger sur ce site).
Ne me reprochez pas les erreurs éventuelles comme
si j'étais malhonnête : elles sont prévisibles et prévues, et pas du tout
définitives si on recherche sincèrement à identifier les vrais enjeux de ce traité :
admettez que la tâche est rude avec ce texte complexe et sibyllin, et qu'on
est beaucoup plus forts à plusieurs pour affiner une critique qui deviendra
(peut-être) finalement irréfutable.
Vous remarquerez que je n'appelle jamais à voter de
telle ou telle façon. C'est parce que ma critique va au-delà de ce texte qui
m'apparaît seulement comme le verrou final dune évolution qui devrait être
revue dans son ensemble.
Certains me disent que je nai rien à proposer et
que je suis irresponsable, que je suis en train de casser un splendide édifice
qui a demandé des énergies colossales, des trésors de patience, des prodiges de
diplomatie...
Je suis sincèrement désolé de tous ces cataclysmes,
mais on va avoir du mal à me montrer que c'est de ma faute.
Moi, simplement, je tiens au contrôle parlementaire, je tiens à la force de mon
parlement, qu'il soit national ou européen, parce que c'est mon
principal rempart (avec les juges et les journalistes) contre l'arbitraire. Je
tiens aussi à ce que les pouvoirs soient réellement responsables, révocables.
Je tiens enfin à garder la possibilité de changer réellement de politique
économique par mon vote.
Si tout ce que les responsables de lEurope ont
construit depuis 50 ans me prive de la démocratie, je revendique le droit de me
mettre en travers.
Cest peut-être compliqué parce
quils veulent trop en mettre dans un cadre inadapté (la politique économique
imposée à tous, notamment). Sils se
contentaient dun texte de vingt pages qui règle uniquement lessentiel,
laccord, même à 25 pays très différents, serait sans doute plus simple à
trouver.
Bon, je suis en train de réécrire un papier de
fond, ce qui nest pas l'objet de cette page
:o)
Conseil : pour chaque page, vous pouvez télécharger
un fichier pdf pour une impression soignée. Vous pouvez aussi l'envoyer
à des amis, mais cela "fige" le texte, alors qu'il a besoin
d'évoluer (au moins un peu). Vous me rendez service en n'envoyant qu'un
lien vers ce site, car cela m'évite de prévenir la terre entière à chaque
mise à jour... Pensez aussi à prévenir vos correspondants que le texte évolue
et qu'il faut revenir de temps en temps sur cette page (donnez le lien avec
le fichier) pour récupérer la dernière version.
Amicalement.
Étienne.
Trets. 15 avril 2005
Accueil
Je profite de loccasion pour remercier ici les
milliers de lecteurs, souvent enthousiastes, parfois critiques, qui menvoient
tant de messages passionnants. Je peux vous dire que cest une expérience
unique, dune richesse inouïe. Tous ces gens si différents qui paraissent si
heureux, cest vraiment étonnant de vous voir tous arriver chez moi, on dirait
presque pour faire la fête, toute la journée
On dirait un grand réveil.
Et cet effort danalyse quon retrouve sous des
formes infinies, je reçois souvent de très longs mails qui ont pu demander des
heures de travail. Ces gens qui mécrivent pour me donner des conseils ou pour
me faire des reproches détaillés, circonstanciés, inquiets de ce quun Non
puisse lemporter, et ces échanges pleins de respect et deffort pour
comprendre les peurs de lautre.
Alors ensuite, le soir, il faut que je débranche
lInternet pour relire ces messages si denses, si riches, et il faut que je les
distille, que je men serve pour progresser, et je fais évoluer mon texte pour
retirer les erreurs, reformuler ce qui est ambigu ou exagéré
Je nai plus le temps de répondre à chacun, mais
quils sachent tous que leur texte résonne en moi malgré mon silence apparent.
Étonnante aventure
Ce qui se passe autour de mes petites idées de petit citoyen de rien
du tout a pour moi quelque chose dirréel, chacun le comprendra sil se met à
ma place.
Tout dabord, ce ne sont pas "mes" idées, je nai rien
inventé : jai simplement lu les autres, ingénument, pratiquement de tous
les côtés je crois, et puis jai distillé ça à ma manière, pour en extraire ce
qui me paraît important. Cette démarche nest pas extraordinaire.
Le fait quInternet soit une chambre décho potentiellement immense
nest aujourdhui plus théorique pour moi et, en fait de débat, je suis servi.
Malgré cette subite et exagérée notoriété, je reste un humain de base,
complètement seul, faillible et fragile, soyez gentil de vous en souvenir quand
vous portez vos coups.
Je reçois des centaines de mails par jour, très denses, très forts,
des vrais messages. Il faut se rendre compte. Cest au-delà de ce que peut
traiter rapidement un humain seul, même prof ;o), même en
vacances ;o).
Ce matin encore, jai reçu une vraie perle de message, de la part dun
contradicteur pas du tout daccord avec moi, mais raffiné, tout en nuances,
argumentant précisément point par point en restant chaque fois sur le sujet, et
bien sûr sans aucune agressivité. Nous en sommes à trois messages ainsi
échangés. Cest formidable, ce gars-là me tire à lui, jai envie de me
rapprocher de lui.
Je sens bien, là, sur des messages comme celui-là, que les partisans
du TCE sont très proches, à deux doigts seulement, des opposants au TCE. Nous
avons exactement le même rêve, ça devrait nous rapprocher beaucoup. Moi, ça me
donne beaucoup despoir.
Et puis hier soir, jai reçu dans un autre message une bordée
dinjures : je suis un falsificateur parce que je nai pas dit que
jenseigne dans un lycée et que je savais que tout le monde allait croire que
jétais prof de fac, je suis un manipulateur et je me sers de mon statut
privilégié pour induire en erreur les esprits faibles, je me trompe sur tout,
je suis irresponsable, etc.
Heureusement, jen reçois peu, mais jai cru comprendre que sur les
forums et les blogs, ça canarde dans tous les coins sur le père Chouard.
Alors bien sûr ce sont deux extrêmes dun spectre infini de
comportements possibles, mais jinsiste sur le fait que ce débat important ne
peut faire progresser tout le monde vers une meilleure perception de la réalité
quavec un infini respect de lautre. Il faut absolument se forger la certitude
intime que lautre est de bonne foi, quil croit ce quil dit, quil a
peut-être raison, sinon cest perdu, on va sempailler et cest la guerre.
Pour moi, un étranger, cest un ami que je ne connais pas. Cest un a
priori important qui aide à échanger.
Quand on parle à la cantonade, on peut prendre un ton dinterpellation
comme je le fais, mais quand on est dans la relation interpersonnelle, sil
vous plaît, respectons-nous profondément.
Alors le document, que je commence ce matin parce que je dors de moins
en moins, voudrait éclaircir certains malentendus évidents qui entraînent un
dialogue de sourds. Je vais, cette fois, faire peu référence aux articles du
TCE, prenant pour acquis que je parle ici à des gens qui ont maintenant une
connaissance du texte qui le permet. Ça rendra mes phrases plus brèves, mes
raisonnements plus clairs (jespère).
Je vais essayer dexpliquer en quoi les réponses que je reçois ne me
rassurent pas du tout, et donc comment devrait se transformer le discours de
mes contradicteurs pour que nous puissions nous entendre, au sens fort du
terme :
Quand je dis le TCE nest pas lisible,
on me dit tous les traités et toutes les constitutions
sont ainsi rédigés.
Outre que ce nest pas une raison,
un excès nen justifiant pas un autre,
jinsiste sur
ce point essentiel : comment les plus fervents partisans de ce texte,
(partisans que je respecte au plus haut point, même quand ils me tapent
dessus : jétais des leurs il y a six mois, et je les sens toujours très
proches de moi, sur lobjectif, pas sur les moyens), comment ces partisans du
texte donc expliquent-ils quil faille des
jours de travail à scruter les centaines articles sans en oublier, et sans
certitude davoir bien réussi, pour
découvrir les domaines sur lesquels le Parlement européen na pas du tout le
droit de légiférer, dans lesquels lexécutif confond les pouvoirs et peut, tout
seul, sans contrôle, à la fois faire les lois et les appliquer ?
Pourquoi ny a-t-il pas une liste
claire, et donc facilement critiquable, des domaines de chaque pouvoir ? Est-ce par hasard ? Parce
quon a pas eu le temps de rédiger le texte comme il faut ?
Cette illisibilité du texte suprême sur un point fondamental vous
paraît-elle acceptable ? Vous me dites que cest comme ça partout. Vous
êtes sûrs ?
Je nai pris quun exemple, mais je pourrais en trouver cent.
Je crois que, fondamentalement, ce nest pas
démocratique de proposer une Constitution aussi difficile à lire. Beaucoup de gens vont accepter ce texte sans
lavoir lu parce que tout a été fait pour quils naient pas envie de le lire
et quon compte bien sur leur gentillesse, sur leur confiance, parce que,
souvent, les gens sont comme ça, confiants et gentils. Je ne trouve pas ça
démocratique.
Je ne crois pas du tout que ce soit inévitable. Une Constitution peut
être lisible.
À mon avis, elle le doit.
Quand je dis que le texte nest pas révisable
on me dit que cest normal puisque cest un traité
Est-ce quon peut garder
lobjectif essentiel en tête ? Pour moi, mais je peux me tromper, je parle en petit citoyen
lambda, ce qui compte le plus, cest la
protection des individus contre larbitraire, contre la loi du plus fort.
Je suis sûr que le pays tout entier, à travers tout le spectre des
opinions politiques, peut tomber daccord là-dessus.
Les grands principes dont je parle (lisibilité,
"révisabilité", neutralité, séparation et contrôle des pouvoirs, et approbation
directe par le peuple lui-même, directement)
sappliquent à une constitution parce que cest le droit du droit, parce
que tous les autres droits vont dépendre de ce droit-là, et non pas parce que
quelquun a appelé ou pas le texte "Constitution", "traité"
ou autre chose.
Je veux dire que cest la
nature du texte qui fait son importance, son danger pour les peuples,
et donc le besoin de garanties qui lentoure.
Peu importe la qualification
quauront imposée les auteurs du texte. Même si le TCE navait pas prononcé une seule fois le mot
Constitution, nous autres citoyens de
base aurions reconnu dans ce texte une constitution de fait : mise en
place dun pouvoir exécutif, dun pouvoir législatif, dun pouvoir judiciaire,
force supérieure absolue du texte, etc.
Dans ces conditions,
prétendre que la procédure du traité simpose parce que les auteurs lont voulu
ainsi, nest-ce pas renoncer, par un rigorisme juridique un peu aveugle, à la
protection des individus que garantissent les principes dont je parle ?
Je suis sûr que les partisans du TCE qui me tapent dessus sont
profondément attachés à la protection des individus contre larbitraire, je ne
leur ferais pas linjure même dimaginer le contraire. En revanche, je crois
quils sont trop confiants dans la nature des hommes au pouvoir, et quils ne
mentendent même pas tant ils ont envie de lEurope tout de suite, à tout prix,
ce que je peux comprendre, mais pas admettre tant que je nai pas été rassuré.
Sans contre pouvoirs réels, nous courrons à labus de pouvoir.
Ce serait bien quils mentendent pour ensuite me
rassurer, au lieu de me parler dautres
choses, absolument mirifiques, qui se trouvent effectivement dans le
traité, mais qui ne me rassurent pas du tout puisquon a changé de sujet
Il
faudrait arriver à rester sur un sujet précis avec rigueur et lépuiser avant
de passer au suivant.
Dautant que le mirifique est souvent illusoire : je pense à
cette partie II stérilisée par lart
111-2 et dont on nous rebat pourtant les oreilles tous les jours comme si
nous abordions enfin une nouvelle ère démocratique.
Mais rassurez-moi : expliquez-moi ce qui va concrètement changer
la vie dans cette rutilante mais totalement creuse Charte des droits
fondamentaux.
Je pense aussi à ce triste droit de pétition, maquillé avec je ne sais
quels intitulés ronflants et trompeurs.
Il y a bien des trompe-lil, je trouve, dans ce texte qui va régir ma
vie et celle de mes enfants pendant des décennies. Ça ne minspire pas
confiance, désolé.
Encore une fois, un excès nen justifie pas un autre :
prendre la 5ème République comme référence pour bâtir le droit du droit européen,
cest mettre bien bas la barre dexigence démocratique.
Quon se rappelle les critiques gravissimes qui ont été portées contre
la Constitution de 58 à lépoque de son adoption. Le fait que Mitterrand ait
pris le costume de Président sans faire la moue après lavoir tant vilipendé ne
rend pas les institutions plus démocratiques.
Je pense quen France, la taille du pays, le comportement responsable
des exécutifs qui nont pas trop abusé de leur immense pouvoir et la tradition
de contestation de rue, ont permis de tempérer la dérive absolutiste que
portaient en elles les institutions. Je ne suis pas sûr du tout que ces
mécanismes régulateurs bien français soient imaginables au niveau dun géant
comme lEurope.
À ce niveau de taille, je trouve que nous devrions
être particulièrement vigilants sur la définition des pouvoirs et leur
contrôle, parce que cest sans doute la dernière fois quon nous demande notre
avis.
Attention : souvent, on me répond en présentant lélection comme
un contrôle des pouvoirs. Par exemple, on me dit « mais tous ces
présidents sont élus, tous ces ministres aussi » (cest moins évident avec
les ministres qui sont plutôt nommés), « ils sont donc responsables, mais
au niveau national ».
Je crois que cest mal comprendre le
besoin pour le peuple dun contrôle quotidien de chaque pouvoir.
Quand on dit « pas de pouvoir sans contre pouvoir, » cela signifie
que chaque pouvoir, dans toutes ses actions de tous les jours, peut être remis en
cause par un autre pouvoir. Et cest parce quil sait quil court un risque
quil nabuse pas de son pouvoir.
Si on sen remet aux seules
élections, il est évident quon ne contrôle quasiment plus rien. Ça cest clair : l'électeur
est libre une fois tous les cinq ans, dans lisoloir, et enchaîné en permanence
le plus clair du temps.
Les élections sont
donc nécessaires mais pas du tout suffisantes quand on parle de contrôle des pouvoirs.
Ainsi la possibilité de censure du gouvernement par le parlement ne sapplique-t-elle
quasiment jamais (en France), mais elle joue évidemment son rôle de régulation quotidienne
par sa seule existence, un peu comme
la dissuasion nucléaire : on ne sen sert jamais, mais ça garantit la paix
quand même.
Comment justifier quil faille une majorité des 2/3 pour censurer la
Commission ?
Je trouve, moi citoyen de base, récemment réveillé mais bien réveillé,
que la définition des contre pouvoirs
dans les institutions européennes est tout à fait inquiétante.
Est-ce quon peut parler de ça de façon apaisée, mais consciente que
cest la protection de nos enfants contre les despotes, éclairés ou pas, qui se
joue là pour des décennies ?
Il me semble que tout le monde a le droit de parler de ça, même ceux
qui ne sont pas "prof de fac spécialisé dans le droit
constitutionnel".
Nimporte quel citoyen peut comprendre ces enjeux simples mais
essentiels, et prendre la parole au même titre que nimporte qui.
Un des fondements de la
démocratie, cest que les peuples
acceptent de se soumettre à une loi quils se sont
donnée à eux-mêmes.
Sous-entendu : pas à une loi imposée par dautres.
Sous-entendu : pas de loi fondamentale sans laccord direct du
peuple, en connaissance de cause.
Si on oublie cette idée et si on laisse faire une assemblée qui na
jamais été mandatée par le peuple pour écrire, (ou plutôt recopier), le droit
du droit européen, celui qui va remplacer le droit du droit de chaque État
membre, si on oublie ce principe, on trahit la démocratie, en tout cas cest
comme ça que je le sens, vu den bas.
Comprenez-moi : jai bien sûr le plus grand respect pour les
membres de la Convention qui était composée de personnalités éminentes.
Mais il reste que jamais elle
na reçu le mandat du peuple pour faire ce quelle a fait. Toute
estimable quelle soit, cette haute assemblée ne me paraît pas légitime.
On peut ne pas être daccord là-dessus, mais on devrait pouvoir en
parler sans sempailler.
Je vais continuer à lire vos critiques constructives autant que je
peux, et je tâcherai de développer cette mise au point un peu plus tard.
Aujourdhui, il faut que je corrige des copies :o)
Étienne.
Trets, 13 avril 2005.
E-mail :
etienne.chouard@free.fr
Site : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/index.htm